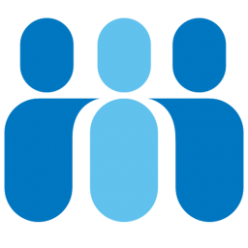En matière pénale, l’expertise de la personne atteinte d’une maladie psychiatrique est un élément déterminant de sa défense.
Les règles qui régissent cette expertise varient en fonction des modes de poursuites et du stade de la procédure autour de principes communs :
Objectifs :
- Déterminer si, au moment des faits le mis en cause présentait ou non une pathologie mentale et si en conséquence le tribunal ou la cour d’assises peut prononcer une peine.
- C’est au travers de l’intentionnalité du crime et du délit qu’est étudiée en droit pénal français l’irresponsabilité pénale
Principes :
- Tout crime est intentionnel
- Tout délit est en principe intentionnel sauf imprudence, négligence ou mise en danger
- Il n’y a pas de contravention s’il y a force majeure.
- Les exclusions de la faute => décrites en droit pénal français avec les causes objectives d’irresponsabilité et les causes subjectives d’irresponsabilité (cause présumée : la minorité et cause non présumée).
- Les causes objectives d’irresponsabilité : justification fondée sur une injonction ou justification fondée sur une permission (ex. le militaire, le policier)
- Les causes subjectives d’irresponsabilité : le trouble mental, l’erreur et la contrainte
- Le trouble mental : cause non présumée de non imputabilité
- l’auteur d’une infraction pénale peut être présumé irresponsable :
- Pour le mineur de moins de 13 ans : irréfragablement irresponsable du fait de sa présumée non-imputabilité
- Pour le mineur de plus de 13 ans : bénéfice d’une présomption d’irresponsabilité
Les méthodes des experts
L’expertise psychiatrique telle qu’elle fonctionne en France comporte des lacunes notables :
- Durée trop courte :
L’examen de la personne incriminée est souvent réduit, de l’ordre de 30 minutes.
- Intervention trop loin des faits :
Cet examen, alors que l’évaluation de la responsabilité pénale porte sur l’état de la personne au moment des faits, se déroule dans le temps à distance des faits, de l’ordre de 3 à 6 mois plus tard.
- Manque d’informations sur la personnalité
L’expert ne demande généralement pas la communication de son dossier médical lorsque celle-ci était déjà soignée pour des troubles psychiques avant les faits, ni ne cherche à collecter des informations historiques, familiales (en contactant la famille) et sociales qui permettraient à l’expert d’enrichir son analyse. S’il a connaissance d’un suivi psychiatrique préexistant aux faits, il cherchera éventuellement à se faire communiquer le dossier médical, mais celui-ci lui sera souvent refusé, en raison du secret médical. A noter que si l’expertise a été ordonnée par un juge d’instruction, l’expert doit obtenir de ses confrères l’information médicale dont il a besoin, ces derniers étant dans ce cadre dispensés de leur obligation de confidentialité.
L’expert ne sollicite ni les témoins des faits, alors que ceux-ci sont particulièrement importants dans la possibilité pour l’expert de répondre à la question : « Au moment des faits le mis en examen connaissait-il une abolition ou une altération partielle de son discernement ? ».
- Cadre matériel prégnant
L’entretien se déroule dans la cellule ou dans le parloir « avocats » lorsque la personne est détenue au moment de l’expertise, sous surveillance, ce qui ne favorise pas un « colloque singulier » entre le psychiatre et le patient examiné. Souvent, ce dernier ne comprend pas bien les enjeux de cette rencontre, s’affirmant indemne de toute maladie, ou adoptant une attitude hostile, absente ou sidérée, qui n’offre pas au psychiatre expert les conditions d’un véritable examen clinique. Il est donc important que l’expert mentionne l’échange qu’il a pu effectivement avoir avec le patient.
Intervenant généralement plusieurs mois (4 à 6 mois) après la commission des faits, l’expert psychiatre rencontre soit en prison, soit à son bureau, une personne qui n’est plus dans la phase de décompensation (ou crise) ayant présidé à l’acte délictueux. Selon le moment de cette rencontre, il la découvrira donc dans une phase de la maladie et un état psychologique qui peuvent être très différents ce qu’ils étaient au moment des faits, ne lui permettant pas d’apporter une réponse fiable à la question : « Au moment des faits le mis en examen connaissait-il une abolition ou une altération partielle de son discernement ? »
Il en va de même lorsque des soins psychiatriques ont été mis en place peu après les faits incriminés, ou l’incarcération, et que des praticiens ont travaillé avec le patient pour lui permettre de sortir de son état psychiatrique aigu. S’il adhère aux soins, le mis en examen apparaîtra alors comme disposant de ses facultés, permettant à l’expert de porter un jugement négatif quant à la gravité de sa maladie psychiatrique, ou même quant à son existence : en effet, il ne dispose pas en général du dossier médical (voir plus loin). De plus, le déni de la maladie, qui est un symptôme majeur de la psychose, conduira la personne examinée à se déclarer en bonne santé, ne mentionnant pas l’existence d’un suivi psychiatrique. L’inexistence de la maladie psychiatrique sera également souvent constatée s’il s’agit d’une première décompensation ou crise, dès lors que l’épisode aigu est passé. La personne peut en effet adopter pour un moment un comportement tout à fait « normal ».
Il est essentiel, pour l’avocat de la personne atteinte d’une maladie psychiatrique, de veiller particulièrement à cet acte de procédure.
- Manque de bases scientifiques de l’expertise
Il est frappant de constater la fréquence des expertises psychiatriques contradictoires.
Dans le même sens, sont aussi très éclairantes et préoccupantes les études[2] qui démontrent que la tendance de nombreux juges est d’appeler comme experts, régulièrement, les mêmes personnalités dont ils connaissent les prismes d’analyse et de jugement. Il sera donc important pour la défense du prévenu ou de l’accusé de demander et d’obtenir une (ou plusieurs) contre-expertises, en choisissant soigneusement le second expert. En matière criminelle, celle-ci ne peut être refusée par le magistrat instructeur.
- Obligation de la prise en compte des différentes expertises réalisées : Cass. crim., 15 mars 2023, no22-87318
Cette jurisprudence impose lorsqu’un ou plusieurs experts conclus à une abolition du discernement qu’ils soient entendus oralement à l’audience. Il est nécessaire que l’expert s’explique devant la Cour des raisons pour lesquelles il conclu à cette abolition.
Avis autorisés sur la crédibilité des expertises
Les expertises font régulièrement l’objet de critiques.
L’IGAS, dans un rapport de 2019 déclare « On ne peut que constater… la faible cohésion de la profession [des psychologues] au sein de laquelle certaines spécialités revendiquent une forte autonomie (les psychanalystes notamment)…
La déontologie n’est que peu enseignée durant le cursus universitaire. Le code de déontologie, non légalisé, demeure donc un code éthique indicatif. »
Dans la tribune « Pourquoi les psychanalystes doivent être exclus des tribunaux », la réalisatrice Sophie Robert explique « Dans les tribunaux, les psychanalystes peuvent aujourd’hui utiliser leur diplôme de psychologie ou de médecine (quand ils les ont) pour émettre des expertises qui n’ont aucun fondement médical ni scientifique, en violation complète avec le code de la santé publique. Les conséquences sociales peuvent être dramatiques : diagnostics fantaisistes et non reconnus par les nosographies internationales en vigueur, non prise en compte des besoins des personnes handicapées ou des malades psychiatriques, exclusion scolaire et sociale… »
Chapitres connexes :