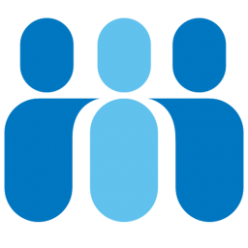1 - Nouveautés
Vous trouverez dans cette rubrique les éléments ajoutés dernièrement au kit.
Derniers ajouts en juin 2025 :
Dans la partie : Difficultés de mise en œuvre de l’obligation d’information du tuteur/curateur
Cour de cassation – Chambre criminelle 12 mars 2025 / n° 24-85.004 - Selon l’article 706-113 du code de procédure pénale, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé, d'une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet, d'autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée.
Dès lors, entraine la nullité de l’interrogatoire de première comparution, le fait que le curateur n'a pas été avisé de la comparution de son protégé devant le juge d'instruction.
Cour de cassation -- Chambre criminelle 19 mars 2025 / n° 25-80.106 - Mise en liberté d’un majeur protégé en le plaçant sous contrôle judiciaire, l’audience de maintien en détention provisoire s’est déroulé sans que son tuteur n’ait été avisé de la tenue de cette audience.
Dans la partie : L’admission sans consentement sur décision du représentant de l’Etat (SDRE)
A compter de l’admission en soins sans consentements, l’établissement à l’obligation, dans un délai de 24 heures, d’informer la famille de la personne faisant l’objet de soins ou à défaut toute personne justifiant de relations antérieures à l’admission en soins. Les difficultés rencontrées pour joindre et informer ces personnes doivent être dressées dans le certificat médical de docteur. A défaut, la mainlevée de la mesure peut-être sollicitée. Cour de cassation - Première chambre civile 14 septembre 2022 / n° 20-23.334
2 - Pourquoi ce «kit» ?
Le métier d’avocat est sans aucun doute l’un des plus beaux qui soient, mais il peut s’avérer très difficile à assurer lorsque la personne dont on prend la défense tient des discours irrationnels, se drape dans le mutisme ou nie toute responsabilité dans les actes ayant entrainé les poursuites contre l’évidence.
Parmi les clients adoptant ce type d’attitude figurent des personnes atteintes de troubles psychiques, manifestation de maladies graves considérées jusque récemment comme sans rémission : schizophrénie, troubles bipolaires, dépression sévère, etc.
L’Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et/ou Handicapées Psychiques (UNAFAM), est une association reconnue d’utilité publique forte de 15.200 familles adhérentes, qui apporte formation, et aide – sous toutes ses formes - aux familles dont un proche est sujet à des troubles psychiques. Parmi ses membres, un certain nombre de familles, apprenant que leur fils, fille, frère, sœur, père, mère, …, hospitalisé pour des soins sans consentement ou placé en garde à vue puis mis en examen suite à une présomption de délit, pouvait souhaiter l’assistance d’un avocat, se sont demandées en quoi elles pourraient aider ce défenseur de l’être cher.
En 2018, l’UNAFAM a publié un guide intitulé « Comment aider un proche malade psychique confronté à la justice pénale », actualisé en septembre 2020, auquel ont collaboré plusieurs praticiens du droit, dont des avocats https://www.unafam.org/besoin-d-aide/mediatheque/publications-de-lunafam/comment-aider-un-proche-malade-psychique
Elle a aussi formé une cinquantaine de ses bénévoles, répartis dans l’ensemble des régions, pour apporter une écoute attentive et des soutiens aux familles qui s’adressent à elle à travers ses « accueils » dans les délégations départementales et à travers son service « Ecoute Familles » (https://www.unafam.org/besoin-daide/une-ligne-decoute) au niveau national. Ces « référents parcours pénal » dirigent éventuellement leurs interlocuteurs vers des avocats qui ont montré une capacité particulière d’attention pour les personnes vivant avec des troubles psychiques.
C’est en dialoguant avec un certain nombre de ces avocats engagés et d’autres professionnels du droit autour d’idées partagées qu’est née l’idée d’une plateforme de ressources pouvant aider d’autres professionnels du droit, moins familiers des personnes malades et/ou en situation de handicap psychique, à préparer leurs plaidoiries en défense de ces derniers : une boite à outils, un « kit » à assembler selon ses besoins.
Ce « Kit d’aide à la préparation de la défense d’un client atteint de troubles psychiques » est ainsi le fruit de convictions partagées entre une association de familles et des praticiens du droit : avocats, magistrats et universitaires.
Il est fondé sur des convictions partagées entre une association de familles et des praticiens du droit : avocats, magistrats et universitaires. Les principales sont que :
- Les maladies psychiques demeurent très mal connues hors du monde de la psychiatrie, et encore plus les traitements qui, aujourd’hui permettent, dans une proportion de plus en plus élevée, une stabilisation des symptômes gênants favorisant ainsi la réinsertion des personnes « rétablies » leur permettant une véritable intégration dans la société, même si subsistent des limitations (handicap psychique).
- Les préjugés très largement partagés par la population sur la dangerosité des personnes vivant avec des troubles psychiques, bien que démentis par les statistiques mais entretenus par les médias, affectent largement les décisions de justice.
- La loi pénale, en organisant, avec l’article 122-1, la réflexion des magistrats de façon binaire autour des notions d’abolition et d’altération du discernement, tourne le dos aux avancées de la psychiatrie depuis une décennie qui, avec l’aide des neurosciences, ont permis de comprendre que les troubles psychiques en phase aigüe peuvent souvent combiner une part de discernement avec une perte totale de la maîtrise de ses actes.
- Les magistrats ne trouvent guère dans les expertises qu’ils demandent dans les procédures pénales de réponses aux questions qu’ils se posent du fait du simplisme de la loi.
- Le développement de la procédure des comparutions immédiates a restreint significativement la possibilité, pour avocats et magistrats, de prendre en compte l’existence de pathologies psychiatriques de mis en examen qui échouent ensuite, dans une proportion anormalement élevée, dans les établissements pénitentiaires.
- Alors que les malades psychiques ont besoin de soins de qualité, la prison n’est que très rarement un espace qui les leur procure.
- Lorsque l’irresponsabilité pénale n’est pas reconnue, les peines alternatives et aménagements de peine en milieu ouvert sont généralement la solution la plus adaptée, car ils permettent la mise en place de soins.
- La psychiatrie, faute de moyens et de réformes organisationnelles structurantes, restreint encore trop fréquemment les droits des patients qui lui sont confiés pour des soins sans consentement. Alors que les pratiques d’isolement et de contention ne devraient être qu’exceptionnelles selon la loi, elles sont quasi-systématiquement appliquées lorsqu’il s’agit de détenus transférés.
- La loi de santé, en instituant en 2011, obligatoirement dans les douze jours suivant l’admission en soins psychiatriques sans consentement, l’audience devant le juge des libertés et de la détention a donné à ce magistrat une responsabilité très difficile à assurer en bornant son rôle au contrôle de la régularité de la procédure. La LFSS du 14 décembre 2020 a étendu ce rôle au contrôle des durées d’isolement et de contention sans lui donner les moyens de le faire réellement.
- La protection qu’organise la loi pour les majeurs sous tutelle ou curatelle se trouve fortement amoindrie par une interprétation jurisprudentielle considérant que les autorités publiques ne sont soumises qu’au respect d’une obligation de moyens.
Ces dix convictions partagées ont servi de matrice pour définir les différentes composantes de ce kit, « work in process » qui sera amélioré au fur et à mesure des apports de ses utilisateurs.
Chaque défenseur s’y référant est, bien entendu, libre, s’appuyant sur son éthique professionnelle, d’en faire l’usage qui lui paraîtra le plus indiqué en accord – lorsque c’est possible – avec son client.
Il est un sujet sur lequel les auteurs n’ont pu parvenir à un consensus en ce qui concerne le procès au pénal : partant du constat fait par plusieurs études scientifiques que les peines, infligées en correctionnelle ou en Cour d’assises à des prévenus dont la pathologie psychiatrique est connue des juges, sont, au mépris de la loi, en moyenne plus lourdes que celles appliquées à des personnes n’ayant pas une telle pathologie ou dont la pathologie psychiatrique est ignorée, deux opinions se sont faites jour:
- Celle qu’il vaut mieux, aux différentes étapes de la procédure pénale, passer sous silence la pathologie psychiatrique, et encore plus si la personne refuse qu’elle soit connue des juges, en se gardant de demander une expertise ;
- Celle qu’il vaut mieux au contraire mettre en avant cette pathologie pour obtenir soit la reconnaissance de l’irresponsabilité pénale, soit le bénéfice des réductions de prévues à l’article 122-1 CP, s’appuyant sur la mise en valeur des possibilités thérapeutiques existant aujourd’hui pour conduire les personnes malades psychiques sur la voie d’un « rétablissement » conduisant à leur réinsertion sociale.
A chaque défenseur, en fonction de son intime conviction, que ce kit vise aussi à l’aider à se forger, de choisir entre les deux attitudes.
3 - Quelques clés sur les maladies psychiques
Ce chapitre a été écrit par l’UNAFAM sur la base des données scientifiques qu’elle accumule et tient en permanence à jour. Son objet est de fournir au lecteur des informations allant au-delà des représentations traditionnelles et simplistes sur des maladies pour lesquelles la recherche avance à grands pas, porteuse d’espoir.
3.1 - Définitions & Symptômes
Les maladies psychiques sont des maladies du cerveau qui affectent la pensée, les émotions et le comportement d'une personne.
Elles altèrent non seulement le cerveau, le système nerveux central, mais aussi les systèmes périphériques (comme en témoignent les maladies somatiques qui leur sont souvent associées).
Les communications entre les cellules nerveuses sont touchées, ce qui perturbe la transmission d’informations venant du corps ou du milieu extérieur.
Aujourd’hui, on retient, comme explication, le modèle bio-psycho-social, qui met en cause de multiples facteurs (complexité) : Vulnérabilité génétique + Facteurs biologiques (infections prénatales, facteurs inflammatoires…) + Environnement psycho-social = Troubles psychiques
Sont aussi identifiés des facteurs déclenchants tel qu’un stress (deuil, rupture scolaire, amoureuse, psychotraumatismes, risques psychosociaux…) et/ou la consommation de cannabis, d’alcool…
3.1.1 - Les symptômes des différents types de maladies psychiques
Elles se caractérisent par des troubles comportementaux et une souffrance psychique souvent associés à des troubles cognitifs (touchant la mémoire, la concentration, etc.) qui handicapent la personne atteinte et altèrent son fonctionnement social, familial et professionnel.
- Altération des repères de temps et d’espace (horaires, déplacement, orientation).
- Vitesse de compréhension ralentie : décalage entre compréhension, réaction, exécution.
- Troubles de la mémoire : oubli des consignes.
- Altération de la concentration.
- Troubles de l’anticipation (difficulté à s’organiser, à se projeter dans l’avenir).
- Troubles de la volition (incapacité à faire des choix et à les assumer).
Les crises ou « décompensations »
Elles sont une réaction à une situation émotionnelle extrême. Souvent, il s’agit de la mise à jour trop brutale ou forcée et donc la confrontation sans préparation, de certains éléments psychiques personnels lourds, qui provoque un effondrement général de la personnalité de l’individu.
Cet effondrement entraîne des conséquences pouvant aller de la dépression jusqu’au suicide ou de l’agitation jusqu’à l’agression de tiers (passage à l’acte)
Une décompensation peut aussi mettre en lumière une pathologie psychiatrique jusque-là latente.
Les maladies psychiques sont génératrices d’angoisses et de souffrance. Elles nécessitent soins et accompagnements. Pour cela, il est indispensable de :
- les identifier comme des maladies (le déni est souvent une première réaction de l’entourage).
- en parler
- adapter les aides à chaque cas spécifique
- être confiant que chaque situation peut être améliorée
Une prise en charge adaptée et précoce améliore considérablement le pronostic (en prévenant ou minimisant les rechutes) ainsi que la qualité de vie des personnes en limitant le handicap.
3.1.2 - Les principales maladies psychiques
Elles sont aussi appelées maladies mentales en référence au DMS, manuel statistique international des troubles mentaux : on présentera successivement :
- Les schizophrénies
- Les troubles bipolaires
- La dépression résistante
- Les troubles de la personnalité borderline (état-limite)*
- Les troubles anxieux et phobiques (trouble anxieux généralisé, phobies, troubles obsessionnels compulsifs), pathologies beaucoup moins sévères que les précédentes.
A - Les schizophrénies
Cesont des maladies psychiques chroniques se traduisant par une perception perturbée de la réalité, des manifestations productives, comme des idées délirantes ou des hallucinations, et des manifestations passives, comme un isolement social et relationnel. En pratique, elles peuvent être très différentes d’un patient à l’autre, selon la nature et la sévérité des différents symptômes qu’il présente. (INSERM) Elles touchent environ 1% de la population générale (OMS).
- Les troubles apparaissent le plus souvent à la fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte
- Les troubles affectent la capacité d’une personne à distinguer la réalité partagée par tous, de sa propre perception des évènements
- Les troubles affectent l’estime de soi (auto-stigmatisation)
- Le déni retarde la prise en charge en soins
Les symptômes sont de trois types :
Les symptômes productifs dits « positifs » :
Ainsi dénommés parce qu’ils « s’ajoutent » aux perceptions ordinaires, ce sont les plus impressionnants : ils rassemblent les délires et les hallucinations et peuvent se traduire en un sentiment de persécution (paranoïa), une mégalomanie, des idées délirantes invraisemblables et excentriques, ou encore des hallucinations sensorielles, souvent auditives (le sujet entend des voix) mais aussi visuelles, olfactives, tactiles ou gustatives.
Vécus comme réels, ces symptômes sont souvent très angoissants et source de souffrance considérable.
Les symptômes dits « négatifs » (ou déficitaires) correspondent à un appauvrissement affectif et émotionnel. Le patient se met en retrait et s’isole progressivement de son cercle familial, amical et social. Il communique moins, présente une volonté limitée et manifeste une émotivité réduite. Il présente moins d’intérêt et de volonté et davantage d’apathie, ce qui peut ressembler à une dépression. Les symptômes s’expriment par la réduction de l’ensemble des activités. Ils peuvent ainsi se traduire par :
- un manque d’énergie,
- une difficulté à mener une action, à se concentrer, à mémoriser, à suivre un film ou une conversation.
- une atténuation des émotions (qui peut aller jusqu’à une indifférence affective).
Les symptômes dissociatifs correspondent à une désorganisation de la pensée, des paroles, des émotions et des comportements corporels. La cohérence et la logique du discours et des pensées sont perturbées. Le patient est moins attentif, présente des difficultés à se concentrer, mémoriser, comprendre ou se faire comprendre. Il peut avoir des difficultés à planifier des tâches simples comme faire son travail ou des courses, ce qui peut être source d’un handicap majeur dans la vie quotidienne. (Source site INSERM)
En dépit de l’emphase donnée à certains faits divers, les patients dangereux pour la société sont une minorité. Seuls de rares cas donnent lieu à des accès de violence au cours d’une crise, et cette agressivité est le plus souvent tournée vers le patient lui-même : environ la moitié des patients souffrant de schizophrénie font au moins une tentative de suicide au cours de leur vie. Entre 10 et 20% en meurent, surtout dans les premières années. (Source site INSERM)
B - Les troubles bipolaires
Les troubles bipolaires se caractérisent par une alternance chez un même sujet de périodes d’accès maniaques et/ou d’accès dépressifs de forte intensité, entrecoupées de périodes de stabilité (normo-thymie). Ils touchent entre 1,2 et 5,5% de la population (Source Fondation Fondamental).
L’état maniaque
Etat euphorique intense, associé à :
- Des projets grandioses et inadaptés, des dépenses compulsives
- Une estime de soi démesurée (mégalomanie)
- Une hyperactivité, des insomnies sans sensation de fatigue
- Un besoin de séduire, des comportements sexuels à risque…
L’état dépressif
La phase dépressive est l’autre versant de la phase maniaque, tout aussi forte mais dans l’émotion inverse : tristesse, dépression, mélancolie…
Par ailleurs, les troubles bipolaires s’accompagnent d’une forte comorbidité, c’est-à-dire que d’autres troubles se greffent à la maladie : alcoolisme, diabète, dysthyroïdie, etc.
Le diagnostic est souvent tardif en raison de la difficulté à identifier les phases maniaques et dépressives, qui ne sont pas toujours caractérisées. On estime à 10 ans en moyenne le temps écoulé entre un premier épisode et l’instauration d’un traitement adapté. Ce décalage s’explique par la méconnaissance de la maladie de la part des médecins, qui associent souvent les symptômes de la bipolarité à ceux de la dépression. Si bien qu’actuellement, 40% des dépressifs pourraient en réalité souffrir de bipolarité sans être diagnostiqués.
Le risque suicidaire est important (20% des personnes bipolaires non traitées décèdent par suicide).
C - La dépression résistante
La dépression est une maladie mentale courante : 16 à 17 % des Français présentent au moins un épisode dépressif au cours de leur existence (Source Fondation Fondamental).
Si la prise en charge des épisodes dépressifs est aujourd’hui bien codifiée avec une efficacité clairement démontrée des antidépresseurs et psychothérapies, on estime cependant que ces traitements ne sont pas efficaces dans un tiers des cas.
Forme particulière de dépression, la dépression résistante se caractérise par la persistance de l’épisode dépressif malgré au moins 2 traitements antidépresseurs successifs bien conduits ou qui n’évolue pas suffisamment favorablement sous l’influence de ces traitements.
Elle concernerait 20 à 30% des épisodes dépressifs majeurs.
Mieux la comprendre et mieux la soigner est donc un enjeu majeur. Il existe pour cela des « centres experts dépression résistante » (réseau Fondamental) qui offrent un réseau de consultations spécialisées dédiées au soin et à la recherche.
D - Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC)
Ils se caractérisent par :
- Les obsessions : idées ou impressions répétitives, embarrassantes et indésirables. Elles prennent la forme de préoccupations concernant la saleté, de pensées angoissantes, de besoins de placer des objets dans un certain ordre… Elles peuvent être associées à des compulsions.
- Les compulsions : rituels qui se traduisent par des vérifications répétitives (tels que des lavages ou nettoyages excessifs). Ces comportements ont pour but de diminuer l’anxiété causée par les obsessions.
E - Le trouble de la personnalité borderline
C’est une maladie psychique appelée aussi « état-limite » qui affecte 2% de la population générale (Source OMS).
Elle génère un mode général d’instabilité : de l’identité, de l’image de soi, des relations interpersonnelles et de l’humeur. Elle se caractérise par une impulsivité marquée, et des comportements auto et hétéro agressifs.
Cette maladie est souvent confondue avec le trouble bipolaire, qui concerne l’humeur, alors que le trouble borderline est un trouble des émotions, caractérisé par deux aspects : une plus grande sensibilité et une moins bonne régulation. Le risque suicidaire est important
Pour mémoire, nous présentons ensuite des pathologies psychiques fréquentes et beaucoup moins sévères.
F - Le trouble anxieux généralisé (TAG)
Il se caractérise par un état d’anxiété permanente et de soucis excessifs, durant au moins 6 mois. Cette anxiété n’est pas liée à un objet ou à une situation précise. Il s’agit d’une inquiétude excessive de tous les moments de la vie quotidienne. La personne a des difficultés à contrôler cette inquiétude importante.
Les symptômes physiques associés sont une tension motrice, une hypervigilance, la bouche sèche, des sueurs, des nausées, des diarrhées, des tremblements, des contractions, des céphalées...
G - Les phobies
Les phobies se caractérisent par une peur irraisonnée, intense et spécifique à un objet ou une situation. Elles sont très fréquentes dans la vie psychique normale, mais deviennent pathologiques lorsque leur intensité est forte et retentit sur la vie de la personne.
Les phobies s’accompagnent de conduites d’évitement de l’objet ou de la situation, et/ou de conduites qui rassurent, dites conduites contraphobiques : par exemple, agoraphobie, phobies sociales, dysmorphophobie…
Aujourd’hui, ces maladies, même pour les plus graves d’entre elles, ne sont pas une fatalité et les malades ne sont pas des personnes dangereuses si elles sont soignées. Les chances de rémission augmentent si la personne bénéficie de soins de réhabilitation. Ceux-ci visent à promouvoir le rétablissement de la personne en s’appuyant sur ses capacités.
On parle aussi d’« empowerment ». C’est un processus individuel, non linéaire, qui ne signifie pas guérison, mais le fait de retrouver la capacité à faire des choix pour soi.... Il vise à réacquérir le pouvoir d’agir sur sa propre vie grâce à ses compétences, à retrouver un sens à sa vie, à se sentir à nouveau appartenir à un groupe et membre à part entière de la société.
Voir Les thérapies nouvelles
3.2 - Approches scientifiques de la schizophrénie
On prendra ici l’exemple de la schizophrénie, trouble souvent très handicapant, faisant l’objet de recherches qui modifient profondément le regard sur cette maladie.
Les progrès de l’imagerie médicale et de la génétique ont permis récemment de faire de grands progrès dans la compréhension des mécanismes neurologiques et génétiques à l’origine des maladies psychiques.
3.2.1 - Origines probables de la schizophrénie
Source INSERM
La schizophrénie est une maladie dont l’origine est plurifactorielle. Son développement résulterait d’une interaction entre gènes et environnement, suggérant qu’il existe une vulnérabilité génétique précipitée par des facteurs environnementaux.
La part de la génétique
Il existe a priori deux types de prédisposition génétique à la maladie : d’une part, certaines variations génétiques ont été identifiées comme étant associées à un léger surrisque de développer la maladie en cas d’exposition à des facteurs de risque environnementaux. Cependant, leur impact modeste rend leur identification difficile. D’autre part, quelques mutations ponctuelles rares ont été décrites comme ayant un impact majeur sur le risque de développer une schizophrénie. Elles toucheraient préférentiellement des gènes jouant un rôle dans la plasticité neuronale, en partie communs avec ceux impliqués dans d’autres troubles du neurodéveloppement.
Pris globalement, le rôle de la génétique reste donc modéré : la fréquence de la maladie reste 10 fois plus faible que la fréquence à laquelle ces facteurs de vulnérabilité génétique sont retrouvés au sein de la population générale. Chez des jumeaux qui possèdent le même patrimoine génétique, lorsque l'un est atteint de schizophrénie, le risque que le second développe la maladie n’est que d’environ 40%.
Une composante environnementale, avec un rôle établi du stress et du cannabis
Différents facteurs environnementaux pourraient favoriser le développement de la maladie, notamment au cours de la période critique que constitue l’adolescence et le début de la vie adulte.
Des travaux suggèrent aussi que certains éléments influençant le développement cérébral (comme des problèmes au cours du développement fœtal en raison d’incompatibilité rhésus ou de complications liées à une grippe contractée pendant la grossesse) augmentent le risque ultérieur de schizophrénie, mais l’effet reste assez faible. Les troubles précoces du développement ont ainsi été identifiés comme facteurs favorisant l’apparition d’un trouble schizophrénique.
Deux autres paramètres constituent, eux, des facteurs de risque bien établis précipitant l’apparition de troubles psychotiques :
- le premier correspond au stress, qui est décrit comme pouvant altérer différents mécanismes biologiques (neurogenèse, activité des facteurs de croissance et survie des neurones…) au niveau de plusieurs structures cérébrales (hippocampe, cortex préfrontal, amygdale…). Il expliquerait ainsi l’incidence plus élevée de la maladie en milieu urbain ou parmi les sujets ayant eu un parcours de migration, notamment au cours de l’enfance et de l’adolescence. Ces associations ont été notamment bien décrites par les études issues du projet européen European network of national schizophrenia networks studying gene-environment interactions, dont le but était d’étudier les déterminants génétiques et environnementaux de la schizophrénie et les facteurs déterminant l’émergence des troubles chez des sujets à très haut risque, présentant des symptômes atténués.
- le second correspond à la consommation de substances psychogènes et particulièrement le cannabis : le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) perturberait la maturation cérébrale en agissant sur les récepteurs qu’il active, nombreux au niveau des zones du cerveau impliquées dans les pathologies psychiatriques, et particulièrement dans les régions où la plasticité est importante à l’adolescence. Ainsi, la consommation de cannabis doublerait le risque de schizophrénie, mais avec une grande hétérogénéité en fonction des individus. Cet effet dépendrait de la dose, de la teneur du produit en THC, de la durée d’utilisation et de l’âge d’exposition. Des travaux conduits à l’Inserm ont montré que les consommateurs les plus sensibles aux effets psychotiques du cannabis présentent des variants génétiques particuliers.
Enfin, d’autres aspects liés à l’hygiène de vie joueraient aussi un rôle significatif : qualité du sommeil, nutrition, apports en facteurs neurotrophiques (favorisant la croissance et la survie des neurones) comme les folates.
3.2.2 - Recherche de marqueurs biologiques de la schizophrénie
Dans un rapport adopté le 20 novembre 2019, l’Académie Nationale de Médecine a procédé à un recensement des recherches les plus récentes concernant « les biomarqueurs en psychiatrie », pas supplémentaire dans la reconnaissance des pathologies psychiatriques comme des maladies à part entière. En ce qui concerne la schizophrénie, plusieurs types de marqueurs sont identifiables :
La prévalence du trouble vie entière en population générale est de l% passant à l0% chez un apparenté de premier degré. Les études d'association pangénomique (GWAS) montrent qu'un millier de gènes divers sont porteurs de la vulnérabilité à cette pathologie. La microdélétion 22qll et les mutations affectant SHANK3 jouent un rôle dans la transmission synaptique. Surtout, il existe une grande variabilité du nombre de copies de gènes pouvant concerner cette pathologie: l5qll.2, 15q13.3, 22q12, CHRNAT, Neurexine 1. Les mutations des récepteurs glutamatergiques NMDA (GRIN2A, GRIN2B) et métabotropiques mGLUR5 (GRM5, PPEF2) sont communes à la schizophrénie et à l'autisme Au plan épigénétique, la méthylation de certains gènes expliquerait l'évolution différente des personnes à risque particulièrement au moment d'une éventuelle transition psychotique actant le passage d'une vulnérabilité à une pathologie.. Ces modifications concernent aussi certaines voies biologiques (proline, méthionine, interleukine). Citons, enfin, le rôle potentialisateur d'un rétrovirus humain endogène (HERV) sur le gène PRODH.
Biomarqueurs de neuroimagerie (IRM)
Il est décrit un défaut de gyrification hémisphérique résultant des vagues d'amincissement du cortex lors du développement cérébral à l'adolescence : il porte sur le réseau hippocampo-frontal, les aires associatives pariétales, temporales et le cervelet.
Un dysfonctionnement dopaminergique (DA) est révélé par des anomalies des taux d'acide homovanillique (FIVA) dans le LCS. L'hyperdopaminergie sous-corticale mésolimbique rendrait compte des signes positifs et l'hypodopaminergie frontale sous-tendrait les signes négatifs. Des dysfonctionnements sérotoninergiques (5-HT) et glutamatergiques (GLU) sont également observés avec en particulier un déséquilibre entre les systèmes glutamatergique et gabaergique (GABA) . Les données épidémiologiques (risque de trouble schizophrénique accru chez les adolescents consommateurs de cannabis ) disent l'implication des endocannabinoides dont la libération est influencée par l'hypercortisolémie lors du stress.
Biomarqueurs de la neuroinflammation
Axe hypothalamo-hypophysaire, Stress oxydant, Métabolisme lipidique Des agents infectieux (grippe, rubéole, toxoplasmose, HSV2...) sont décrits comme facteurs de risque ultérieur de maladie du fait de leur présence en période périnatale. Ils activent, via la microglie, le système de l'inflammation et la production de cytokines impactant le neurodéveloppement. Les interleukines IL-1béta et lL-2, agissent sur le système dopaminergique et IL-6 sur les neurones 5-HT avec un effet apoptotique. Cela représenterait « la seconde frappe » de la genèse de Ia schizophrénie venant sur un terrain à vulnérabilité génétique (« première frappe »). Le stress, avec dérégulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et hypercortisolémie, est une autre forme de « seconde frappe ». Adossé à un terrain inflammatoire, le stress oxydant implique plusieurs éléments : la baisse du métabolisme des monocarbonés (folates), l'augmentation de l'homocystéine (agent pro-oxydant) et le dysfonctionnement du système redox (régulation du glutathion) ; il est en outre inducteur d'une déficience en acides gras polyinsaturés essentiels oméga-3. De plus, sont rapportées des altérations du microbiote. La minocycline qui s'oppose aux effets de la neuroinflammation et du stress oxydant, l'aspirine et les inhibiteurs de la cyclooxygènase-2 (COX-2) se sont révélés susceptibles d'une action thérapeutique. Des biomarqueurs précoces chez des sujets à haut risque à partir d'un prélèvement sanguin pourraient être proposés : un panel de 25 molécules impliquées dans la réponse inflammatoire et immunitaire aurait une valeur prédictive d'évolution psychotique avec une sensibilité de l'ordre de90%o (cohorte ICARR). »
3.2.3 - L’observation de dysfonctionnements dans les connexions du cerveau
Octobre 2017
Depuis plusieurs décennies, la schizophrénie représente un axe majeur de recherche, notamment en neuro-imagerie. Malgré cela, les phénomènes biologiques en cause ne sont encore que partiellement compris. Les résultats d’une récente étude publiée dans la revue Molecular Psychiatry apportent des réponses en révélant une perturbation de la communication cérébrale.
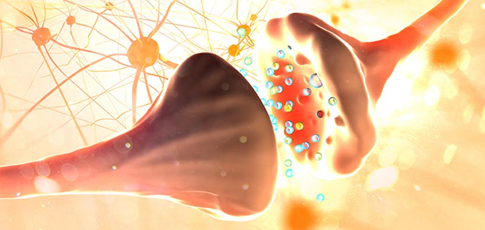
Environ 40 ans après la découverte d’anomalies dans le cerveau des patients schizophrènes, tous les scientifiques s’accordent à dire que la maladie est due à une perturbation de l’ensemble du système de communication du cerveau.
Une étude parue le 17 octobre 2017 dans la revue Molecular psychiatry se base sur la théorie selon laquelle la schizophrénie est due à un problème de câblage au niveau de 2 zones clés du cerveau impliquées dans la personnalité, la prise de décision et la perception auditive : le lobe préfrontal et le lobe temporal. Selon Sinead Kelly, co-auteur de l’étude, c’est la présence de « câbles effilochés » un peu partout qui provoquerait la maladie. Les chercheurs ont donc orienté leurs travaux sur l’analyse du tissu cérébral chargé de la communication entre les neurones constituant ces structures : la « matière blanche ». En effet, de nombreuses études précédentes ont déjà mis en évidence des perturbations de la matière blanche entre un cerveau sain et un cerveau atteint de schizophrénie. Ces découvertes impliquaient généralement le lobe préfrontal, le lobe temporal ainsi que les fibres nerveuses assurant la connexion entre ces deux régions. […]
L’étude est d’envergure mondiale et représente à ce jour la plus vaste sur le sujet. Sinead Kelly déclare « Notre étude aidera à mieux comprendre les mécanismes de la schizophrénie, une maladie mentale qui non traitée mène souvent au chômage, à l’itinérance, à la toxicomanie et même au suicide ». Les chercheurs espèrent que leurs travaux mènent à l’identification de biomarqueurs utiles dans l’évaluation de la réponse aux traitements des patients.
Tandis que les études menées jusque-là incluaient aux alentours de 100 schizophrènes, les scientifiques ont cette fois-ci analysé les données de 1 963 patients atteints de schizophrénie et de 2 359 individus sains provenant du monde entier. Pour cela, les données de 29 études internationales ont été regroupées grâce au réseau ENIGMA (Enhancing Neuro imaging Genetics through Meta analysis) de la Keck School of Medicine. Les chercheurs ont examiné les données d’une forme d’IRM appelée « imagerie en tenseur de diffusion » permettant de cartographier in vivo la microstructure et l’organisation des tissus. Ces analyses ont permis aux scientifiques de localiser les zones problématiques dans le système de communication du cerveau. Ces résultats confirment le concept d’une dysconnectivité structurelle globale dans la schizophrénie.
3.2.4 - L’observation d’une atrophie d’une structure du cerveau à l’adolescence
28 Juin 2019
Pour mieux comprendre comment survient cette maladie psychiatrique, des chercheurs suisses ont suivi, pendant 18 ans, des patients ayant une prédisposition génétique. Leurs résultats montrent que ceux qui développent les symptômes de la maladie ont un hippocampe qui s’atrophie à l’adolescence.
La schizophrénie est, dans certains cas, liée à une anomalie sur le chromosome 22[1]
. Cependant, toutes les personnes présentant cette anomalie génétique ne développent pas forcément la maladie psychiatrique. Les études montrent que 30% des personnes ayant ce syndrome développent la schizophrénie.
Pour mieux comprendre ce qui se cache derrière ces 30%, les chercheurs de l’université de Genève ont suivi cliniquement, pendant 18 ans, 275 personnes dont :
- 130 personnes normales (groupe contrôle) ;
- 145 personnes présentant le syndrome de la délétion 22q11.
Tous les trois ans, des IRM ont été réalisées sur l’ensemble des participants, âgés de 6 à 35 ans, afin d’observer et de mesurer l’ensemble de leurs structures cérébrales, et notamment leur hippocampe.
L’hippocampe est une structure paire du cerveau jouant un rôle clef dans la mémoire, l’attention, les émotions et la navigation spatiale. C’est le siège de la production de nouveaux neurones tout au long de la vie et il joue un rôle primordial dans la mémoire des événements (mémoire explicite).
« Il est aujourd’hui connu que la schizophrénie est liée à l’hippocampe, une zone du cerveau complexe qui réalise énormément de processus simultanément, ayant trait à la mémoire, à l’imagination et aux émotions » précise Stephan Eliez, professeur au Département de psychiatrie de la Faculté de médecine de l’UNIGE.
Les chercheurs ont mis en évidence que les patients ne développant pas la maladie ont un hippocampe plus petit que la norme, mais qui suit malgré tout une courbe de développement similaire aux personnes n’ayant pas le syndrome de délétion. Cependant, chez les patients ayant développé les symptômes de la maladie psychiatrique (53 parmi les 145 patients ayant la délétion 22q11), l’hippocampe voit son volume se rétrécir très nettement et notamment la sous-partie CA2/3. « Cette sous-partie joue un rôle crucial dans le travail de mémorisation et paraît plus forte que les autres sous-parties. » relève Stephan Eliez.
En suivant les patients âgés de 6 à 35 ans pendant 18 ans, les chercheurs révèlent que c’est vers l’âge de 17-18 ans que les personnes ayant des symptômes de la maladie (délires, hallucinations) subissent une atrophie de leur hippocampe.
Contre toute attente, c’est la zone CA2/3 qui diminue fortement alors qu’elle avait jusqu’ici réussi à se développer normalement. Chez les patients ayant l’anomalie chromosomique mais ne développant pas les symptômes de la schizophrénie, cette zone ne s’atrophie pas.
Dans l’état actuel des connaissances, les scientifiques ne peuvent formuler que des hypothèses pour expliquer cette rupture à l’adolescence.
Comme les personnes ayant le syndrome 22q11 ont un hippocampe plus petit, ils doivent compenser sa taille par une activité accrue de ses neurones fonctionnels.
A l’adolescence, et sous l’influence de certains facteurs propres à cette période (stress, consommation de cannabis, modification hormonale, neuro-inflammation, etc.), cette hyperactivité provoquerait une sécrétion excessive de glutamate (un neurotransmetteur) qui finirait par être toxique pour l’hippocampe.
Les enjeux de cette découverte sont importants et les chercheurs vont désormais travailler sur le développement de moyens thérapeutiques (approche pharmacologique, thérapie de gestion de stress, régime alimentaire spécifique) permettant de prévenir l’atrophie de l’hippocampe à l’adolescence.
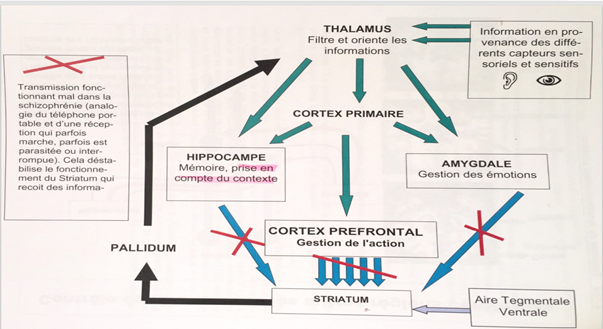
[1] La délétion 22q11 (ou microdélétion 22q11) est une affection due à la perte d’un petit fragment du chromosome 22. Elle se manifeste par diverses anomalies qui ne sont pas toutes présentes chez une même personne. Les plus fréquentes sont des malformations du cœur, une fente du palais et des difficultés d’apprentissage. Dans certains cas les manifestations de la délétion 22q11 peuvent être tellement légères ou peu spécifiques, qu’elles passent inaperçues.
3.2.5 - L’observation des déformations de l’amygdale
L’amygdale est une partie du cerveau qui doit son nom à sa forme rappelant celle d’une amande. Les deux amygdales sont situées tout près de l’hippocampe, dans la partie frontale du lobe temporal. L’amygdale joue un rôle dans notre capacité à ressentir et percevoir chez les autres certaines émotions. Le cortex préfrontal est le siège de différentes fonctions cognitives dites supérieures (le langage, la mémoire de travail, le raisonnement, et les fonctions exécutives). La région limbique a un rôle dans les fonctions exécutives primaires (digestion, respiration, apprentissage etc.) mais c’est aussi une zone cérébrale considérée comme le siège des émotions.
Site du Commissariat à l’Energie Atomique
Une équipe de recherche en psychiatrie au CEA-Neurospin, avec l’Institut Mondor de Recherches Biomédicales (INSERM) et les hôpitaux universitaires Henri-Mondor, AP-HP, a montré qu’un variant génétique associé à de multiples troubles psychiatriques altère un réseau préfronto-limbique, ce qui augmenterait le risque de développer la schizophrénie ou un trouble bipolaire. Les résultats de cette étude ont été publiés en ligne le 2 octobre 2017 dans Journal of Neuroscience.
Les auteurs ont étudié une variation allélique du gène SNAP25, impliquée dans la neurotransmission et associée à la schizophrénie, au trouble bipolaire mais également à l’hyperactivité/trouble de l'attention
Les chercheurs ont combiné une étude d’association génétique chez 461 patients atteints de schizophrénie, une construction génétique in vitro et une approche dite d’« imagerie génétique1» dans deux cohortes, la première comprenant 71 sujets dont 25 patients bipolaires, la seconde comprenant 121 sujets sains. . […]
Les résultats révèlent que la variation du gène SNAP25 change l’expression de la protéine associée dans le cerveau, ce qui impacterait le traitement de l’information entre les régions cérébrales impliquées dans la régulation des émotions. En lien avec ce mécanisme, l’étude d’imagerie génétique, combinant IRM anatomique et fonctionnelle de repos, montre que dans les deux cohortes, le variant à risque est associé à un plus grand volume d’une zone cérébrale, l’amygdale, et une connectivité fonctionnelle préfronto-limbique altérée.
Cette étude confirme l’existence d’un facteur de risque commun à la schizophrénie et au trouble bipolaire : la variation du gène SNAP25. Ces maladies très fréquentes touchent chacune 1 % de la population adulte et sont handicapantes.
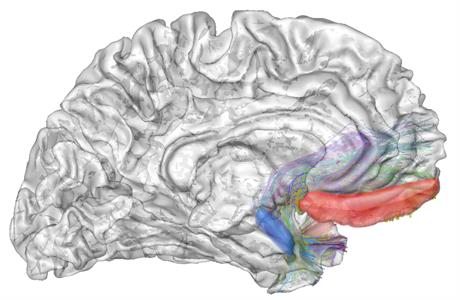
Réseau préfronto-amygdalien associé à la variation de SNAP25 visualisé en tractographie par IRM de diffusion. L’imagerie génétique consiste à comparer grâce à l’imagerie (ici l’IRM) deux populations de sujets qui ne diffèrent que par leur terrain génétique (ici la variation de SNAP25).
(Crédit: Josselin Houenou /BrainVisa/Connectomist 2.0)
En changeant l’expression de la protéine SNAP25, le traitement de l’information entre les régions cérébrales impliquées dans la régulation des émotions est bouleversé.
L’imagerie médicale montre notamment que les porteurs de la version à risque du gène SNAP25 ont une amygdale plus volumineuse, et une connectivité neuronale des régions préfrontale et limbique altérée.
Posséder la version à risque du gène SNAP25 est donc un facteur génétique augmentant la vulnérabilité aux troubles bipolaires et à la schizophrénie.
Caractériser les versions des gènes associées à une maladie neuropsychiatrique est un défi majeur pour mieux comprendre les mécanismes à l’origine de la mise en place des symptômes.
Selon les chercheurs, cette étude multi-niveaux (génétique, imagerie cérébrale, analyse de tissus cérébraux post-mortem) apporte des preuves solides en montrant qu’une version du gène SNAP25 altère le développement et la plasticité du réseau préfrontal-limbique.
En découvrant le lien entre génétique et apparition de la schizophrénie ou de troubles bipolaires, les scientifiques espèrent ouvrir la voie au développement de traitements personnalisés.
En effet, l’étude du génome d’un patient permettra de :
- Caractériser finement ses prédispositions à une maladie neuropsychiatrique ;
- Mettre en place des traitements préventifs pour empêcher l’apparition de la maladie ou retarder sa mise en place ;
- Optimiser les chances de guérison en adaptant plus précisément les traitements pharmaceutiques et les psychothérapies.
3.3 - Les thérapies permettent des progrès pouvant conduire au «Rétablissement»
3.3.1 - Les traitements médicamenteux
Le traitement de la schizophrénie par neuroleptiques a un effet symptomatique immédiat, mais également partiellement curatif. Les neuroleptiques améliorent l’évolution de la schizophrénie. Le traitement prévient également les rechutes et doit donc être pris en continu. Le contrôle de la maladie passe par l’observance du traitement. La définition classique des neuroleptiques est celle donnée par Delay et Deniker ; elle associe les différents critères :
- Création d’un état d’indifférence psychomotrice
- Diminution de l’agressivité et de l’agitation
- Réduction des psychoses
- Production d’effets neurologiques et végétatifs
- Action sous corticale dominante (Source : site Ma schizophrénie)
De nouveaux médicaments, les antipsychotiques atypiques, sont plus récemment apparus, souvent plus efficaces et avec des effets secondaires différents (prise de poids plus importante, diabète mais moins de syndromes extra-pyramidaux…)
Les médicaments donnent de nombreux effets secondaires mais sont en général indispensables au contrôle de la maladie. Les neuroleptiques classiques et les antipsychotiques atypiques existent sous forme orale en prise quotidienne ou pour plusieurs sous forme retard injectable (effet de 1 à 3 mois) qui facilite le respect des prescriptions médicales par le malade.
3.3.2 - Les thérapies complémentaires des traitements médicamenteux
Ces dernières années ont démontré l’efficacité de thérapies aux effets très positifs fondées sur la compréhension des origines des troubles psychiques :
L’électroconvulsivothérapie (ECT)
L’ECT est une stimulation électrique appliquée sur le cortex cérébral à travers le scalp sous anesthésie générale et curarisation. Ce traitement est efficace dans un certain nombre d’états schizophréniques aigusque les médicaments seuls n’arrivent pas à apaiser.
La stimulation magnétique transcrânienne (ou TMS)
Elle reste encore du domaine de la recherche. Il est cependant montré que guidée par l’imagerie cérébrale, cette modalité de stimulation peut traiter certains symptômes schizophréniques, par exemple les hallucinations.
Les soins de réhabilitation psychosociale
Source : Société Québécoise de la Schizophrénie (SQS)
Dans le traitement de la schizophrénie, la psychothérapie va de pair avec la rééducation et la pharmacothérapie. La schizophrénie frappe le plus souvent les jeunes gens, dans les années au cours desquelles ils développent normalement les compétences nécessaires pour vivre de façon autonome. Quand la maladie s'installe, elle perturbe cette évolution. Les interventions psychosociales visent à permettre aux malades d’acquérir ces compétences indispensables. Elles les aident à se fixer des objectifs dans les aspects les plus importants de leur vie et à travailler à leur réalisation. Quand la phase aiguë de la maladie est passée, de nombreux patients ont besoin d’aide pour reconstruire leur vie et utiliser au mieux leurs capacités, ce qui leur permettra de retourner aux études, de travailler, de développer des relations personnelles et des rapports sociaux. On ne parle pas ici d’une psychothérapie en profondeur qui pourrait bousculer les défenses déjà fragiles de la personne mais d’une psychothérapie centrée sur le réel et les difficultés concrètes auxquelles la personne doit faire face.
Il existe plusieurs formes de thérapies, dont les thérapies individuelles, de groupes ou familiales. Diverses approches sont offertes selon les besoins de la personne.
- Thérapie motivationnelle : vise à renforcer la motivation et l'engagement vers le changement.
- Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) : met l’accent sur les problèmes actuels et vise à modifier les pensées et les comportements problématiques.
- Psychoéducation : propose de l'information adaptée (sur la maladie, les traitements, le stress, l’alcool et les drogues, etc.) pour aider la personne à mieux comprendre ce qu’elle vit, ses réactions et ses émotions.
- Réadaptation psychosociale : cible les forces et les habiletés de la personne afin qu’elle reprenne le contrôle de sa vie et se réinsère progressivement dans la communauté.
- Réadaptation vocationnelle : vise à élaborer un projet d’études ou de travail à partir des aspirations et des intérêts de la personne en tenant compte de ses forces, de ses limites et des possibilités du milieu.
3.3.3 - L’objectif, qui devient réalité dans un nombre croissant de cas, est le rétablissement en santé mentale
Le mouvement défendant l’idée de rétablissement a été largement porté, d’abord aux États-Unis et plus récemment en France, par des personnes vivant avec un trouble psychique1.
Cette vision suscite un intérêt croissant des professionnels de la santé mentale.
Dans la société, l’idée que des personnes ayant un trouble psychique peuvent se rétablir est peu répandue. On pense trop souvent, par exemple, que ces personnes ne peuvent pas travailler, ou encore qu’elles doivent renoncer à fonder une famille. Ce sont des idées reçues.
Ces a priori empêchent de voir que ces personnes peuvent, au fil du temps, trouver en elles-mêmes et autour d’elles les ressources pour ne pas être débordées par les symptômes et pour mener leur vie comme elles le souhaitent.
1 Le rétablissement des troubles psychiques, PSYCOM.
I. Qu'est ce que le rétablissement ?
Le rétablissement correspond à un cheminement de la personne, dans la durée, pour reprendre le contrôle de sa vie et trouver sa place dans la société.
Il s’agit de retrouver une citoyenneté pleine et entière après avoir réussi à contrôler ou vivre avec les symptômes. Le rétablissement est bien plus que la maîtrise des symptômes, c’est aussi et d'abord retrouver une estime de soi, des rôles valorisants et un bien-être.
Le rétablissement n’est pas la guérison, ni même la stabilisation des symptômes. Ce n’est pas non plus l’absence de handicap qui peut rester bien présent. Ce n’est pas la capacité et encore moins l’obligation à vivre ou travailler « comme tout le monde ».
La notion de rétablissement s’articule autour de cinq principes clés (Samantha Copeland, 1997) :
- L’espoir: la personne qui connaît des difficultés de santé mentale se rétablit autant que possible, atteint un état de rétablissement stable et entreprend alors de réaliser ses rêves et ses objectifs.
- La responsabilité personnelle : il incombe à chacun, avec l’aide des autres, d’agir et de faire ce qu’il faut pour continuer à aller bien.
- L’éducation : il s’agit d’apprendre tout ce que l’on peut sur ce que l’on éprouve afin de pouvoir prendre les bonnes décisions concernant tous les aspects de la vie.
- Le plaidoyer pour soi-même : il s’agit de savoir communiquer avec les autres de façon efficace afin d’obtenir ce dont on a besoin, ce qu’on veut et ce qu’on mérite.
- Le soutien : en travaillant sur son propre rétablissement, savoir accepter le soutien d’autrui et savoir aider autrui aide à se sentir mieux.
II. Les facteurs favorisant le rétablissement
Le Dr Alexis Erb les décrit ainsi :
- Des structures sanitaires accompagnantes (hôpitaux de jours, CMP, CATTP, CESAME) et des praticiens formés(psychiatres, psychologues, neuro-psychologues, infirmiers, psycho-motriciens, médecins de famille etc.)
- Des hébergements et logements accompagnés (foyers thérapeutiques, centres d’accueil, appartements thérapeutiques, baux glissants etc.)
- Un accès au travail via des institutions visant la réadaptation par le travail (Établissements et Services d’aide par le travail [ESAT], entreprises adaptées, des aides à la recherche d’emploi, à la ré-orientation etc.)
- Des aides juridiques et économiques (allocation aux adultes handicapés, mesures de protection etc.)
- Des accompagnants dans la vie sociale (assistants sociaux, SAVS [Services d’aide à la vie sociale] et SAMSAH [Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés]).
- Un tissu social accueillant (associations, GEM [Groupes d’entraide mutuelle])
La proportion de malades susceptibles de parvenir au rétablissement croit. Elle a été évaluée par plusieurs études :
- 20 à 30% (40 à 60% partiellement rétablis) (Hopper et al 2007)
- 40 % (AlAqeel et al Harv Rev Psychiatry 2012)
- 13,5 % (Jääskeläinen et al Schizophr Bull 2013)
- 37.9% (25.2% en utilisant les critères les plus strictes) (Lally et al, British Journal of Psychiatry, 2017)
Les personnes atteintes de troubles psychiques ayant atteint un degré satisfaisant de « rétablissement » sont souvent à même de vivre une vie professionnelle normale ou d’être autrement utile à la société.
4 - Gestion pénale des malades psychiques
Ce chapitre a été écrit avec le concours de l’association d’avocats pénalistes, de Prison Insider et d’Avocats pour la Défense des Droits des Détenus. Il a pour objet principal de signaler des arrêts de jurisprudence importants.
4.1 - Bref rappel du droit de l’irresponsabilité pénale
4.1.1 - Législation sur la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux
4.1.1.1 - Les textes établissant l’irresponsabilité pénale
A. Principe
Selon l'Article 122-1 du Code pénal :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes
« La personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ou en fixe le régime » .
B. Exceptions
Il existe néanmoins une exception depuis la loi du 24 janvier 2022. En effet, désormais, L'article 122-1-1 du Code pénal, dispose que « Le premier alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission. »
En ce qui concerne la simple altération du discernement, l'article 122-1-2 précise que la diminution de peine prévue au second alinéa de l'article 122-1 n'a pas vocation à s'appliquer lorsque "lorsque cette altération résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives." .
Alors que la Jurisprudence constante admettait auparavant qu’une prise volontaire de substances psychotropes pouvait entrainer une abolition du discernement de l’auteur au moment des faits reprochés et par conséquent son irresponsabilité pénale, le retentissement médiatique de l’affaire Sarah HALIMI a provoqué une réaction de la société civile et du législateur.
En effet, un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 avril 2021 (n°20-80.135) avait retenu l’irresponsabilité pénale de l‘auteur ayant été pris de bouffées délirantes aigües au moment des faits en raison d’une consommation volontaire de cannabis. Les experts psychiatres avaient retenus l’abolition totale du discernement.
Face aux vives et nombreuses critiques de cette décision, le législateur a dès lors écarté l’irresponsabilité pénale pour les auteurs d’infractions ayant consommés volontairement des substances psychotropes (Alcool / stupéfiants).
C. Précisions procédurales
La loi du 24 janvier 2022 insère au deuxième alinéa de l’article 706-120 la diposition suivant « Lorsque le juge d'instruction, au moment du règlement de son information, estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l'application du même article 122-1 ; si la personne n'est pas déclarée pénalement irresponsable, le dossier est renvoyé à une audience ultérieure pour être examiné au fond conformément aux dispositions relatives aux jugements des crimes ou des délits. »
Suite à la publication d'un décret d'application discuté, le garde des Sceaux a apporté des précisions utiles en rappelant que l'expression "résulte au moins partiellement de son fait" implique que le « le comportement à l’origine de l’abolition du discernement, faisant objet d’une divergence d’expertises, doit émaner d’une personne qui disposait d’une volonté suffisante et dont le discernement n’était pas déjà aboli. Si tel était le cas[…], notamment si l’abolition du discernement résulte de l’arrêt du traitement d’une personne déjà atteinte d’une grave pathologie mental – ce comportement ne pourra pas justifier le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 706-120 du code de procédure pénale ».
D. Réflexions sur le concept d'irresponsabilité pénale en droit français
Analyse :
- Le « trouble mental » inclut les troubles de la volonté et de l’intelligence et est plus large que le terme de démence employé dans l’ancien article 64.
- Disparition du discernement : perte de la capacité de comprendre et perte de la capacité de vouloir
- Existence du trouble mental au moment des faits
- En cas de trouble mental postérieur aux faits, si ce trouble mental survient alors qu’une procédure est en cours, l’action publique est suspendue.
Problème :
L’état des connaissances scientifiques ne permet pas de distinguer entre abolition et altération, ni de savoir dans quel état se trouvait la personne « au moment des faits »
Référence : thèse du Dr Christophe PERRAULT pour le diplôme de docteur en médecine, spécialité psychiatrie intitulée : « Abolition et altération du discernement au sens de l’Article L122-1 du Code pénal) quelles définitions, quels diagnostiques psychiatriques »
Résumé : « L'expertise psychiatrique pénale de responsabilité constitue une interface majeure entre soins et justice et l'article 122-1 du Code Pénal en est le pivot central. La loi prévoit que l'expert rende sa décision en discutant la qualité du discernement de l'auteur présumé d'infraction pénale. Ce terme ne bénéficie cependant d'aucune définition consensuelle qu'elle soit juridique ou médicale. S'ajoute à ce constat une possible sur-pénalisation des sujets relevant de l'alinéa 2 de cet article de loi. Après avoir interrogé le concept de discernement et proposé une définition s'appuyant sur la psychopathologie classique et les apports plus récents des neurosciences, l'objectif de ce travail est de déterminer quels diagnostics psychiatriques sont associés à l'abolition et à l'altération du discernement. Six cent un rapports d'expertises psychiatriques pénales ont été rétrospectivement inclus. Une analyse univariée suivie d'une régression logistique multivariée ont été conduites. L'abolition du discernement était associée au diagnostic de trouble psychotique, l'altération aux diagnostics de trouble psychotique, de trouble de personnalité et de retard mental. » http://thesesante.ups-tlse.fr/280/
4.1.1.2 - Conséquences de l’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental
La loi du 25.02.2008 a créé les articles 706-119 et suivants du code pénal qui ont instauré une procédure de jugement pendant laquelle la juridiction déclarera :
- Qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits reprochés ;
- Mais que le mis en cause est irresponsable car son discernement est aboli
- Qu’il sera soumis à une ou plusieurs mesures de sûreté (hospitalisation complète sous contrainte et interdictions)
- Que sa responsabilité civile est maintenue
L'hospitalisation complète (article 706-135 du code de procédure pénale)
"Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code."
Les mesures de sûreté (article 706-136 du code de procédure pénale)
"Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :
1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
5° Suspension du permis de conduire ;
6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.
Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision."
4.1.2 - Jurisprudence sur la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux
4.1.2.1 - Reconnaissance de l’irresponsabilité en cas de prise de produits stupéfiants ou d’alcool sous certaines conditions
La jurisprudence classique de la Cour de cassation en matière de produits stupéfiants ou d’alcool retient que la personne ne peut s’exonérer de responsabilité en alléguant une telle consommation. En revanche, cette faute peut, dans des cas de maladies mentales sévères, ne pas pouvoir être opposée aux personnes.
Cour de cassation, ch. criminelle, Arrêt n°404 du 14 avril 2021 (20-80.135) (Affaire Sarah Halimi) : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/404_14_46872.html
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt précisant les conditions de reconnaissance de la responsabilité pénale prévue à l’article 122-1 du Code pénal. Elle devait juger de la responsabilité pénale d’un homme, accusé des faits de séquestration d’une famille et du meurtre d’une femme. La situation est aggravée par le caractère antisémite de l’acte. L’intéressé souffrait de bouffées délirantes aigües au moment des faits en raison d’une consommation régulière de cannabis. Deux des trois expertises psychiatriques réalisées concluent à l’abolition de son discernement.
La Cour de cassation se range à l’avis majoritaire des psychiatres. Elle déclare que "La notion d’abolition du discernement posée par l’article 122-1 du code pénal a été récemment précisée par la cour de cassation dans un arrêt du 14/04/2021 CCrim, CCass confirmant une décision de la Chambre de l’instruction déclarant irresponsable une personne qui avait commis un crime sous l’emprise du cannabis. La Cour a ainsi précisé que "Les dispositions de l’article 122-1 du code pénal ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition du discernement." (§29)
La Cour "justifie la décision de la chambre de l’instruction qui, pour retenir l’existence d’un trouble mental ayant aboli le discernement de la personne mise en examen, retient que celle-ci a agi sous l’emprise d’un trouble psychique constitutif d’une bouffée délirante d’origine toxique causé par la consommation régulière de cannabis, qui n’a pas été effectué avec la conscience que cet usage de stupéfiant puisse entrainer une telle manifestation."
"Le discernement de la personne mise en examen était aboli au moment des faits. Le récit de monsieur Z, corroboré par celui des membres de la famille, montre que ses troubles psychiques avaient commencé le 2 avril 2017, et ont culminé dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, dans ce que les experts psychiatres ont décrit de manière unanime comme une bouffée délirante."(§24)
Le fait que cette bouffée délirante soit due à la consommation régulière de cannabis « ne fait pas obstacle à ce que soit reconnu l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, puisqu’aucun élément du dossier n’indique que la consommation de cannabis par l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiant puisse entrainer une telle manifestation. » (§26)
" Il n’existe pas de doute sur l’existence chez monsieur Z au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes." (§27)
Des voix politiques se sont élevées contre ce jugement et sont à l’origine de propositions de lois et de l’annonce d’un projet de loi visant à exclure de la reconnaissance de l’irresponsabilité pénale les commettants ayant absorbé intentionnellement des substances nocives.
Quelques liens pour comprendre l'affaire :
- https://www.youtube.com/watch?v=izhduDNBciQNBciQ
- https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/lun-des-experts-psy-de-laffaire-sarah-halimi-se-defend-lirresponsabilite-penale-simposait
4.1.2.2 - Reconnaissance de l’abolition du discernement
La Cour de cassation a énoncé que, conformément à l'article 706-133 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction estime applicables les dispositions de l'article 122-1, 1er alinéa, du code pénal, elle rend une décision déclarant que la personne a commis les faits qui lui sont reprochés et qu'elle est irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. En revanche, la juridiction ne peut pas, avant de déclarer le prévenu irresponsable pénalement, énoncer que celui-ci est coupable des faits qui lui sont reprochés.
4.1.2.3 - Cassation d’un arrêt reconnaissant l’irresponsabilité pour vice de forme
Cour de Cassation, chambre criminelle, 03/03/2010
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000022136274
Le prévenu avait fait une tentative d’homicide volontaire sur des militaires de la gendarmerie. L’irresponsabilité pénale n’est pas retenue car le prévenu n’avait pas au préalable été mis en examen, il n’était que témoin assisté. Il résulte des articles 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale que les juridictions d'instruction ne peuvent prononcer une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qu'à l'égard d'une personne mise en examen. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare pénalement irresponsable un témoin assisté
4.1.2.4 - Rejet d’une demande de reconnaissance d’irresponsabilité
Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mars 2015 -n° 13-86954
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030331331 Le traumatisme crânien, dû à une conduite en état d’ivresse, ne pouvant, postérieur aux faits, justifier le refus de se soumettre à un test d’alcoolémie, la demande de reconnaissance d’irresponsabilité pénale est rejetée.
4.2 - L’expertise psychiatrique
Cette section, dont le plan est calé sur celui du code de procédure pénale et sur la chronologie de celle-ci, se propose de rappeler sommairement les principales règles avec un focus sur les circonstances particulières liées à la connaissance ou la supposition de troubles psychiques chez la personne mise en cause.
4.2.1 - Fiabilité de l’expertise de responsabilité pénale ?
En matière pénale, l’expertise de la personne atteinte d’une maladie psychiatrique est un élément déterminant de sa défense.
Les règles qui régissent cette expertise varient en fonction des modes de poursuites et du stade de la procédure autour de principes communs :
Objectifs :
- Déterminer si, au moment des faits le mis en cause présentait ou non une pathologie mentale et si en conséquence le tribunal ou la cour d’assises peut prononcer une peine.
- C’est au travers de l’intentionnalité du crime et du délit qu’est étudiée en droit pénal français l’irresponsabilité pénale
Principes :
- Tout crime est intentionnel
- Tout délit est en principe intentionnel sauf imprudence, négligence ou mise en danger
- Il n’y a pas de contravention s’il y a force majeure.
- Les exclusions de la faute => décrites en droit pénal français avec les causes objectives d’irresponsabilité et les causes subjectives d’irresponsabilité (cause présumée : la minorité et cause non présumée).
- Les causes objectives d’irresponsabilité : justification fondée sur une injonction ou justification fondée sur une permission (ex. le militaire, le policier)
- Les causes subjectives d’irresponsabilité : le trouble mental, l’erreur et la contrainte
- Le trouble mental : cause non présumée de non imputabilité
- l’auteur d’une infraction pénale peut être présumé irresponsable :
- Pour le mineur de moins de 13 ans : irréfragablement irresponsable du fait de sa présumée non-imputabilité
- Pour le mineur de plus de 13 ans : bénéfice d’une présomption d’irresponsabilité
Les méthodes des experts
L’expertise psychiatrique telle qu’elle fonctionne en France comporte des lacunes notables :
- Durée trop courte :
L’examen de la personne incriminée est souvent réduit, de l’ordre de 30 minutes.
- Intervention trop loin des faits :
Cet examen, alors que l’évaluation de la responsabilité pénale porte sur l’état de la personne au moment des faits, se déroule dans le temps à distance des faits, de l’ordre de 3 à 6 mois plus tard.
- Manque d’informations sur la personnalité
L’expert ne demande généralement pas la communication de son dossier médical lorsque celle-ci était déjà soignée pour des troubles psychiques avant les faits, ni ne cherche à collecter des informations historiques, familiales (en contactant la famille) et sociales qui permettraient à l’expert d’enrichir son analyse. S’il a connaissance d’un suivi psychiatrique préexistant aux faits, il cherchera éventuellement à se faire communiquer le dossier médical, mais celui-ci lui sera souvent refusé, en raison du secret médical. A noter que si l’expertise a été ordonnée par un juge d’instruction, l’expert doit obtenir de ses confrères l’information médicale dont il a besoin, ces derniers étant dans ce cadre dispensés de leur obligation de confidentialité.
L’expert ne sollicite ni les témoins des faits, alors que ceux-ci sont particulièrement importants dans la possibilité pour l’expert de répondre à la question : « Au moment des faits le mis en examen connaissait-il une abolition ou une altération partielle de son discernement ? ».
- Cadre matériel prégnant
L’entretien se déroule dans la cellule ou dans le parloir « avocats » lorsque la personne est détenue au moment de l’expertise, sous surveillance, ce qui ne favorise pas un « colloque singulier » entre le psychiatre et le patient examiné. Souvent, ce dernier ne comprend pas bien les enjeux de cette rencontre, s’affirmant indemne de toute maladie, ou adoptant une attitude hostile, absente ou sidérée, qui n’offre pas au psychiatre expert les conditions d’un véritable examen clinique. Il est donc important que l’expert mentionne l’échange qu’il a pu effectivement avoir avec le patient.
Intervenant généralement plusieurs mois (4 à 6 mois) après la commission des faits, l’expert psychiatre rencontre soit en prison, soit à son bureau, une personne qui n’est plus dans la phase de décompensation (ou crise) ayant présidé à l’acte délictueux. Selon le moment de cette rencontre, il la découvrira donc dans une phase de la maladie et un état psychologique qui peuvent être très différents ce qu’ils étaient au moment des faits, ne lui permettant pas d’apporter une réponse fiable à la question : « Au moment des faits le mis en examen connaissait-il une abolition ou une altération partielle de son discernement ? »
Il en va de même lorsque des soins psychiatriques ont été mis en place peu après les faits incriminés, ou l’incarcération, et que des praticiens ont travaillé avec le patient pour lui permettre de sortir de son état psychiatrique aigu. S’il adhère aux soins, le mis en examen apparaîtra alors comme disposant de ses facultés, permettant à l’expert de porter un jugement négatif quant à la gravité de sa maladie psychiatrique, ou même quant à son existence : en effet, il ne dispose pas en général du dossier médical (voir plus loin). De plus, le déni de la maladie, qui est un symptôme majeur de la psychose, conduira la personne examinée à se déclarer en bonne santé, ne mentionnant pas l’existence d’un suivi psychiatrique. L’inexistence de la maladie psychiatrique sera également souvent constatée s’il s’agit d’une première décompensation ou crise, dès lors que l’épisode aigu est passé. La personne peut en effet adopter pour un moment un comportement tout à fait « normal ».
Il est essentiel, pour l’avocat de la personne atteinte d’une maladie psychiatrique, de veiller particulièrement à cet acte de procédure.
- Manque de bases scientifiques de l’expertise
Il est frappant de constater la fréquence des expertises psychiatriques contradictoires.
Dans le même sens, sont aussi très éclairantes et préoccupantes les études[2] qui démontrent que la tendance de nombreux juges est d’appeler comme experts, régulièrement, les mêmes personnalités dont ils connaissent les prismes d’analyse et de jugement. Il sera donc important pour la défense du prévenu ou de l’accusé de demander et d’obtenir une (ou plusieurs) contre-expertises, en choisissant soigneusement le second expert. En matière criminelle, celle-ci ne peut être refusée par le magistrat instructeur.
- Obligation de la prise en compte des différentes expertises réalisées : Cass. crim., 15 mars 2023, no22-87318
Cette jurisprudence impose lorsqu’un ou plusieurs experts conclus à une abolition du discernement qu’ils soient entendus oralement à l’audience. Il est nécessaire que l’expert s’explique devant la Cour des raisons pour lesquelles il conclu à cette abolition.
Avis autorisés sur la crédibilité des expertises
Les expertises font régulièrement l’objet de critiques.
L’IGAS, dans un rapport de 2019 déclare « On ne peut que constater... la faible cohésion de la profession [des psychologues] au sein de laquelle certaines spécialités revendiquent une forte autonomie (les psychanalystes notamment)...
La déontologie n’est que peu enseignée durant le cursus universitaire. Le code de déontologie, non légalisé, demeure donc un code éthique indicatif. »
Dans la tribune « Pourquoi les psychanalystes doivent être exclus des tribunaux », la réalisatrice Sophie Robert explique « Dans les tribunaux, les psychanalystes peuvent aujourd’hui utiliser leur diplôme de psychologie ou de médecine (quand ils les ont) pour émettre des expertises qui n’ont aucun fondement médical ni scientifique, en violation complète avec le code de la santé publique. Les conséquences sociales peuvent être dramatiques : diagnostics fantaisistes et non reconnus par les nosographies internationales en vigueur, non prise en compte des besoins des personnes handicapées ou des malades psychiatriques, exclusion scolaire et sociale... »
4.2.2 - L’expertise psychiatrique obligatoire
4.2.2.1 - Pour certains crimes et délits
En application de l’article 706-47-1 du Code de Procédure Pénale (CPP), les personnes poursuivies du chef de l’une des infractions énumérées à l’article 706-47 du même code doivent obligatoirement être soumises à une expertise psychiatrique avant tout jugement au fond.
Encourt la cassation l'arrêt qui déclare coupable le prévenu des faits d’agression sexuelle sans qu’il n’ait été soumis à une expertise psychiatrique (Cass. crim., 23 sept. 2015, n°14-84842, Bull. crim., n°207, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031225896&fastReqId=1227304355&fastPos=1).
Il en est donc ainsi pour les infractions suivantes :
- Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus (articles 221-1 à 221-4 du Code Pénal) lorsqu'ils sont commis sur un mineur ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;
- Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus (articles 222-1 à 222-6 du Code Pénal) et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du Code Pénal) ;
- Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du Code Pénal;
- Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31-1 du Code Pénal ;
- Délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du Code Pénal ;
- Délit et crime de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévus au 1° de l'article 225-7 et à l'article 225-7-1 du Code Pénal ;
- Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du Code Pénal ;
- Délit de corruption de mineur prévu à l'article 227-22 du Code Pénal ;
- Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l'article 227-22-1 du Code Pénal ;
- Délits de captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation ou d'exportation, d'acquisition ou de détention d'image ou de représentation pornographique d'un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l'article 227-23 du Code Pénal ;
- Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévus à l'article 227-24 du Code Pénal ;
- Délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l'article 227-24-1 du Code Pénal ;
- Délits d'atteintes sexuelles prévus aux articles 227-25 à 227-27 du Code Pénal.
L’expertise peut être ordonnée :
- Dès le stade de l’enquête par le procureur de la République,
- Par le magistrat instructeur dans le cadre d’une ouverture d’information,
- Par la Juridiction de jugement avant de dire droit,
- Par le JAP avant la tenue d’un débat contradictoire ou d’une audience devant le TAP dans le cadre d’une procédure de requête en aménagement de peine.
Les règles relatives à la commission d’un expert, à l’étendue de sa mission et à une demande de contre-expertise diffèrent selon le magistrat ayant ordonné l’expertise. Elles sont précisées dans les développements suivants.
4.2.2.2 - Lorsque la personne poursuivie est un majeur protégé
Le majeur protégé est une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. En application de l’article 706-115 du CPP, les majeurs protégés poursuivis doivent obligatoirement être soumis avant tout jugement au fond à une expertise psychiatrique. Cette expertise a pour objet d’évaluer la responsabilité pénale de l’intéressé au moment des faits.
Habituellement, en début de la première audition de la mesure de garde-à-vue ou à l’occasion de l’audition libre, il est demandé à la personne poursuivie si elle fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire et la réponse est consignée sur PV. Dans l’affirmative, les articles 706-112 à 706-118 s’appliquent à tous les stades de la procédure (poursuite, instruction et jugement). Encourt la cassation, l’arrêt qui méconnait ces textes (Cass. crim. 14 oct. 2014, n°13-82584, Non publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029606575&fastReqId=70805670&fastPos=1).
L’article 706-115 du code de procédure pénale prévoit que toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique doit être soumise à une expertise médicale si elle fait l’objet de poursuites pénales. Cette expertise a pour but d’évaluer la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits. Le manquement à ce préalable obligatoire au procès par l’Autorité à l’initiative des poursuites empêche la personne d'être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale. Cela porte alors une “atteinte substantielle à ses droits”. En cas d’absence d’une expertise médicale, il est possible de demander la relaxe de la personne ou de présenter une requête en nullité. ( Cass. Crim. 16 déc. 2020, n°19 83.619, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2601_16_46142.html)
Dans le cas où la personne poursuivie était sous protection judiciaire alors que cette information était inconnue à l’ensemble des acteurs de la chaine pénale, une requête en révision d’une condamnation au motif que la juridiction de jugement ignorait, au jour du procès, que l’intéressé était placé sous le régime de la curatelle renforcée est recevable sans toutefois entrainer une suspension de l’exécution de la peine à ce stade de la procédure (Cass. Crim, 31 mars 2015, n° 15-80599, Non publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030449958&fastReqId=852832440&fastPos=1).
L’expertise visée à l’article 706-115 du CPP peut également avoir pour objet d’évaluer l’aptitude du majeur protégé à comparaître devant une juridiction de jugement.
Voir compléments sur le statut du majeur protégé dans la section dédiée au sujet dans ce même kit
4.2.3 - L’expertise facultative dans les différentes phases de la procédure pénale, comment la demander ?
Les droits de la défense sont particulièrement restreints au cours de l’enquête préliminaire. Si au cours de l’audition libre ou de la garde à vue, l’intéressé a le droit d’être informé des faits qui sont retenus contre lui et de la possibilité pour lui d’être assisté par un avocat, il ne peut en revanche contester à ce stade de la procédure la légalité des actes d’enquêtes ou former des demandes d’actes.
Il existe cependant une possibilité procédurale : l’avocat peut - sous certaines conditions - solliciter l’examen psychiatrique de son client au cours de l’enquête préliminaire. L’article 77-2 du code de procédure pénaleprévoit en effet la possibilité pour la personne ayant été entendue librement ou au cours d’une garde à vue de consulter le dossier de la procédure.
Cette demande doit être présentée :
- postérieurement à l’année qui s’est écoulée à compter du premier de ces actes,
- par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.
Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, le procureur de la République doit, lorsque l'enquête lui paraît terminée et s'il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procédure prévue à l'article 390-1, aviser celle-ci, ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d'elle-même si elle n'est pas assistée par un avocat, d'une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois, par LRAR ou déclaration au greffe contre récépissé.
La lecture combinée des articles 77-1 et 77-2 du code de procédure pénale fonde la recevabilité d’une demande d’examen scientifique utile à la manifestation de la vérité (Cass. Crim. 31 mai 2016 n°14-87678, Non publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032634606&fastReqId=1164620052&fastPos=1). Une expertise psychiatrique est un examen scientifique utile à la manifestation de la vérité.
Toutefois, ces missions techniques ou examens scientifiques ne sont pas soumis à l’ensemble des prescriptions du code de procédure pénale relatives aux expertises et notamment à la possibilité de demander une contre-expertise (Cass. Crim 5 mars 2019 n°17-87402, Non publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038238537&fastReqId=1307528213&fastPos=1). Dans le prolongement de ce motif, il a été jugé qu’une cour d'appel ne peut annuler un examen technique ou scientifique au seul motif de l'impossibilité d'ordonner un contre-examen (Même arrêt).
Par ailleurs, lorsque la personne poursuivie est déférée devant le procureur de la République qui envisage de la poursuivre selon la procédure de la comparution immédiate (ou de la comparution immédiate à délai différé) ou par convocation par procès-verbal, elle peut, par la voix de son avocat, soumettre à l’appréciation du procureur de la République l’opportunité de commettre un expert psychiatre (Article 393 CPP alinéa 4).
En cas de refus du procureur de la République de faire procéder à une expertise psychiatrique, l’avocat devra saisir la juridiction de jugement de cette demande. L’avocat en charge de la personne mise en examen et affectée de troubles psychiatriques qui souhaite convaincre les juges de l’abolition ou de l’atténuation du discernement de son client au moment des faits a intérêt à ce que la présence de ces troubles soit constatée par un expert judiciaire.
L’expertise diligentée au cours de l’instruction a un caractère contradictoire. L’avocat de la personne mise en examen peut demander la modification de la mission de l’expert ainsi qu’un complément d’expertise ou une contre-expertise. Si le recours contre l’ordonnance de rejet de la demande de commission d’expert est soumis au filtre du président de la Chambre de l’instruction, le respect du principe du contradictoire permet, le recours contre l’ordonnance de rejet de la demande de contre-expertise en appel.
4.2.3.1 - La demande de commission d’expert
Le code prévoit de manière générale la possibilité pour l’avocat de formuler toute demande d’acte utile à la manifestation de la vérité (Article 81 du code de procédure pénale).
La demande de commission d’expert répond à une nécessité judiciaire plus particulière. Elle est prévue à l’article 156 du code. L’avocat peut demander que la personne qu’il assiste fasse l’objet d’une expertise psychiatrique ou de toute autre expertise nécessaire à la manifestation de la vérité. L’article 156 opère un renvoi à l’article 81 du code sur les règles relatives aux formes de la demande : elle doit être écrite et motivée et être faite par déclaration au greffe du juge d’instruction saisi du dossier ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe.
Attention : la demande qui serait formulée non conformément aux prescriptions de l’article 81 serait déclarée irrecevable. Il est ainsi nécessaire de l’adresser, tant sur l’enveloppe que dans le corps du courrier, au greffe du magistrat instructeur et non au magistrat instructeur lui-même.
Il est prévu un délai d’un mois, qui court à compter de la réception de la demande, pour statuer par une ordonnance écrite et motivée.
Au titre du recours dont dispose l’avocat pour contester le refus de commission d’expert, l’avocat peut interjeter appel de l’ordonnance de refus dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Il s’agit toutefois d’un appel soumis au filtre du président de la Chambre de l’instruction. L’appel des ordonnances rejetant une demande de commission d’expert est régi par l’article 186-1 du code de procédure pénale qui restreint le droit d’appel relatif à certaines demandes limitativement énumérées. Il appartient à l’avocat d’annexer à l’acte appel, une écriture motivée en droit et en fait au soutien de sa demande. Cette pratique, non obligatoire et peu répandue, peut toutefois convaincre le président de la Chambre de l’instruction de ne pas faire usage de son pouvoir de filtrage.
Dans le cas où l’intéressé se heurterait au silence du magistrat instructeur à l’issue du délai d’un mois à compter de sa réception, il lui appartiendra de saisir par requête motivée en droit et en fait, le président de la Chambre de l’instruction qui statuera conformément à l’article 186-1 (Procédure de l’appel filtré).
En effet, le dossier de l’information est transmis au président de la Chambre de l’instruction qui décide dans le délai de huit jours à compter de la réception du dossier de l’opportunité de saisir ou non la Chambre de l’instruction.
Sa décision est insusceptible de recours sauf en cas d’excès de pouvoir. L’excès de pouvoir doit être attaqué par un pourvoi en cassation.
4.2.3.2 - La demande de modification de la mission de l’expert commis par le juge d’instruction
Lorsque le magistrat instructeur commet un expert judiciaire, il doit en informer sans délai le procureur de la République et les parties (Article 161-1 CPP). Ces dernières disposent d’un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance de commission pour demander selon les règles prévues à l’article 81 dixième alinéa la modification des questions posées par le magistrat instructeur.
Ils peuvent également demander l’adjonction à l’expert désigné d’un autre expert de leur choix.
Celui-ci doit figurer sur la liste des experts de la Cour de cassation ou sur l’une des listes des experts dressés par les Cours d’Appel. Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’une juridiction peut nommer un expert ne figurant pas sur l’une de ces listes (Article 156 CPP).
L’ordonnance de rejet de ces demandes, qui doit intervenir dans le délai de 10 jours à compter de leur réception, peut être contestée devant le président de la Chambre de l’instruction dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Ces règles sont également applicables en l’absence de réponse du magistrat instructeur dans les 10 jours de leur réception. La décision du président de la Chambre de l’instruction doit être motivée. Elle est insusceptible de recours.
Le magistrat instructeur peut refuser la demande de modification de la mission de l’expert ou d’adjonction d’un expert lorsque l’urgence commande que l’expertise soit réalisée dans les plus brefs délais. L’urgence doit être caractérisée. La Cour de cassation exerce un contrôle de l’urgence. L’ordonnance de rejet serait entachée de nullité si l’urgence n’était pas caractérisée.
Au titre des demandes utiles à la défense de l’intéressé, l’avocat peut solliciter que soient entendues telles ou telles personnes (par exemple les parents qui pourront utilement décrire les différentes manifestations de la maladie psychiatrique de leur enfant ou le médecin de l’intéressé). Cette demande est fondée sur l’alinéa premier de l’article 164 du Code de procédure pénale : « les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile. ». Le médecin qui, ainsi requis, témoigne en justice, ne peut être puni pour violation du secret professionnel.
Il peut également être demandé que le dossier médical de l’intéressé soit communiqué à l’expert. Ou bien l’avocat de l’intéressé dispose d’une copie de ce dossier (l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique) et le verse au dossier au soutien de sa demande, ou bien il sollicite du magistrat instructeur de se faire communiquer le dossier afin de le transmettre à l’expert.
4.2.3.3 - La demande de complément d’expertise ou d’une contre-expertise
Lorsqu’une expertise psychiatrique a été diligentée par le magistrat instructeur, d’office ou à la demande des parties, les conclusions de cette expertise ou le rapport intégral sont notifiées :
- Soit lors d’un interrogatoire, les parties et leurs avocats étant convoqués au moins cinq jours ouvrables avant la tenue de celui-ci,
- Soit par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Soit par télécopie.
Le délai laissé aux parties pour formuler une demande de complément ou de contre-expertise est précisé par le magistrat instructeur. Il ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l’envoi des conclusions de l’expert. À peine d’irrecevabilité, la demande doit être motivée en droit et en fait.
4.2.3.4 - La requête en nullité du rapport d’expertise
La nullité du rapport d’expertise peut être soulevée devant la Chambre de l’instruction au cours de l’instruction, selon les règles communes des requêtes en nullité (Art 170 à 174-1 du CPP).
Voir dans le chapitre Stratégies de plaidoiries, la section présentant un exemple de mémoire demandant la nullité d’une expertise
4.3 - Points de vigilance tout au long de la procédure pénale
4.3.1 - Pendant l’enquête préliminaire
4.3.1.1 - L’interpellation
L’interpellation (ou arrestation) peut être effectuée par tout individu si la personne arrêtée est manifestement en train de commettre un crime ou un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement (art. 73 CPP). Elle peut également l’être dans le cadre d’une instruction pénale ou suite à une enquête préliminaire. Elle ne débouche pas nécessairement sur une mesure de garde à vue.
Lors de l’interpellation, la personne ne peut être menottée ou entravée que si elle apparaît dangereuse pour elle-même ou autrui, ou si elle est susceptible de tenter de prendre la fuite (art. 803 CPP).
4.3.1.2 - La garde à vue
La garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ) qui en établit procès-verbal et en informe le procureur de la République dans l’heure suivant l'interpellation. Le Parquet, seul, peut décider de mettre un terme à ladite mesure. L’Officier de Police ou de Gendarmerie a pour mission de rechercher, pendant la garde à vue, tous les éléments, traces et indices (à charge et à décharge), d’en acter les résultats pour les présenter à la Justice. Ces constats factuels et objectifs formeront le socle des décisions du Parquet. La collecte d’informations sur la santé mentale du mis en cause peut amener l’Officier de Police Judiciaire à requérir une expertise dans les meilleurs délais.
La garde à vue des personnes placées sous tutelle ou sous curatelle est encadrée (article 706-112-1 CPP). Si « les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique », le curateur ou le tuteur doit être avisé ; la même chose vaut pour les personnes bénéficiant d’une mesure de sauvegarde de justice ; ceci dans un délai de 6 heures à compter du moment où est apparue l'existence d'une mesure de protection juridique. Le mandataire peut désigner un avocat, demander qu’il en soit désigné un et demander que la personne soit examinée par un médecin. Toutefois le procureur peut décider que l’avis est différé ou n’est pas délivré « afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ».
Si un examen médical n’est pas demandé par la personne gardée à vue, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire, un membre de sa famille peut le requérir. L’examen médical est alors de droit (article 63-3 du code pénal).
Si le gardé à vue a exprimé le souhait de bénéficier du droit à l'assistance d'un avocat, sa première audition par l'officier de police judiciaire ne peut débuter sans la présence de ce dernier jusqu'à la fin d'un délai de deux heures, sauf si le procureur autorise une audition immédiate sans attendre son avocat en raison des nécessités de l’enquête.
À son arrivée, l'avocat peut s'entretenir seul avec son client pendant 30 minutes et consulter :
- ses procès-verbaux d'audition,
- le procès-verbal constatant le placement en garde à vue,
- le procès-verbal de notification des droits
- l'éventuel certificat médical établi.
Il peut ensuite assister à toutes les auditions et confrontations, prendre des notes, poser des questions et présenter des observations écrites.
L’officier de police judiciaire peut toutefois refuser que l’avocat pose des questions ou bien la totalité des questions qu’il avait prévue de poser. Dans ce cas, l’avocat ne manquera pas de rédiger un mémoire dans lequel il relatera les questions refusées.
L’avocat doit s’assurer, s’il y a lieu, que l'altération des facultés mentales de la personne au moment des faits délictueux a été prise en compte dès l'établissement des procès-verbaux d'audition. Il pourra mettre en avant l'article 122-1 du Code Pénal qui organise la reconnaissance de l’altération ou bien de l’abolition du discernement de l’intéressé au moment de la commission des faits.
4.3.1.3 - Les pouvoirs du procureur
Une palette de choix s'offre au procureur en fonction de la gravité de l'acte commis, de sa complexité (dissimulation, complices ou non, etc.) et de sa perception de la personnalité du commettant :
- Classement sans suite. En ce cas, il ne peut prendre lui-même aucune mesure de sûreté, ni davantage saisir quelque juridiction que ce soit pour qu'elle prononce de semblables mesures. Il ne peut qu'informer le préfet afin que celui-ci examine l'éventualité d'une hospitalisation en soins sans consentement. L’intéressé (ou son avocat) peut demander une copie complète de la procédure ayant abouti à un classement sans suite.
- Renvoi devant le tribunal de police pour des faits contraventionnels (actes mineurs).
- Mise en œuvre d'une procédure alternative aux poursuites (articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale). Le procureur peut, pour les personnes qui ont commis une infraction et dont l’identité et le domicile sont connus :
- Procéder ou faire procéder à un rappel des obligations de la loi en orientant l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (stage ou formation…) (art.41-1 CPP),
- Proposer une médiation entre l’auteur des faits et la victime, la réparation des dommages commis, etc.,
- Proposer ou faire proposer une composition pénale (peine d’amende ou peine d’emprisonnement)
- Contrôle judiciaire avec obligations et contraintes particulières jusqu’au jugement,
- Demande qu’il soit procédé à une ou plusieurs expertises psychiatriques (soit l’expertise est obligatoire, voir chapitre 1 ; soit elle est facultative, voir ci-dessous),
- Saisine du préfet afin qu’il décide d’une hospitalisation pour recevoir des Soins Psychiatriques sur Décision d'un Représentant de l'État (SPDRE),
- Saisir le tribunal correctionnel selon l'une des procédures de comparution immédiate, comparution à délai différé ou comparution avec reconnaissance préalable de la culpabilité,
- Ouverture d’une information judiciaire (obligatoire en cas de crime, facultative pour les délits) et, par conséquent, saisine d'un juge d'instruction pour mener l’instruction judiciaire qu’il conclura, soit par une ordonnance de non-lieu (abandon des poursuites), soit par une ordonnance de renvoi devant une juridiction pénale, soit par une ordonnance d’irresponsabilité pénale.
Curateur et tuteur doivent être avisés par le procureur de l'engagement de la procédure contre une personne protégée (article 706-113 CPP).
NB : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2021, n°20-82.267, Publié au bulletin : En l’espèce, le curateur d’un individu n’a pas été informé des poursuites dont le majeur protégé faisait l’objet. Néanmoins, la nullité de la procédure pénale n’est pas encourue car les enquêteurs n’ont pas procédé à l’interrogatoire de l’individu et par conséquent n’avaient pas connaissance que l’intéressé faisait l’objet d’une mesure de protection.
4.3.2 - Les procédures « simplifiées » de jugement du tribunal correctionnel
4.3.2.1 - La comparution immédiate
La comparution immédiate est une procédure rapide qui permet de juger un individu dès la fin de sa garde à vue. Le prévenu est retenu en cellule jusqu'à sa comparution (article 395 CPP).
La comparution immédiate s'applique aux délits punis d'au moins 2 ans de prison (6 mois pour un flagrant délit).
Avant l’audience de comparution immédiate, dans le cadre de l’étape appelée « Permanence d’Orientation Pénale », le prévenu est reçu par un enquêteur chargé de réaliser une « enquête sociale rapide ». Cette enquête a pour but de recueillir puis vérifier les éléments sociaux, familiaux, professionnels et de santé relatifs au prévenu susceptibles d'éclairer le juge sur le contexte de la commission des faits.
L’article 395 du code de procédure pénale prévoit que « Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal ». Si le tribunal ne peut se réunir le jour même (cas des « petits » tribunaux et des veilles de weekend ou jours fériés), le procureur peut saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour prendre des mesures garantissant la présence du prévenu. Le JLD peut alors décider un contrôle judiciaire, une assignation à résidence avec surveillance électronique ou une détention provisoire (voir document « Eviter l’incarcération »). En cas de détention provisoire, le prévenu est placé en maison d'arrêt et doit comparaître au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, il est mis d'office en liberté.
L’obligation de prévenir le tuteur ou le curateur est un droit fondamental ainsi que l’ont établi la Cour de Cassation et le Conseil Constitutionnel.
« Lorsqu'il est établi, au cours de la procédure, qu'une personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit aviser des poursuites son curateur ou son tuteur » Cass. crim. 3 mai 2012 (N° 11-88725). https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025992269
La décision du Conseil constitutionnel n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018 l’a également confirmé.
Toutefois, la nullité de la procédure n’est pas encourue si et seulement si les autorités ignoraient la statut de majeur protégé (dans ce cas, procédure de révision : cf. Plus haut). En cas de doute, il est fait obligation aux magistrats (siège ou parquet selon stade de la procédure de faire procéder à une expertise sous peine d’annulation de la poursuite).
« Il se déduit des articles 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci, en ce compris l'interrogatoire de première comparution. En cas de doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte. Encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, d'une part, après avoir constaté que figuraient dans la procédure, préalablement à l'interrogatoire de première comparution, des indications données par des membres de sa famille sur une schizophrénie dont souffrirait l'intéressé et une main-courante remontant à quelques années le qualifiant de majeur sous curatelle, ainsi qu'une expertise psychiatrique réalisée récemment dans un dossier distinct faisant état à son sujet d'une tutelle, retient que ces éléments n'étaient pas suffisants pour faire naître un doute sur l'existence d'une mesure de protection légale, d'autre part, ne caractérise pas une circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la vérification qui s'imposait » : Cass. Crim. 19 septembre 2017 (N° 17-81919). https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035612587&fastReqId=251658703&fastPos=1
La demande d’expertise :
L’avocat de la personne poursuivie peut demander que soit ordonné tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité (Article 397-1 CPP).
Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal peut la renvoyer à une audience qui ne peut se tenir dans un délai inférieur à deux semaines et supérieur à six semaines lorsque la peine encourue est inférieure à sept ans d’emprisonnement. Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d’emprisonnement, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois (article 397-1 CPP).
Le tribunal doit statuer sur la demande d’expertise par jugement motivé. Il s’agit d’un jugement avant dire droit qui ne sera susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond.
Il est donc essentiel pour l’avocat de réunir un maximum de pièces médicales qui rendent sa demande d’expertise psychiatrique bien fondée. Voir en fin de kit le modèle de mémoire récapitulatif suggéré par l’UNAFAM
Lorsque le tribunal fait droit à cette demande, il doit être statué sur le sort de la personne poursuivie jusqu’à la prochaine audience (Article 397-3 CPP). La personne peut être placée ou maintenue sous contrôle judiciaire. Elle peut également être maintenue ou placée en détention provisoire (voir document « Eviter l’incarcération »). Cette décision est exécutoire par provision.
Lorsque la personne est placée en détention provisoire, le jugement doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de sa première comparution, faute de quoi elle sera remise en liberté. Ce délai est porté à quatre mois si la peine encourue est supérieure à sept ans (Article 397-3 du code de procédure pénale).
4.3.2.2 - La comparution à délai différé
La comparution à délai différé a été créée par la loi du 19 mars 2019 (article 397-1-1 CPP). Cette procédure permet au procureur de faire juger une personne peu de temps après sa garde à vue, mais sans la libérer.
Elle permet de poursuivre rapidement le prévenu devant le tribunal correctionnel mais dans un délai légèrement supérieur aux 20 heures de la procédure de comparution immédiate, avec un report rendu nécessaire parce que les résultats de réquisitions et d'examens techniques ou médicaux nécessaires au jugement n'ont pas encore été obtenus (test ADN, analyses toxicologiques, exploitations téléphoniques, etc.).
Le procureur présente le prévenu au Juge des Libertés et de la Détention (JLD) afin qu’il le place sous contrôle judiciaire, en assignation à résidence sous surveillance électronique ou encore en détention provisoire (voir document « Eviter l’incarcération »).
En cas de détention provisoire, le prévenu doit comparaître au plus tard dans les 2 mois. À défaut, il est mis d'office en liberté.
La demande d’expertise :
L’avocat de la personne poursuivie pourra, jusqu'à l’audience de jugement, formuler des demandes d’actes. Il pourra ainsi demander qu’un expert psychiatre soit commis pour examiner la personne (397-1-1 CPP). Outre la demande d’acte ponctuel, l’avocat peut demander au tribunal que soit ordonné un supplément d’information.
4.3.2.3 - La comparution avec reconnaissance préalable de la culpabilité
La procédure de « comparution avec reconnaissance préalable de la culpabilité » (CRPC) (Articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale) est mise en œuvre par le procureur lorsqu'un prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que ceux-ci sont simples.
Le procureur reçoit d’abord, seul, le prévenu en présence de son avocat (obligatoirement) pour proposer une sanction. Si le prévenu est d’accord, il est par la suite présenté devant un juge du tribunal correctionnel pour « homologuer » la décision du procureur.
La demande d’expertise :
La demande de commission d’expert présentée soit devant le procureur de la République, soit devant le magistrat du siège, a le même effet que la contestation de la reconnaissance des faits. La personne poursuivie comparait donc devant le tribunal correctionnel et les règles relatives aux demandes d’expertises à l’audience correctionnelle seront alors applicables (voir paragraphe 6.b).
Le décret n°2023-89 du 13 février 2023 relatif à l’application de l’article 706-115 du Code de procédure pénale (publié au Journal officiel du 14 février 2023) tire la conséquence de l'article 706-115 du Code de procédure pénale qui dispose que le majeur protégé poursuivi doit nécessairement faire l’objet d’une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits, avant tout jugement au fond, en cas de comparution avec reconnaissance préalable du culpabilité. Le décret supprime la voie de poursuite qui est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité de la liste des alternatives aux poursuites pour lesquelles cette expertise n’est pas obligatoire, telle que prévue par l’article D. 47-22 du Code de procédure pénale. Il en est de même pour l'ordonnance pénale.
4.3.3 - La procédure devant le juge d’instruction
L’instruction est une enquête préalable confiée par le procureur de la République, suite à un réquisitoire introductif, à un juge d’instruction en vue d’établir l’existence ou non de charges suffisantes pour poursuivre la personne présumée avoir commis une ou des infractions.
Le rôle du juge d’instruction
Un Juge d’Instruction est systématiquement saisi en matière criminelle et éventuellement en matière correctionnelle lorsque l’affaire apparaît complexe. L’enquête du Juge d’Instruction est menée à charge et à décharge. Le juge d’instruction dispose de nombreux moyens d’investigation (enquêtes, auditions du mis en examen, de témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques...). Il est assisté des officiers de police judiciaire (OPJ). Ses décisions sont prises par ordonnances notifiées à chacune des parties prenantes au dossier (mis en cause, victimes, avocats…). L’instruction est conduite sous le sceau du secret.
La pratique de l’instruction en matière criminelle implique toujours l’audition de proches de la famille pour l’enquête dite de personnalité. Cette enquête est faite soit par la police ou la gendarmerie soit par des enquêteurs habilités. Le juge peut, dans tous les cas, s'il a un doute sur la santé mentale du prévenu ou sur proposition de l’avocat, ordonner une expertise psychiatrique (voir ci-dessous).
Le Juge d’Instruction peut rendre différents types d’ordonnances :
- d’expertise,
- de refus de mise en examen (contrairement au réquisitoire du parquet),
- de mise en liberté sous contrôle judiciaire,
- de fin d’information (qui précède l’ordonnance de règlement qui peut être un renvoi devant le tribunal correctionnel, la cour d’assises, de non-lieu etc…),
- de mise en accusation devant la Cour d’assises, de non-lieu partiel ou total, de dessaisissement, de refus d’informer si les faits sont prescrits.
Au vu de la gravité de l'infraction, du passé judiciaire, des besoins de l'instruction, de l'état de santé et d'une évaluation de la dangerosité de la personne mise en examen, le juge d’instruction peut saisir le JLD afin que ce dernier le place ou le maintienne en détention. À l’occasion de l’ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement, le magistrat instructeur - par ordonnance séparée - ordonne le maintien (ou non) en détention provisoire ou sous CJ de la personne mise en examen. (voir document « Eviter l’incarcération »).
En cas de trouble psychique survenu après les faits :
Le juge d'instruction, tant que dure la maladie, ne peut plus interroger le mis en examen, ni le confronter avec quiconque, et doit surseoir à statuer en ce qui le concerne (Cass. crim., 13 oct. 1853 : DP 1853, 5, p. 204), mais il peut toujours, sans se livrer à des actes de poursuites personnelles impliquant le mis en examen, procéder à des constatations et enquêtes, entendre des témoins et rassembler des indices ou des éléments à charge ou à décharge.
Lorsque l'altération des facultés mentales d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement après constatation que l'intéressé a recouvré la capacité à se défendre (Cass. crim., 19 sept. 2018, n° 18-83.868, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037450771&fastReqId=1894438026&fastPos=1).
4.3.4 - La procédure devant la Chambre de l’instruction
A. Le rôle de la Chambre de l’Instruction :
C’est une chambre de la Cour d’appel qui statue en appel notamment :
- Sur les contentieux en matière d’instruction : celui de la détention provisoire (dans ce cas, en aucun cas, elle ne réexamine l’affaire et ne statue sur le fond) et celui du « fond » : requête en nullité, appel d’une ordonnance de règlement, appel d’un refus d’acte (en cas d’appel d’une ordonnance de règlement, elle réexamine l’affaire au « fond »). Dans les autres cas, elle ne peut le faire que si elle décide « d’évoquer l’affaire au fond »). La procédure d’évocation obéit à des règles strictes.
- Sur les décisions de placement en soins sans consentement à la demande du représentant de l’Etat (SPDRE).
- En matière de reconnaissance d’irresponsabilité pénale (voir paragraphe b).
Ses audiences sont contradictoires :
- L’intéressé doit obligatoirement être convoqué pour assister à l’audience et s’exprimer à peine de nullité de la procédure pour les appels des ordonnances de placement ou de maintien en détention provisoire. « Lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le président procède à l’interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, et reçoit ses déclarations. L’interrogatoire de la personne mise en examen, dans le cadre de cette procédure, constitue une obligation substantielle. L’arrêt doit porter mention qu’il a été procédé, le cas échéant, conformément à la loi, à cet interrogatoire. […] La personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie d’une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »» (cass. crim. 8 juillet 2020, n°19-85954, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000042128033&fastReqId=1674052700&fastPos=1).
- La présence de l’intéressé est soumise à l’appréciation de la Chambre de l’Instruction en cas d’appel de refus de mise en liberté avec demande de comparution personnelle. Une particularité existe dans le cas où l’intéressé n’a pas comparu personnellement dans les 4 derniers mois).
- Exception : en ce qui concerne les appels des ordonnances de règlement, des refus d’acte, ou requêtes ne nullité, il ne comparait pas.
La Chambre de l’Instruction rend des arrêts susceptibles de pourvoi en cassation dans un délai de 5 jours. En cassation, l’affaire est réexaminée sur la seule forme, la Cour s’assurant que toutes les procédures de l’instruction ont été respectées.
B. La reconnaissance de l’irresponsabilité pénale par la chambre de l’instruction :
À la fin de l’instruction, le magistrat instructeur qui envisage de déclarer la personne irresponsable pénalement (Article 122-1 alinéa 1 du code pénal) en informe le procureur de la République et les parties (Article 706-119 CPP).
Le procureur de la République dans ses réquisitions, et les parties dans leurs observations, doivent alors préciser si elles souhaitent saisir la Chambre de l’instruction pour qu’il soit statué sur l’irresponsabilité pénale de la personne mise en examen.
La procédure devant la Chambre de l’instruction peut aboutir au prononcé de mesures de sûreté telles que l’hospitalisation sans le consentement de la personne dans une unité de soins psychiatriques (Article 706-135 CPP). Lorsque le procureur de la République ou les parties ont précisé souhaiter que la Chambre de l’instruction soit saisie de la question de l’irresponsabilité pénale de la personne mise en examen, le magistrat instructeur ordonne, lors du règlement de l’instruction, la transmission du dossier par le procureur de la République au procureur général afin qu’il saisisse la Chambre de l’instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission (Article 706-120 CPP).
L'ordonnance de transmission de pièces prolonge les mesures de contrainte (détention provisoire et contrôle judiciaire) jusqu'à la comparution devant la chambre de l'instruction, sauf décision contraire du juge.
La procédure devant la Chambre de l’instruction (que ce soit en procédure d’appel ou en cas de saisine, suite à la transmission par le juge d’instruction), est prévue aux articles 706-122 et suivants du CPP.
En cas de saisine directe, la chambre doit statuer, si l'ordonnance de saisine n'a pas mis fin à la détention provisoire, dans les six mois de sa saisine en matière criminelle et dans les quatre mois en matière correctionnelle.
Les parties ou le procureur de la République peuvent demander la comparution personnelle de la personne mise en examen. Habituellement, la Chambre de l’instruction ordonne une expertise afin d’évaluer l’aptitude de l’intéressé à comparaitre devant elle. La chambre de l’instruction peut refuser sa comparution si son état de santé ne le permet pas.
Si la personne mise en examen comparait, il est procédé à son interrogatoire.
Les experts l’ayant examiné sont également entendus et « encourt la censure l’arrêt dont les mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer que l’un des experts, au moins, a été entendu. » (cass. crim. 8 juillet 2020, n°19-85954, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000042128033&fastReqId=1674052700&fastPos=1).
Les témoins cités par les parties ou le ministère public peuvent également être entendus. Leur audition est toutefois soumise à l’appréciation du président de la Chambre de l’instruction.
Des questions peuvent être posées à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins ainsi qu’aux experts par le procureur général et les avocats de la personne mise en examen et l’avocat de la partie civile.
La chambre de l’instruction peut rendre une décision de non-lieu si les charges retenues contre la personne mise en examen ne sont pas suffisantes.
Elle peut également renvoyer la personne devant la juridiction compétente si les charges sont suffisantes et qu’elle ne fait pas application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal.
Lorsqu’elle fait application de l’article 122-1 du code pénal, elle rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale. Elle statue également sur la demande de dommages et intérêts et peut prononcer des mesures de sûreté dont l’hospitalisation sous contrainte (voir chapitre 8). L’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. Il est susceptible d’un pourvoi en cassation (Article 706-126 CPP).
C. Soulever la nullité du rapport d’expertise :
La nullité du rapport d’expertise peut être soulevée devant la Chambre de l’instruction au cours de l’instruction, selon les règles communes des requêtes en nullité (Art 170 à 174-1 du CPP).
Les experts mandatés par la juridiction pénale doivent être inscrit sur les listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale qui dispose que« Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel relative aux experts judiciaires.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. »
Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement, dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit, et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure (Art. 160 du Code de procédure pénale).
Voir aussi fiche Stratégies de plaidoirie, le mémoire D, exemple de requête en nullité
4.3.5 - Les procédures normales du tribunal de police et du tribunal correctionnel
4.3.5.1 - Le tribunal de police
Le tribunal de police traite des contraventions de 5ème classe et les sanctionne par des amendes. Le tribunal compétent est celui du lieu où l'infraction a été commise ou du lieu de résidence de l'auteur. Il peut être saisi par le procureur de la République (lui-même éventuellement saisi par la victime). Seul le procureur de la République peut saisir le tribunal de police d'une procédure simplifiée.
La convocation se fait par simple lettre ou par convocation remise par huissier ou par officier de police judiciaire. Le prévenu n'est pas obligé de se présenter personnellement. Il peut :
- se faire représenter par son avocat
- demander par lettre au président du tribunal à être jugé en son absence.
Selon l’article 10 du Code de procédure pénale, lorsque l'état mental d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure et le prévenu ne peut être jugé qu'après avoir recouvré la capacité de se défendre.
La procédure simplifiée :
Il n'y a pas de débat préalable. Le juge rend une ordonnance pénale au vu du seul dossier présenté par le procureur de la République.
Le prévenu condamné par ordonnance pénale peut faire opposition dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la décision. L'opposition se fait soit par courrier, soit par déclaration orale au greffe du tribunal. L'affaire est alors rejugée par le même tribunal suivant la procédure ordinaire.
- La procédure ordinaire :
Le jugement est rendu à l'issue des débats ou à une date ultérieure communiquée aux parties. Le juge statue en se fondant sur son intime conviction :
- soit il constate que le prévenu n'a pas commis d'infraction et prononce sa relaxe,
- soit il constate la réalité de l'infraction et la qualifie de contravention,
- soit il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel,
- soit il condamne l'auteur mais reporte sa décision sur la peine pour demander une enquête sur sa personnalité ou sa situation familiale ou sociale. Le résultat de cette enquête permet d'adapter la sévérité de la peine à la personne de l'auteur. Le juge fixe le délai dans lequel il doit rendre sa décision finale, de quatre mois maximum, renouvelable une fois.
Lorsqu'une partie n'a pas été informée de la tenue de l'audience et n'y est donc pas présente ni représentée, le jugement est rendu par défaut. Dans ce cas, la partie absente a la faculté de faire opposition au jugement. L'opposition se forme par déclaration au procureur de la République dans les 10 jours de la prise de connaissance du jugement (par sa signification par exemple). L'affaire est jugée à nouveau par le même tribunal.
- L’appel :
Chaque partie peut faire appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, dans un délai de 10 jours :
- à partir du jugement, si la partie était présente ou représentée,
- à partir de la signification, si la partie n'était ni présente ni représentée.
4.3.5.2 - Le tribunal correctionnel
La procédure :
Plusieurs procédures sont possibles : l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, la citation directe par le parquet (voir paragraphe a), la comparution avec reconnaissance préalable de la culpabilité (CRPC), la comparution immédiate, la comparution à délai différé et la convocation sur procès-verbal. Le prévenu comparait, au terme de sa garde à vue, soit sur une convocation du procureur fixant une date et une heure de procès différée, soit sur ordonnance de renvoi du juge d’instruction.
Pour les procédures autres que simplifiées, le principe est que le procès doit avoir lieu dans les 10 jours à 2 mois suivant la délivrance de cette convocation. Dans l'attente du jugement, le prévenu peut être soumis à un contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou une détention provisoire (voir document « Eviter l’incarcération »).
Selon l’article 10 du Code de procédure pénale, lorsque l'état mental d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure et le prévenu ne peut être jugé qu'après avoir recouvré la capacité de se défendre.
Le juge informe le prévenu, au début de l’audience, de son droit au silence, de son droit à répondre aux questions ou bien de faire des déclarations spontanées.
L'avocat du prévenu pourra, s'appuyant éventuellement sur un rapport d’expertise, s’efforcer de convaincre le juge que son client a agi sous l’emprise de la maladie, dans l’une des catégories prévues par l'article 122-1 du Code pénal, l'abolition ou l'altération du discernement.
Si la juridiction décide de rejeter la circonstance de l’abolition et de reconnaître la commission des actes en situation de simple altération du discernement, l’avocat s’efforcera alors d’obtenir le respect du principe de la diminution au tiers du maximum de la peine encourue (le tribunal ne peut le refuser que par une décision spécialement motivée) et la conversion de l’éventuelle peine de prison en une peine alternative à l’emprisonnement (voir document « Eviter l’incarcération »).
La demande d’expertise :
Devant toute juridiction correctionnelle, l’avocat peut demander un supplément d’information.
En application de l’article 388-5 du CPP, cette demande peut être faite avant l’audience en cas de poursuites par citation (article 390 du CPP) ou convocation (article 390-1 du CPP). Il s’agit de conclusions écrites adressées par LRAR ou par remise au greffe contre récépissé.
Cette demande peut également être formulée ultérieurement devant le tribunal correctionnel, y compris au cours des débats. Il s’agit là encore de conclusions écrites qui doivent être visées par le greffier et le président (Art. 459 du CPP).
Le refus d’expertise psychiatrique ou d’expertise supplémentaire ne peut être admis qu'autant que l'arrêt ne présente pas de contradiction interne entre les constatations de fait et le refus d'expertise (Cass. crim., 21 janv. 1992 : JurisData n° 1992-002353, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007502946&fastReqId=437483905&fastPos=1).
Les règles relatives à la commission d’un expert par une juridiction de jugement sont identiques à celles relatives à la commission d’un expert par un juge d’instruction (Article 156 CPP).
En effet, l’article 434 du code de procédure pénale relatif à l’administration de la preuve au cours des débats devant le tribunal correctionnel précise la possibilité pour le tribunal l’ordonner la commission d’un expert conformément aux articles 156 à 166, 168 et 169 du même code.
Il est donc possible, pour une partie qui allègue l’existence d’une maladie psychiatrique, de demander qu’un expert soit commis pour la constater devant le tribunal correctionnel.
En revanche, dans la pratique, l’aspect contradictoire existant au cours de l’instruction avec la possibilité de demander la modification de la mission de l’expert, l’adjonction d’un expert ou encore une contre-expertise, est mis à mal par les contraintes du temps judiciaire qui sont celles de l’audience correctionnelle. Surtout, aucune disposition du CPP ne prévoit que les articles 161-1 du CPP (notification de la décision de commission d’expert en matière d’instruction) et 167 du même code (règles relatives à une demande de contre-expertise) s’appliquent devant une juridiction de jugement. En particulier, l’article 283 du Code de procédure pénale exclut l’application de l’article 167 du même Code. Rappelons que cet article prévoit, en autres, que le rapport d’expertise doit être notifié aux parties qui disposent d’un délai pour faire des observations, une demande de complément d‘expertise ou de contre-expertise.
Par ailleurs, les conséquences de la commission d’un expert par le tribunal correctionnel sont différentes selon le mode de poursuite de la personne. L’avocat doit, par conséquent, veiller à informer la personne qu’il existe des conséquences d’une telle demande sur sa liberté (voir chapitre 3 pour les procédures de comparution avec reconnaissance préalable de la culpabilité (CRPC), comparution immédiate et comparution à délai différé).
Lorsqu’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est rendue, les articles 434 et 463 du code de procédure pénale permettent à l’avocat de la personne poursuivie de formuler une demande d’expertise au tribunal saisi. Comme toute décision rendue par une juridiction pénale de premier ou second ressort, elle doit être motivée.
Enfin, quand le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du Juge d’instruction, la demande de commission d’un expert devra être particulièrement justifiée au vu de la nécessité de procéder à une ultime expertise.
La requête en nullité du rapport d’expertise :
L’avocat de la personne poursuivie devant le tribunal correctionnel, lorsque celle-ci n’est pas renvoyée devant cette juridiction par l’ordonnance du Juge d’instruction, devra présenter sa requête en nullité avant toute défense au fond (Article 385 CPP).
La nullité de l’expertise doit être fondée sur l’atteinte portée aux intérêts de la personne poursuivie par la violation d’une formalité substantielle du code de procédure pénale (Article 802 CPP).
En application de l’article 77-1 du Code de procédure pénale « s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées. »
Appel :
Le délai pour faire appel du jugement du tribunal correctionnel est de 10 jours. La déclaration d’appel doit être déposée au Greffe du tribunal qui a rendu le jugement.
4.3.6 - La procédure devant la Cour d’assises (ou la cour criminelle départementale)
Les cours criminelles ont été créées à titre expérimental pour éviter la correctionnalisation et l’engorgement des cours d’assises par la loi du 23 mars 2019 dans plusieurs départements. Elles sont composées de cinq magistrats, sans jury, et habilitées à juger les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Les Cours d’assises continueront de juger les crimes punis de plus de vingt ans d’emprisonnement comme les meurtres et les assassinats et les crimes commis en récidive, ainsi que l’ensemble des crimes en appel. La procédure est la même devant les deux juridictions.
4.3.6.1 - La procédure
La Cour d’assises est saisie soit par le magistrat instructeur soit par la chambre de l’instruction.
Avant l'audience, le président procède à un interrogatoire formel de l'accusé dans les locaux de la Cour d’assises. Le président vérifie que l’accusé est bien assisté d'un avocat. L'accusé est également informé qu'il a droit à un interprète et qu’il a le droit de garder le silence.
Selon l’article 10 du Code de procédure pénale, lorsque l'état mental d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure et le prévenu ne peut être jugé qu'après avoir recouvré la capacité de se défendre.
L'audience devant la Cour d’assises est publique et contradictoire. Cependant, l'audience peut se dérouler à huis clos ou huis-clos partiel ou avec publicité restreinte :
- si des victimes sont mineures ;
- si, sur décision de la Cour, la publicité des débats est jugée dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs ;
- ou si une victime le demande et que le chef d'accusation porte sur un viol ou sur des actes de torture ou de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles.
Le président peut également, à la demande de la victime et/ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
La personne accusée est obligatoirement assistée par un avocat. Le président présente les faits reprochés à l'accusé et les éléments à charge et à décharge le concernant.
Le président interroge ensuite l'accusé et procède à des auditions : les témoins, les experts puis les victimes. Les débats se terminent par les plaidoiries de l'avocat des victimes, si elles sont parties civiles, puis de l'avocat général et l'avocat de l'accusé. L’accusé a la parole en dernier.
Après la fin des débats, la Cour d’assises délibère. Le délibéré est secret et comporte deux phases :
- la délibération sur la culpabilité,
- la délibération sur la peine.
Lorsqu'est invoquée, comme moyen de défense, l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par le Code pénal, la cour et le jury doivent être spécialement interrogés sur son existence (article 349-1 CPP).
La décision de la cour est prononcée en audience publique. La condamnation et la peine doivent être motivées.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté (sauf s’il est détenu pour une autre cause). S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut interjeter appel de la décision et lui fait connaître le délai d'appel.
Comme devant le tribunal correctionnel, l'avocat de la personne pourra s'efforcer, s’appuyant sur des rapports d’expertise, de convaincre le Juge d'instruction, puis la cour et le jury, ou le collège de 5 magistrats dans les cours criminelles, selon ce qui apparaîtra le plus plausible et utile pour son client, que ce dernier a agi en état d’abolition du discernement ou d’altération du discernement. En cas de reconnaissance d’une abolition du discernement, la Cour peut ordonner des mesures de sûreté (voir chapitre 8). Le code pénal prévoit, dans le cas d’une reconnaissance par la Cour d’une altération du discernement, que le maximum de la peine encourue est diminué d’un tiers et que si, pour ce crime, la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale encourue est de trente ans.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2024, n° 23-81.962 : M. […], majeur protégé, a été mis jugé par la cour d'assises pour avoir volontairement donné la mort à son père. Par un arrêt du 4 avril 2022, la Cour d’appel a retenu l'altération du discernement de l'accusé et a condamné l’intéressé à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de quinze ans, et dix ans de suivi socio-judiciaire. La Cour de cassation précise à ce titre : « La Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces dont elle a le contrôle, que l'association chargée de la protection de M. [V] a reçu, d'une part, la notification de l'ordonnance et de l'arrêt de mise en accusation de celui-ci devant la cour d'assises, d'autre part, des citations à comparaître devant cette cour en première instance et en appel. […] Il en résulte que les dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale ont été respectées. »
4.3.6.2 - La demande d’expertise
L’avocat peut solliciter une expertise avant la tenue de l’audience : en application de l’article 283 du CPP, le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis la clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.
L’avocat peut donc solliciter une expertise psychiatrique, particulièrement dans le cas où l’état de santé psychiatrique de son client est très compromis et où ce dernier n’est pas en état de comparaitre et de se défendre, même assisté d’un avocat.
Il est donc essentiel pour l’avocat de produire, à l’appui de sa demande, des certificats médicaux. (voir en fin de kit le modèle de mémoire récapitulatif suggéré par l’UNAFAM)
L’avocat dépose des conclusions au greffe de la Cour d’Assises.
Le président de la Cour d’assises dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir favorablement ou non cette demande. Si la requête est adressée au seul président, il n’est pas non plus tenu d’y répondre (Cass. Crim 15 novembre 2017 n°16-86913, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036052094&fastReqId=1499375923&fastPos=1).
L’avocat peut solliciter une expertise pendant les débats et le président de la Cour peut ordonner d’office une expertise psychiatrique pendant les débats car, en application de l’article 310 du CPP, « Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la Cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316. ».
Il est conseillé à l’avocat qui souhaite formuler une demande d’expertise psychiatrique, de le faire par conclusions écrites. La Cour d’assises est en effet tenue de statuer sur les conclusions écrites déposées par les parties (Article 315 CPP).
Le président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir favorablement ou non la demande faite par l’avocat de la défense. En cas de refus, il convient de déposer des conclusions adressées à la Cour.
4.3.7 - Les mesures de sûreté suite à la déclaration d’irresponsabilité pénale
Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne concernée, outre l’hospitalisation en soins sans consentement (article 706-135 CPP), les mesures suivantes (article 706-136) :
1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
5° Suspension du permis de conduire ;
6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
Ces interdictions ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique.
Elles s'exécutent pendant une durée fixée par la juridiction dans un maximum de dix ans si la poursuite était exercée pour délit et de vingt ans si les faits commis étaient criminels. En cas d'hospitalisation complète, les mesures s'appliquent immédiatement mais les délais recommencent à courir après la sortie.
La méconnaissance de ces interdictions par la personne qui en a fait l'objet est punie de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Si toutefois son état de maladie n'avait pas cessé, elle pourrait, dans cette poursuite, comme dans la poursuite principale, être déclarée irresponsable de la violation de l'interdiction qui lui avait été imposée.
La personne qui fait l'objet d'une ou plusieurs de ces mesures de sûreté peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée qui ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. Le juge statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.
4.3.8 - Les dommages-intérêts en complément d’une décision pénale
L'audience correctionnelle ou criminelle achevée, une audience civile peut suivre. Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages et intérêts réclamés par la victime, sans participation des jurés.
Si la personne a été acquittée, ses demandes d'indemnisation pour détention injustifiée seront examinées ultérieurement par d'autres instances. Il en va de même pour les demandes d'indemnisation présentées par la victime.
L'article 414-3 du Code civil déclare que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation ». C'est devant la juridiction civile que la responsabilité civile du malade mental doit être mise en cause (CA Limoges, 25 janv. 1991 : JurisData n° 1991-040017 ; CA Aix-en-Provence, 12 mai 1995 : JurisData n° 1995-047856). Quelques cours d'appel statuent cependant en sens contraire et se prononcent sur les conséquences civiles des faits poursuivis (CA Paris, 15 nov. 1995 : JurisData n° 1995-023913 ; CA Paris, 9 nov. 2004 : JurisData n° 2004-272649 ; CA Orléans, 10 janv. 2005 : JurisData n° 2005-273299). Un arrêt de la cour d'appel de Paris est même allé plus loin en jugeant que la relaxe lui imposait de rejeter la demande d'indemnisation (CA Paris, 12 déc. 2004 : JurisData n° 2004-271289).
4.4 - Des solutions permettent d’éviter l’incarcération
4.4.1 - Introduction : le sens de la peine
Objectifs et individualisation des peines :
La peine poursuit trois objectifs : la protection de la société, la prévention de la commission de nouvelles infractions et la restauration de l’équilibre social tout en respectant les intérêts de la victime. Elle a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction mais aussi de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Le principe d’individualisation des peines est fixé à tant par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen que par l’article 132-1 du code pénal
« Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. »
4.4.2 - Eviter la détention avant jugement
Le rôle du Juge des Libertés et de la Détention (JLD)
Le JLD contrôle la légalité de la privation de liberté dans les lieux dans lesquels il intervient : en détention provisoire, en rétention ou sous soins sans consentement. Il statue par ordonnance motivée à la suite d’une procédure contradictoire.
Il décide de la détention provisoire (durées maximales : 4 mois en procédure correctionnelle et 1 an en procédure criminelle, renouvelables dans certaines conditions), qui est en principe une mesure d’exception : elle répond aux besoins de l’instruction ou à des mesures de sûreté.
Le JLD prend des ordonnances de mandat de dépôt, puis de renouvellement ou non renouvellement du mandat de dépôt. Il instruit aussi les demandes de mise en liberté et peut prolonger des gardes à vue.
Des mesures alternatives peuvent être décidées par le JLD ou le juge d’instruction :
Des mesures alternatives peuvent être décidées par le JLD ou le juge d’instruction :
- Le contrôle judiciaire : la personne est soumise à des interdictions et /ou obligations telles que le dépôt d’une caution financière, le pointage dans un commissariat, un suivi socio-éducatif ou médical, une interdiction de fréquenter certains lieux, certaines personnes… (article 138 du Code de Procédure Pénale),
- L’assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique (ARSE) : l’intéressé est assigné à résidence avec des conditions de sortie et d’éventuelles obligations (Art. 142-5 CPP).
La demande d’expertise de la personne placée en détention provisoire
En application de l’article 147-1 du code de procédure pénale, la personne placée en détention provisoire peut solliciter la désignation d’un expert afin d’évaluer la compatibilité de son état de santé psychique avec son maintien en détention.
En cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin. Dans les autres cas, un expert sera désigné.
Cette demande peut être faite en matière délictuelle et criminelle à tous les stades de la procédure. Elle est expressément exclue lorsqu’il existe « un risque grave de renouvellement de l’infraction ».
La mise en liberté peut être assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.
La demande, dument complétée par des pièces médicales, doit être adressée au magistrat instructeur selon la procédure classique de demande d’acte (Article 81 du CPP).
L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues à l'article 144 sont réunies.
4.4.3 - Eviter l’incarcération au moment du jugement : les peines alternatives
La loi prévoit que l’emprisonnement doit être considéré comme une sanction ou mesure de dernier recours. Ainsi le juge correctionnel doit motiver spécialement chaque décision d’incarcération pour expliquer son caractère « indispensable » (article 132-19 du Code Pénal).
Des paliers sont définis (article 464-2 du Code de Procédure Pénale). Pour une peine d’une durée inférieure ou égale à un an, le juge doit aménager la peine, ou motiver spécialement l’incarcération. Pour une peine d’une durée supérieure à un an, aucun aménagement n’est possible mais le juge doit également motiver spécialement sa décision de prononcer une peine d’incarcération supérieure à un an.
Le juge peut également décider de peines alternatives exécutées en dehors de la prison, dites pour cela « de milieu ouvert », par opposition à l’exécution de la peine en établissement pénitentiaire dite en « milieu fermé ».
Certaines des obligations assignées aux condamnés par les jugements dans ce cadre incluent en effet des obligations de suivre des soins.
Le juge correctionnel peut prononcer, à la place d’une peine de prison, différentes peines : l’amende, le jour-amende, les peines privatives ou restrictives de droits, la peine de stage et la sanction-réparation (article 131-3 CP) :
A. Le jour-amende (article 131-5 CP) :
« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante. »
B. La peine de stage (article 131-5-1 CP) :
« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen. Les modalités et le contenu de ce stage sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, doit être effectué aux frais du condamné.
Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat. »
La liste des stages comprend le stage de citoyenneté, le stage de sensibilisation à la sécurité routière, ou encore le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
C. Les peines restrictives de liberté (article 131-6 CP) :
a. Suspension de permis, annulation, confiscation, etc.
b. Le travail d'intérêt général (TIG) (article 131-8 CP) :
La personne condamnée évite l'incarcération si elle accepte de travailler pendant une durée définie dans le cadre d'un organisme chargé d'une mission d'intérêt général. Sa durée est comprise entre 20 et 400 heures. Il est applicable aux mineurs de 16 à 18 ans s’ils étaient âgés de 13 ans au moment des faits.
Le TIG peut également être prononcé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, d’une surveillance judiciaire ou un aménagement de peine (article 132-45 du Code Pénal).
c. La sanction-réparation (article 131-8-1 CP) :
« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.
Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention. »
Une peine est prévue en cas de non- respect de la mesure : jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
4.4.4 - L’exécution de la peine d’emprisonnement hors les murs de la prison
Le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme n’implique pas automatiquement l’incarcération.
En effet, plusieurs mécanismes, soit au moment du prononcé de la peine soit en aménagement de peine, permettent d’éviter l’incarcération. En effet, outre les mécanismes développés dans cette partie, le juge correctionnel peut prononcer une peine de prison tout en prononçant son aménagement ab initio (voir paragraphe 3.b). Pour une peine d’une durée inférieure ou égale à un an, le juge doit aménager la peine, ou motiver spécialement l’incarcération (article 464-2 CPP). S’il prononce l’aménagement, il peut décider du type d’aménagement ou renvoyer au juge d’application des peines le soin de définir celui le plus en adéquation avec la personnalité du condamné.
- A. La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) (article 131-4-1 CP) :
La détention à domicile sous surveillance électronique permet de ne pas être incarcéré et d’effectuer sa peine à domicile. La personne porte un bracelet à la cheville et doit respecter des horaires fixés par le magistrat pendant lesquels elle doit demeurer dans un périmètre spécifié. A d’autres heures, elle peut être autorisée à sortir du domicile pour travailler, recevoir des soins, suivre une formation, participer à la vie familiale, etc. Si la personne ne respecte pas les horaires où elle doit rester au domicile, le juge peut décider de révoquer la mesure et de l’incarcérer.
La DDSE peut êtreprononcée en tant que peine ou en tant qu’aménagement de peine. Sa durée ne peut dépasser 6 mois. Elle est applicable aux mineurs de plus de 13 ans.
- B. Le sursis simple (article 132-29 CP) :
Le sursis simple dispense le condamné d’exécuter tout ou partie de la peine prononcée. Le sursis simple peut être total ou partiel.
Il ne peut être appliqué que pour les peines prononcées au maximal de 5 ans. Le condamné peut en bénéficier si, dans les cinq ans qui ont précédé les faits, il n’a pas été condamné à une peine privative de liberté pour crime ou délit de droit commun. Les sursis déjà prononcés alors que la personne était mineure sont, sauf exception, purgés du casier judiciaire aux 18 ans de l’intéressé.
Le sursis simple peut être révoqué si, dans le délai d’épreuve, la personne condamnée commet un crime ou un délit pour lequel une nouvelle condamnation est prononcée ; cette révocation n’est pas de droit et doit être motivée. Le tribunal qui révoque le sursis peut décider de mettre à exécution tout ou partie de la peine avec sursis. Si le sursis initial était un sursis partiel, la révocation du sursis ne peut être prononcée qu'une seule fois. La peine avec sursis ne peut pas être révoquée à plusieurs reprises.
- C. Le sursis probatoire (article 132-40 CP) :
Le sursis probatoire suspend l'exécution d'une peine d'emprisonnement, à condition que le condamné respecte les obligations et interdictions qui lui sont fixées par le tribunal. Il peut être total, c'est-à-dire que toute la peine de prison est suspendue et ne sera pas mise à exécution si le condamné respecte les obligations et interdictions fixées par le tribunal. Il peut aussi être partiel, c'est-à-dire qu'une partie de la peine est suspendue et qu'une autre partie, qui est de la prison ferme, doit être exécutée.
Le sursis probatoire peut être appliqué aux peines suivantes :
- peines de prison de 5 ans maximum
- peines de prison de 10 ans maximum en cas de récidive.
Le sursis probatoire total ne peut pas être prononcé si le condamné est en état de récidive et que :
- il a déjà été condamné 2 fois à des sursis probatoires pour des délits identiques ou assimilés
- ou qu'il a déjà été condamné 1 fois à un sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés à l'infraction qui est jugée et que cette nouvelle infraction est grave (crime, violences volontaires, agression sexuelle, atteinte sexuelle), ou a été commise avec la circonstance aggravante de violence.
Le sursis probatoire ne peut pas non plus être prononcé si une peine de travail d'intérêt général (TIG) et/ou un suivi socio-judiciaire a été prononcé par le tribunal.
Les obligations de la personne condamnée sont fixées directement par le tribunal qui prononce la condamnation. Le juge de l'application des peines (JAP) contrôle le respect de ces obligations. Certaines mesures sont obligatoires et tous les condamnés doivent les respecter (article 132-44 du Code pénal). Selon sa situation et l'infraction qu'il a commise, le condamné peut être en plus soumis à plusieurs autres mesures choisies par le tribunal ou le JAP durant le délai d'épreuve (article 132-45 du Code pénal), comme par exemple celle de se soigner. La personne est alors contrainte de suivre les soins décidés par un psychiatre référent, une rupture de soins pouvant entraîner une incarcération. Cette obligation de soins peut également être décidée par le juge de l'application des peines. Cette condamnation est souvent prononcée quand les personnes ont des conduites addictives (alcool, drogues illicites, etc.) ou souffrent de troubles psychiques.
Le sursis probatoire peut être accompagné d’un suivi renforcé (article 132-41-1 du Code Pénal) quand les faits de l’espèce, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné le justifient. Si la juridiction de jugement a assez d’éléments, elle peut définir les obligations et interdictions imposées, ou à défaut laisser le JAP les définir. Si la juridiction n’a pas décidé du suivi lors du prononcé du sursis, le JAP peut décider de le mettre en place à tout moment. Le suivi doit faire l’objet d’une évaluation au minimum une fois par an.
Le condamné doit respecter l’ensemble de ces obligations pendant une durée appelée délai probatoire. La durée du délai probatoire est fixée par le tribunal. Si le condamné n'est pas en récidive, le délai probatoire est compris entre 1 et 3 ans. Si le condamné est en récidive, le délai probatoire est compris entre 1 et 5 ans. En cas de double récidive, le délai probatoire peut aller de 1 à 7 ans.
Le délai probatoire est suspendu pendant toute incarcération (assignation à résidence sous bracelet électronique, détention provisoire, et emprisonnement en prison ou aménagé en DDSE, en semi-liberté ou en placement à l'extérieur).
Si le condamné a respecté toutes les obligations qui lui étaient imposées pendant la durée du délai probatoire, la peine ne sera pas mise à exécution. Elle sera effacée du bulletin n°2 du casier judiciaire, mais restera sur le bulletin n°1.
Si le sursis probatoire n'est pas respecté, le sursis probatoire peut être révoqué. Cela veut dire que la personne effectue tout ou partie de la peine prononcée initialement. Le sursis probatoire peut être révoqué en partie ou entièrement.
D. L’ajournement de peine (article 132-60 CP) :
L’ajournement de peine est prononcé lorsque le condamné est en voie d’être reclassé. Si à l’issue du délai fixé par la juridiction, les conditions de la dispense de peine sont remplies, elle est prononcée.
E. Le fractionnement de peine (article 132-27 CP) :
Le fractionnement de peine est prononcé pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, lorsque la peine prononcée est inférieure ou égale à 2 ans si la personne est primaire ou un an si elle est récidiviste. Le fractionnement ne peut excéder 4 ans et ne peut être inférieur à des périodes de 2 jours.
4.4.5 - Le suivi socio-judiciaire (SSJ)
Le suivi socio-judiciaire concerne tant la matière correctionnelle que criminelle. Il ne peut toutefois être une peine principale qu'en matière correctionnelle (Art. 131-36-7 CP). En tant que peine complémentaire, il accompagne une peine privative de liberté sans sursis (Art. 131-36-5 CP). Le suivi socio-judiciaire peut s'appliquer à une personne libre comme à une personne qui est déjà incarcérée.
Le suivi socio-judiciaire est applicable aux mineurs. Cependant, par exception, le mineur ne peut faire l'objet d'un suivi socio-judiciaire assorti d'un placement sous surveillance électronique mobile.
A. Infractions encourant le suivi socio-judiciaire
L'article 131-36-1, alinéa 1er, du code pénal dispose que la juridiction de jugement peut prononcer un suivi socio-judiciaire « dans les cas prévus par la loi », c’est-à-dire en cas d’une des infractions suivantes :
- meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie (Art. 221-9-1 CP) ;
- infractions visées aux articles 222-23 à 222-32, soit viol simple ou aggravé, agression sexuelle simple ou aggravée et exhibition sexuelle (art. 222-48-1) ;
- infractions visées aux articles 227-22 à 227-27, soit corruption de mineurs, diffusion, fabrication, etc. d'images pornographiques contenant l'image d'un mineur, diffusion, fabrication transport de messages pornographiques ou violents ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, atteinte sexuelle sans violence ni contrainte sur un mineur de 15 ans simple ou aggravée (art. 227-31) ;
- « atteintes volontaires à la vie » du chapitre relatif aux atteintes à la vie de la personne (Art. 221-9-1) ;
- infractions prévues par la section « De l'enlèvement et de la séquestration » (art. 224-10) ; disparitions forcées (Art. 221-15) ;
- infractions de la section « de la réduction en esclavage et de l'exploitation de personnes réduites en esclavage » (Art. 224-10) ;
- infractions prévues aux articles 322-6 à 322-11, soit les destructions et dégradations dangereuses pour les personnes (art. 322-18) ;
- infractions de violences aggravées visées aux articles 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14, soit respectivement violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité (art. 222-10), une incapacité totale de travail durant plus de huit jours (art. 222-12), ou, sans incapacité, que ce soit à titre occasionnel (art. 222-13) ou habituel (art. 222-14) ;
- menaces commises par le conjoint de la victime ou le partenaire lié à la victime par un PACS ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un PACS (art. 222-48-1) ;
- lorsqu'un assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ainsi que le meurtre en bande organisée contre ces praticiens (art. 221-3 et 221-4) ou encore en matière de terrorisme (art. 421-7).
Le suivi socio-judiciaire est obligatoire, lorsqu'il s'agit d'infractions et violences des articles 222-8, 222-10, 222-12,222-13 et 222-14 lorsqu'elles sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif et constituent des violences habituelles (art. 222-48-1, al. 3), sauf exceptions précisées dans la loi.
B. Obligation dans le cadre du suivi socio-judiciaire :
Le SSJ emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive.
La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale.
Selon l'article 131-36-4 du code pénal, le SSJ est (sauf décision contraire de la juridiction) assorti d'une injonction de soins. Cependant, celle-ci ne peut être prononcée que « s'il est établi » que l'intéressé « est susceptible de faire l'objet d'un traitement », ce qui est déterminé par une expertise médicale. L’injonction de soins a un caractère obligatoire pour le condamné. À défaut de soumission aux soins, est applicable la mise à exécution d'une peine prédéterminée par la juridiction répressive.
4.4.6 - Éviter l’exécution de l’incarcération après la condamnation
Une fois la condamnation prononcée par la juridiction de jugement, le juge d’application des peines (JAP) devient seul compétent concernant l’exécution de la peine. Il est ainsi compétent pour prendre l’ensemble des décisions développées dans cette partie.
4.4.7 - Principaux critères de décision du Juge d’Application des Peines (JAP)
Le Juge d’Application des Peines est le magistrat référent lorsque la condamnation privative ou restrictive de liberté devient définitive. Il est compétent pour octroyer, contrôler et sanctionner les mesures d’aménagement de peine prononcées sur la base d’un rapport du Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (CPIP) ou sur réquisition du procureur de la République (Art 712-4 CPP).
Les décisions d’aménagements de peines du JAP se font en débat contradictoire avec la personne concernée.
Décision du Conseil Constitutionnel n°2020-884 QPC du 12 février 2021 M. Jacques G.
"Lorsque le condamné est un majeur protégé, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n'imposent au juge de l'application des peines d'informer son tuteur ou son curateur afin qu'il puisse l'assister en vue de l'audience. Or, en l'absence d'une telle assistance, l'intéressé peut être dans l'incapacité d'exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles, et ainsi opérer des choix contraires à ses intérêts. Faute de prévoir en principe une telle information, ces dispositions méconnaissent les droits de la défense. Censure."
Dès lors, bien que le JAP ne soit pas tenu textuellement parlant par le code de procédure pénale d’informer le curateur ou le tuteur de la personne condamnée, le défaut de cette information entraine le non-respect du principe contradictoire.
L’information de curateur ou du tuteur de la personne protégée pour décider de l’application de sa peine est par conséquent obligatoire et nécessaire pour que l’intéressé comprenne parfaitement les tenants et les aboutissants des modalités d’exécution de sa peine.
Le JAP tenu par la demande d’aménagement de peine faite par le condamné. Toutefois, jusqu’au jour du débat contradictoire et y compris pendant le débat, l’intéressé peut solliciter une autre mesure d’aménagement de peine que celle sollicitée au départ. Le JAP ou la Chambre d’Application des Peines n’est pas tenu d’examiner cette demande.
Le JAP doit prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences éventuelles de ses décisions.
Les décisions du JAP sont susceptibles d’appel devant la Chambre de l’Application des Peines (CHAP) dans un délai de 10 jours.
Le JAP est assisté dans ses missions par les CPIP. Les entretiens individuels que ceux-ci ont avec les personnes sous main de justice leur permettent d’évoquer avec elles les modalités du déroulement de la peine prononcée et d’envisager, en accord avec elle, les éventuels aménagements de peine pouvant être proposés au juge. Une fois l’aménagement décidé (il en va de même pour une peine alternative prononcée dès le jugement), le CPIP veille au respect des obligations et interdictions définies par les magistrats.
Le JAP peut procéder ou faire procéder sur l’ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions permettant de rendre une décision d’individualisation de la peine ou de s’assurer qu’un condamné respecte les obligations qui lui incombent (Art.712-16 CPP).
Afin d’apprécier la demande d’aménagement de peine, le JAP prend en considération les éléments factuels que sont la nature, la gravité et la durée des faits, le lieu de commission par référence (lieu de résidence de la victime) et la date de la commission des faits.
Il prend également en compte de nombreux éléments de personnalité du condamné :
A. La situation professionnelle :
L’aménagement de peine n’est pas conditionné à l’emploi. Il peut notamment être prononcé en cas de recherche d’emploi ou de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation, c’est-à-dire d’une implication dans un projet d’insertion et de probation, laquelle doit être prouvée par les pièces apportées à l’audience et par le rapport du CPIP. L’aménagement choisi peut être influencé par l’activité exercée (planning variable, non-réintégration quotidienne du domicile…).
B. L’hébergement :
En cas d’hébergement précaire ou instable, le JAP choisira plutôt le placement extérieur ou la semi-liberté plutôt que la DDSE.
Afin de maximiser les chances d’obtenir un aménagement de peine, il est donc primordial d’avoir un hébergement ou au logement adapté aux besoins de la personne (structure d’hébergement, structure médico-sociale, etc.). Il convient de se rapprocher du SPIP en vue d’engager les démarches. Toute demande d’hébergement ou de logement adapté doit être adressée au Service Intégré d’Accueil et d’Orientation[1] (SIAO), présent dans chaque département. Si la personne détenue présente un handicap justifiant une prise en charge dans une structure médico-sociale, une demande devra être déposée auprès de la MDPH en vue d’une décision d’orientation vers l’établissement adapté à sa situation (foyer d’accueil médicalisé, maison d’accueil spécialisé, etc.). Des associations gestionnaires de structures d’hébergement ou de structures médico-sociales sont susceptibles d’accueillir les personnes atteintes de troubles psychiques, notamment les membres de la Fédération des acteurs de la solidarité[2] (anciennement FNARS), de la Fédération Santé Habitat[3] (gestionnaire d'Appartements de Coordination Thérapeutique), du réseau des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)[4] et l'Association l'Îlot[5]. Enfin, il est possible de recourir à des dispositifs spécifiques. A titre d’exemple, le programme « Un chez soi d'abord »[6] présent dans de nombreuses villes en France, destiné à des malades psychiques sans solution d’hébergement, dont des sortants de prison, repose sur un accès direct au logement avec un fort accompagnement social et médical.
Le site de l’UNAFAM propose un répertoire des structures sociales et médico-sociales pouvant accueillir des personnes malades psychiques : http://www.unafam.org/-Les-structures-specialisees-.html
Certaines de ces structures sont conçues exclusivement pour les personnes handicapées psychiques, d’autres ne sont pas exclusivement consacrées au handicap psychique mais les accueillent en nombre significatif et dans des conditions adaptées. L’UNAFAM est organisée en délégations départementales présentes sur l’ensemble du territoire national, en lien avec les directions départementales des Agences Régionales de Santé et les Maisons Départementales du Handicap, auprès desquelles peuvent être demandées des informations fines sur les structures sanitaires et médico-sociales locales propres à la psychiatrie.
C. La situation pénale et le parcours pénal
Le JAP apprécie la volonté de changement, afin de vérifier l’adhésion du condamné au projet d’aménagement. Il s’appuie pour cela sur l’enquête du SPIP ainsi que sur l’entretien avec l’intéressé. Il s’intéresse aux antécédents judiciaires du condamné, afin de savoir si l’infraction pour laquelle il a été condamnée est isolée ou non. Si de précédentes mesures d’aménagement ont été prises, le JAP regarde si elles ont échoué, s’il y a eu des retraits de mesures ou des révocations de sursis et les dates de ces retraits et révocations.
D'autres éléments peuvent être pris en compte :
la situation familiale, les moyens de locomotion disponibles (possession du permis de conduire…), la situation financière (ressources et charges)...
[1] circulaire interministérielle du 13 mai 2016 relative à la coordination entre les SIAO et les SPIP pour l’accès à l’hébergement et au logement des personnes sortant de détention ou faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur
[2] http://www.federationsolidarite.org/
[3] http://www.sante-habitat.org/
[4]http://annuaire.action-sociale.org/etablissements/readaptation-sociale/centre-hebergement---reinsertion-sociale--c-h- r-s---214.html
[5] https://ilot.asso.fr/
[6] https://www.youtube.com/watch?v=l_rFTfvxgc0
5 - Les droits de la personne incarcérée
Ce chapitre a été écrit avec l’aide des associations Avocats pour la Défense des Droits des Détenus (A3D) et Prison Insider. Il apporte un éclairage sur une forme de droit en pleine évolution combinant droit administratif et droit des droits de l’Homme. La sélection de jurisprudence présentée la met en relief.
5.1 - Interdiction traitements inhumains et infamants, des atteintes à la dignité
C’est l’un des domaines où la jurisprudence se réfère fréquemment aux textes internationaux, en particulier à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, sur la base de laquelle plusieurs arrêts de la Cour Européenne des Doits de l’Homme ont condamné la France.
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Recommandation du Conseil de l’Europe N° R(87) 3 du 12 février 1987 Paragraphe 100.1
« Les aliénés ne doivent pas être détenus dans les prisons et des dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans les établissements appropriés pour malades mentaux »
"En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi."
La Cour a conclu à la violation de l’article 3 en raison des conditions matérielles dans lesquelles les requérants ont été détenus en particulier du manque d’espace personnel dont ils ont disposé.
« 255. La norme minimale pertinente en matière d’espace personnel est de 3 m², à l’exclusion de l’espace réservé aux installations sanitaires (Muršić, précité, §§ 110 et 114). Lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², la Cour considère ce qui suit :
« 137. (...) le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (...).
138. La forte présomption de violation de l’article 3 ne peut normalement être réfutée que si tous les facteurs suivants sont réunis :
1) les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont courtes, occasionnelles et mineures (...) ;
2) elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates (...) ;
3) le requérant est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, et il n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention (...). » (idem, §§ 122 à 138). […]
« D’autres aspects des conditions de détention sont à prendre en considération dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base. Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation du caractère adéquat ou non des conditions de détention. »
Violation de l’art. 3 : malade psychique placé en détention avec autres détenus non malades et traité de la même manière, alors que la nature de sa condition psychologique le rendait plus vulnérable que les autres
5.2 - Non-respect du droit aux soins en prison
Le droit à la santé des personnes détenues est un droit fondamental. Il repose sur des obligations claires et précises imposées à l'administration pénitentiaire et aux autorités sanitaires. Le non-respect de ces obligations peut constituer une atteinte grave à la dignité humaine et engager la responsabilité de l'État.
Quelques jurisprudences permettent de connaître l’application de ce droit fondamental.
- Décision du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES du 15 janvier 2019.
http://nantes.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Jurisprudence/Decisions-2019
L‘Etat a été condamné à verser 800 € à un détenu pour des conditions d’accès aux soins au cours d’extractions médicales.
Il se plaignait d’avoir été menotté et entravé pendant les rendez-vous qui se sont déroulés en présence constante du personnel de l’escorte pénitentiaire.
Il dit aussi avoir renoncé à de nouvelles extractions de peur de subir le même traitement.
- Arrêt du CONSEIL D’ETAT du 26 avril 2019.
Il incombe à l’administration pénitentiaire de prendre les mesures propres à protéger la vie des détenus et en particulier d’accomplir toutes les diligences en vue de leur faciliter l’accès aux soins . ( art.R 6111-29 du code de la Santé Publique).
En l’espèce la détenue demandait la levée immédiate de la mesure d’isolement à la maison d’arrêt de Fresnes et de lui garantir sans délai un suivi psychiatrique régulier, à raison d’un rendez- vous minimum tous les quinze jours auprès d’un médecin psychiatre.
Jurisprudence de la CEDH au regard de l'article 3 de la Convention :
- Arrêt CEDH : 23/02/2012. Le maintien d’un détenu schizophrène dans un établissement pénitentiaire inapte à l’incarcération des malades mentaux viole l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
x, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d'un traitement donné sur leur personne (voir, par exemple, Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 82, série A no 244, et Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, § 66, Recueil 1998‑V)
La CEDH conditionne la régularité de la détention (article 5 de la Convention EDH) à l'exécution de la peine privative de liberté dans un établissement approprié :
Article 5 de la Convention – Droit à la liberté et à la sûreté
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...)
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ; (...)».
- Arrêt de principe en la matière
Arrêt CEDH Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985
https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/1985/CEDH001-61983
Violation de l’article 5§1 : La Cour estime que la régularité de la détention implique qu’il y ait un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté, et le lieu et les conditions de la détention.
Ainsi, elle considère que, la détention d’une personne atteinte de troubles psychique ne sera considérée, en principe, comme régulière, que si elle se déroule « dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié».
Le juge italien a ordonné, compte tenu de son état de santé mental, le transfert en REMS d’une personne détenue souffrant de troubles psychiques. Ce transfert n’a pas eu lieu. La Cour considère que le maintien du requérant en détention ordinaire, pendant deux ans, sans bénéficier « d’aucune stratégie thérapeutique globale » constitue une violation de l’article 3 de la Convention.
La Cour a également condamné l’état Italien sur le terrain de l’article 5§1 de la ConvEDH car il n’existait plus, de lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu et les conditions de la détention. Le requérant nécessitait des soins en REMS du fait de son état de santé, et sa détention dans un établissement pénitentiaire ordinaire était inadapté.
L’Etat défendeur avançait des arguments logistiques et financier, en expliquant qu’il n’y avait pas de places disponibles en REMS. La Cour a refusé de faire droit à cet argument et regrette que les autorités nationales n’aient pas « créé de nouvelles place au sein des REMS ni trouvé une solution. Il l[les autorités ]leur revenait d’assurer au requérant qu’une place en REMS serait disponible ou de trouver une solution adaptée »(§135).
5.3 - Mesures disciplinaires en milieu pénitentiaire
La faute disciplinaire consiste pour la personne détenue en un manquement à ses obligations. Celles-ci sont précisées dans le code de procédure pénale, ainsi que dans le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est détenue provisoirement ou en exécution de peine.
Ces manquements peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire ainsi que d’une procédure pénale. La procédure pénale ne peut avoir lieu que lorsque les faits sont susceptibles de revêtir une qualification pénale.
L’opportunité des poursuites appartient au chef d’établissement pénitentiaire, lequel préside également la commission de discipline.
1. La Commission de discipline
La commission de discipline est composée de son président et de deux assesseurs (un gradé du personnel de l’établissement pénitentiaire et un membre extérieur manifestant un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires). La voix des assesseurs est consultative.
Si le chef de l’établissement décide d’une poursuite disciplinaire, la personne est convoquée par écrit devant la commission de discipline. Ses droits lui sont rappelés dans la convocation. Elle est informée des faits qui lui sont reprochés, de la date et de l’heure de sa comparution, du délai dont elle dispose pour préparer sa défense ainsi que de son droit d’être assistée par un avocat. Le délai pour préparer sa défense ne peut être inférieur à 24 heures.
2. Les sanctions disciplinaires
Les sanctions qui ont été prononcées par la commission de discipline à l’encontre d’une personne détenue constituent un critère d’appréciation de sa personnalité aux stades du jugement et de l’aménagement de peine. Toute sanction disciplinaire entraine de plein droit une décision de retrait des crédits de réduction de peine par le Juge d'Application des Peines.
Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité en trois catégories (1er, 2nd, 3ème degré).
Les sanctions pouvant être prononcées diffèrent selon que la personne est majeure ou mineure.
Pour les personnes majeures, les sanctions sont prévues aux articles 57-7-33 et 34 du code de procédure pénale. Le panel des sanctions va de l’avertissement au placement en cellule disciplinaire.
La personne visée par les poursuites peut être placée en cellule disciplinaire ou confinée en cellule seule de manière préventive pendant deux jours ouvrables au maximum. Le placement n’est possible que lorsque les faits seraient constitutifs des fautes des premier et deuxième degré. De plus la mesure de placement doit être proportionnelle aux objectifs suivants : nécessité de mettre fin à la faute et/ou nécessité de maintenir l’ordre dans l’établissement.
3. Les recours contre les sanctions disciplinaires
La décision de la commission est rendue le jour même, et notifiée à l’intéressée et à son avocat. La personne dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour contester la décision devant la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP).
La DISP doit répondre à la demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Le silence de la DISP vaut rejet. La personne ne peut bénéficier de l’aide juridictionnelle dans le cadre du recours devant la DISP.
La personne peut contester la décision implicite ou explicite de la DISP en exerçant un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif compétent (ressort dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire) dans le délai de deux mois à compter de la décision de rejet ou de l’échéance du délai de réponse.
Dans le cas où la personne est placée en cellule disciplinaire (de manière préventive ou à titre de sanction) et qu’il est manifeste qu’elle n’est pas l’auteure des faits qu’on lui reproche, elle peut saisir le Tribunal administratif d’un référé liberté sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative. Le juge doit alors statuer dans un délai de 48 heures.
Lorsqu’il constate l’urgence ainsi que la violation manifeste d’une liberté fondamentale (traitements inhumains ou dégradants), le juge administratif peut suspendre la mesure manifestement illégale prise par l’administration. Ce recours n’est envisageable que s’il existe des éléments permettant de considérer qu’il y a eu violation manifeste d’une liberté fondamentale.
5.4 - Dignité et détention – Le recours de l’article 803-8 du Code de procédure pénale
Suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) le 30 janvier 2020 (arrêt JMB et autres c/France) pour l’indignité de ses conditions de détention ainsi que l’absence de voie de recours effective pour y mettre un terme, l’Etat a été mis dans l’obligation de mettre en place une voie de droit pour les détenus permettant de répondre rapidement aux atteintes portées à leur dignité.
En effet, par une décision du 2 octobre 2020, le Conseil constitutionnel a considéré qu’il incombait au législateur de garantir aux détenus la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine afin qu’il y soit mis fin .
La Cour de cassation avait déjà, le 8 juillet 2020, imposé au juge judiciaire d’ordonner la libération d’une personne en détention provisoire lorsqu’il n’existait aucun autre moyen de mettre fin à ses conditions de détention indignes.
C’est ainsi qu’une procédure particulière a été mise en place par la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 « tendant à garantir le respect de la dignité en détention » : article 803-8 du Code de procédure pénal), tant pour les détenus incarcérés à titre préventif que pour les détenus condamnés.
Peuvent être saisis :
- Le juge des libertés et de la détention (JLD) en cas de détention provisoire (article 144-1 du code de procédure pénale, al.2 : « Sans préjudice des dispositions de l'article 803-8 garantissant le droit de la personne d'être détenue dans des conditions respectant sa dignité, le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies. »
- Le juge de l’application des peines (JAP) en cas de condamnation (article 707 du code de procédure pénale : « III.-Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. Le droit de cette personne d'être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti par l'article 803-8. »)
Le requérant doit apporter, lors de l’introduction de sa requête, un commencement de preuve constitué « des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles » de ses conditions de détention. Il pourra demander à se faire entendre s’il l’estime nécessaire.
Dans un premier temps, le juge vérifie les allégations et recueille les observations fournies dans un délai de 10 jours par l’administration pénitentiaire. Il signale ensuite à l’administration les conditions de détention contraires à la dignité et lui accorde un délai de 10 jours à un mois pour y remédier. Celle-ci doit alors prendre toutes les mesures utiles, quitte à transférer le requérant dans un autre établissement pénitentiaire.
Passé ce délai, si le juge constate qu’aucune mesure efficace n’a été prise pour mettre fin aux conditions de détention indignes, il peut ordonner par une décision motivée :
- Le transfèrement ou l’aménagement de peine de la personne détenue
- La mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, éventuellement assortie d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec bracelet électronique
Cependant, le juge peut refuser d’ordonner de telles mesures si le requérant s’est préalablement opposé à un transfèrement proposé par l’administration pénitentiaire. Le requérant ne peut refuser le transfert que s’il porte une « atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale » en raison du lieu de résidence de sa famille.
Enfin, ce recours peut se combiner aux procédures administratives. Il n’exclut pas, en effet, la possibilité de saisir le juge administratif des recours prévus aux articles L 521-1 à L 521-3 du Code de justice administrative. Cependant, ces procédures de référé sont limitées par les conditions strictes posées : le juge ne peut ordonner des mesures qu’au regard des moyens dont dispose l’administration pénitentiaire et des mesures déjà prises.
Aussi, si les allégations de la requête du détenu sont "circonstanciées, personnelles et actuelles", le juge judiciaire la déclare recevable, fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai de trois à dix jours.
Les décisions du juge peuvent faire l’objet d’un appel dans les 10 jours de la notification de la décision. L’appel du ministère public est suspensif s'il est formé dans un délai de 24 heures.
Ce texte crée, en apparence, un recours efficace contre les conditions indignes de détention. Cependant, la Contrôleur générale des lieux de privation des libertés, Mme Dominique Simmonot, a observé que ce recours « ne peut être regardé comme suffisant pour préserver les droits des personnes détenues. Il semble au contraire avoir pour objectif principal de limiter les conséquences des jurisprudences en faisant obstacle aux recours qu’elles créent et même en restreignant les prérogatives du juge au profit de celles de l’administration pénitentiaire »[1]. Le rôle du juge semble relativement limité lors de la première phase du recours : Il constate simplement l’existence de conditions de détention indignes et demande à l’administration pénitentiaire d’agir. Celle-ci est seule compétente dans le choix des mesures à prendre et aucun pouvoir d’injonction déterminée n’est offert au juge. De plus, le risque de se voir éloigner de leurs familles risque de dissuader les détenus et prévenus de se saisir de ce recours prévient l’Observatoire international des prisons[2].
[1] Lettre du CGLPL au Président et aux membres de la Commissions des lois du Sénat, réf. N° 173516/MS, 2 mars 2021. (http://www.senat.fr/seances/s202103/s20210308/s20210308002.html)
[2] Observatoire international des prisons (OIP)–Section française, « Dignité en détention : une loi en demi-teinte qui manque son objectif », 19 mars 2021 (https://oip.org/communique/dignite-en-detention-une-loi-en-demi-teinte-qui-manque-son-objectif/)
5.5 - Comparaison du respect des droits en prison dans huit pays européens
Prison Insider et l'UNAFAM ont publié "L'enfermement à la folie", une enquête sur le respect des droits des personnes ayant des troubles psychiques pendant leur incarcération, dans huit pays européens :

- Pour lire l'enquête sur l'Allemagne : cliquez ici.
- Sur l'Angleterre et le pays de Galles : cliquez ici.
- Sur la Belgique : cliquez ici.
- Sur l'Espagne : cliquez ici.
- Sur la France : cliquez ici.
- Sur Italie : cliquez ici.
- Sur les Pays-Bas : cliquez ici.
- Sur la Suisse: cliquez ici.
6 - Le statut du majeur protégé, du tuteur et du curateur dans la procédure pénale
Ce chapitre, encore largement en chantier, a été rédigé par l’UNAFAM, avec le concours de plusieurs de ses bénévoles avocats, professeurs de droit et magistrats honoraires qui ont eu à traiter professionnellement de ce sujet complexe.
Difficile à respecter du fait de l’absence de fichier central des majeurs protégés que pourraient consulter les autorités judiciaires dans les différentes étapes de la procédure pénale afin d’identifier l’existence éventuelle d’une mesure de protection d’un mis en cause ou d’une victime, le statut du majeur protégé se précise peu à peu sous l’éclairage de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH), de législations récentes et de la jurisprudence interne. Une synthèse de ce droit est proposée ici, élaborée par une équipe constituée d’un magistrat ayant exercé les fonctions de juge des tutelles, d’une avocate et d’un enseignant en droit.
Un arrêt fondateur de la CEDH en date du 30 janvier 2001 (arrêt VAUDELLE) a précisé que « le fait pour une personne placée sous curatelle, de ne pas être assistée ni par son un curateur, ni par son avocat, constitue une violation du droit à un procès équitable. Qu’il n’y a pas de raison qu’un individu reconnu inapte à défendre ses intérêts civils, ne dispose pas d’une assistance pour se défendre contre une accusation pénale dirigée contre lui ».https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-63728%22]}
Sous l’impulsion de cet arrêt, les articles 706-112 et 706-113 ainsi que les articles D 47-14 à D 47-26 du CPP ont défini le statut du majeur protégé dans la procédure pénale.
6.1 - L’information obligatoire du tuteur/curateur tout au long de la procédure
En matière de garde à vue, pour se conformer à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient aux enquêteurs d'aviser le représentant légal d'une personne protégée de son placement en garde à vue dès que les éléments recueillis au cours de ladite mesure sont suffisants pour faire apparaître que l'intéressé bénéficie d'une tutelle ou curatelle en cours.
L’article 706-113 du CPP prévoit : « le procureur de la république ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles des poursuites dont la personne fait l’objet. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites, (d’une médiation), d’une composition pénale, ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. »
NB : Conseil constitutionnel, 18 janvier 2024, n°2023-1076 QPC : La QPC porte sur la première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale qui indique : « Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles ». Cette disposition réglemente l'accès à l'information du dossier et des actes procéduraux d'un tuteur ou d'un curateur en cas de poursuites ou d'alternative aux poursuites concernant un majeur protégé.
Le Conseil constitutionnel a énoncé que : « Dès lors, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l'objet d'une mesure de protection juridique, que le magistrat compétent soit, en principe, tenu d'avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d'être assistée dans l'exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense. ». Le Conseil constitutionnel a décidé de reporter au 31 janvier 2025 la date de l'abrogation de cet alinéa. En attendant, il a indiqué que, si, au cours de la procédure, des indices font apparaître que la personne susceptible d'être déférée fait l'objet d'une mesure de protection juridique, le curateur/tuteur doit être avisé par le magistrat compétent de son défèrement et, si tel est le cas, de sa retenue dans les locaux du tribunal.
Conseil constitutionnel, décision n°2024-1100 QPC du 10 juillet 2024 :
La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel concernant les deux derniers alinéas de l’article 706-113 du code de procédure pénale. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé est avisé de la décision de saisie d’un immeuble appartenant à ce dernier qui est ordonnée au cours de l’enquête ou de l’instruction, ni, en cas de recours, de l’audience devant la chambre de l’instruction.
Le Conseil constitutionnel déclare donc les deux derniers alinéas de l’article 706-113 du code de procédure pénale contraires à la Constitution mais reporte au 1er juillet 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions pour ne pas priver les majeurs protégés de l’obligation pour le procureur de la République ou le juge d’instruction d’aviser le curateur ou le tuteur des autres décisions prévues (non-lieu, relaxe etc.).
L’article 706-113 alinéa 5 du CPP indique que « le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience ». L’article D 47-20 du CPP ajoute qu’« en matière correctionnelle et criminelle, ainsi que pour les contraventions de la 5e classe, le ministère public avise le curateur ou le tuteur de la date et de l’objet de l’audience par lettre avec AR, 10 jours au moins avant la date d’audience ».
L’obligation d’information avant le déclenchement des poursuites :
Cette exigence d’information du mandataire vaut également au stade de l’enquête.
Ainsi, dans le cas des perquisitions, l’article 706-112-3 du code de procédure pénale prévoit : « lorsque les éléments recueillis au cours d'une enquête préliminaire font apparaître qu'une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l'objet d'une mesure de protection juridique révélant qu'elle n'est pas en mesure d'exercer seule son droit de s'opposer à la réalisation de cette opération, l'officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l'assentiment éventuel de la personne prévu aux deux premiers alinéas de l'article 76 ne soit donné qu'après qu'elle a pu s'entretenir avec lui. A défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l'avant-dernier alinéa du même article 76. ».
6.2 - Le tuteur et le curateur peuvent être appelés comme témoins à l’audience
L’article 706-113, alinéa 5 du CPP dispose que « lorsque le curateur ou le tuteur est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin. » L’article D 47-20 du même code précise qu’il « est tenu de prêter serment, mais qu’il n’a pas l’obligation de quitter la salle d’audience avant de déposer. »
Par ailleurs, en vertu de l’article 310 du CPP, « le président (de la Cour d’assises) est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles à la manifestation de la vérité. [...] Il peut, au cours des débats, appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité.» Dès lors le tuteur ou le curateur peut être entendu dans ce cadre sans prestation de serment.
Le statut de témoin ne semble pas toujours adapté : il est peu probable que le curateur ou le tuteur ait été témoin des faits reprochés ; de même, s’il est amené à témoigner sur la personnalité et la moralité du majeur protégé, il peut se trouver en difficulté par rapport à la mission de protection qui est la sienne.
6.3 - La garde à vue : dérogation à l’obligation d’aviser le curateur et le tuteur ?
L’article 706-112-1 du CPP énonce : « Lorsque les éléments recueillis, au cours de la garde à vue d’une personne font apparaitre que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’OPJ ou l’APJ avise, s’il y a lieu le mandataire judiciaire désigné par le juge des tutelles. » […] Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique ».
La formulation de l’article 706-112-1 du CPP introduit en effet une potentielle conditionnalité : le curateur ou le tuteur doit être avisé « lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que (la personne) fait l’objet d’une mesure de protection juridique… »
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité le Conseil Constitutionnel a tranché dans une décision du 14 juin 2018. Concernant la garde à vue, « il résulte en revanche du 3 ° de l'article 63-1 du code de procédure pénale que le majeur protégé est, comme tout autre suspect majeur, immédiatement informé par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de ses droits d'être assisté par un avocat, de faire prévenir certaines personnes de son entourage et, dans les conditions prévues à l'article 63-2 du même code, de communiquer avec elles. Le majeur protégé peut, à ce titre, demander à faire prévenir son curateur ou son tuteur. Les enquêteurs doivent alors, sauf circonstances insurmontables ou refus lié aux nécessités de l'enquête, prendre contact avec le curateur ou le tuteur dans les trois heures suivant la demande. Dans ce cas, le troisième alinéa de l'article 63-3-1 du même code prévoit que le curateur ou le tuteur peut désigner un avocat pour assister le majeur protégé au cours de la garde à vue, sous réserve de confirmation par ce dernier.[…] Dans le cas où il n'a pas demandé à ce que son curateur ou son tuteur soit prévenu, le majeur protégé peut être dans l'incapacité d'exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d'opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l'exercice de son droit de s'entretenir avec un avocat et d'être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations. »
Le Conseil a, en conséquence, déclaré contraire à la constitution l’alinéa 1 de l’article 706-113 CPP qui ne prévoit pas « lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique, que l'officier de police judiciaire ou l'autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle se déroule la garde à vue soit, en principe, tenu d'avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d'être assistée dans l'exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense. » L’abrogation de cette disposition a été reportée au 1er octobre 2021.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018730QPC.htm
Dans sa réponse à la question d’un Sénateur publiée le 14 novembre 2019 au JO du Sénat, la Garde des Sceaux a toutefois tenté de nuancer le caractère absolu de cette obligation reconnu par le Conseil Constitutionnel en considérant que la recherche du tuteur ou du curateur ne serait, pour l’enquêteur, qu’une « obligation de moyens » :
https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ191012653.html
Cette information du mandataire souffre tout de même d’une exception qui remet en cause son caractère obligatoire.
L’article 706-112-1 in fine dispose « Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne. ».
6.4 - Le juge des tutelles averti en cas de sauvegarde de justice ou de mandat de protection future
L’article 706-117 du CPP énonce « le procureur de la république ou le juge d’instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne qui bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice ; le juge des tutelles peut désigner un mandataire spécial, qui dispose des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par l’article 706-113 du CPP ».
Ces prérogatives sont reconnues également au mandataire de protection future.
Si les autorités judiciaires en charge du dossier (le procureur de la République et le juge d’instruction) ne respectent pas les obligations susvisées, la procédure est viciée. La cour de cassation a confirmé l’importance de cette information dans un arrêt en date du 14/04/2010 « le tuteur d’une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet [… et] doit en outre être avisé de la date d’audience. » https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022213127/.
La violation de ces droits est assimilée à une nullité d’ordre public, non subordonnée à la preuve d’un grief. Elle affecte les droits dont dispose le « curateur » ou le « tuteur » tout au long de la procédure, à savoir :
– être avisé des poursuites,
– prendre connaissance des pièces de la procédure ;
– disposer d’un permis de visite ;
– être avisé des différentes décisions judiciaires, de la date d’audience ;
– être entendu par la juridiction.
6.5 - Difficultés de mise en œuvre de l’obligation d’information du tuteur/curateur
Les autorités policières et judiciaires sont souvent confrontées à des difficultés pratiques dans l’application de ces textes. En effet, la plupart du temps, le mis en cause ne fera pas état de l’existence d’une mesure de protection à son égard. De même, les médecins requis n’ont pas toujours connaissance d’une telle mesure.
L’article D 47-14-1 alinéa 2 du CPP précise que « si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l’existence d’une mesure de protection juridique, le procureur de la république, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires. »
En l’absence de l’existence d’un fichier national de la protection juridique consultable (à l’instar du casier judiciaire de l’intéressé) les policiers ou les magistrats en charge du dossier ne peuvent savoir si la personne poursuivie fait l’objet d’une mesure de protection.
Ils peuvent consulter le répertoire civil, ou l’extrait d’acte de naissance de l’intéressé, lequel malheureusement ne mentionne que l’existence d’une mesure de protection, sans la désignation du nom de l’organe tutélaire.
Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 11/12/2018 a ainsi confirmé un arrêt de chambre de l’instruction concernant une garde à vue non notifiée au tuteur au nom de l’impossibilité de vérifier l’existence d’une mesure de protection : En raison des circonstances insurmontables ont fait obstacle à la vérification qui s’imposait et de la dangerosité du suspect, le procureur de la République ne pouvait différer sa décision sur les poursuites. Par ailleurs faute de fichier national des mesures de protection juridique consultable similaire au fichier central du casier judiciaire, seul le juge des tutelles disposait de cette information.
Les magistrats peuvent en pratique toutefois se rapprocher des magistrats du service civil du Parquet, lesquels ont connaissance des décisions des juges des tutelles de leur ressort, puisqu’ ils font des réquisitions écrites aux audiences.
Enfin, l’obligation d’aviser le curateur ou le tuteur ne pèse pas sur le Juge des libertés et de la détention (JLD) lorsqu’il ordonne la mise en détention du mis en examen ou son placement sous contrôle judiciaire. De même cette obligation ne s’applique pas au juge de l’application des peines (JAP), qui est chargé d’aménager les sanctions prononcées par les juridictions.
Pour résumer, l’organe tutélaire :
- doit être avisé des poursuites dont le majeur protégé fait l’objet
- peut désigner ou faire désigner un avocat
- peut solliciter une expertise médicale
- peut prendre connaissance du dossier
- peut s’entretenir avec le majeur protégé.
- doit être avisé des dates d’audiences (devant le juge d’instruction et les juridictions de jugement).
- peut être entendu en qualité de témoin (voir observations ultérieures).
- doit être avisé des décisions rendues (y compris les décisions de relaxe, d’acquittement ou d’irresponsabilité pénale).
- peut disposer d’un permis de visite si le majeur protégé est incarcéré (y compris en détention provisoire).
Cour de cassation – Chambre criminelle 12 mars 2025 / n° 24-85.004 - Selon l’article 706-113 du code de procédure pénale, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé, d'une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet, d'autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée.
Dès lors, entraine la nullité de l’interrogatoire de première comparution, le fait que le curateur n'a pas été avisé de la comparution de son protégé devant le juge d'instruction.
Cour de cassation -- Chambre criminelle 19 mars 2025 / n° 25-80.106 - Mise en liberté d’un majeur protégé en le plaçant sous contrôle judiciaire, l’audience de maintien en détention provisoire s’est déroulé sans que son tuteur n’ait été avisé de la tenue de cette audience.
6.6 - L’exercice des voies de recours
Sur la différente capacité à agir en justice selon la mesure (curatelle/tutelle) :
En matière de curatelle :
Aucun texte n’autorise le curateur à exercer une voie de recours pour le compte du majeur protégé à l’encontre d’une décision de justice rendue par une juridiction répressive.
Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 2/09/2009 a rappelé que l’article 706-113 du CPP ne prévoit pas un droit d’appel pour le curateur : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021085200/
En matière de tutelle :
Aucun texte ne prévoit pour le tuteur la possibilité de faire appel d’une décision rendue par une juridiction répressive à l’encontre du majeur protégé. De même le tuteur ne figure pas dans l’article 497 du CPP qui énumère la liste exhaustive des personnes ayant la faculté d’interjeter appel.
Néanmoins, il semble légitime que le majeur protégé dénué de capacité juridique, puisse être représenté par son tuteur dans les actes de procédure qu’il ne peut accomplir. Il parait en effet équitable qu’une personne sous tutelle condamnée à une peine d’emprisonnement en première instance, puisse faire appel par l’intermédiaire de son tuteur, alors qu’elle ne peut pas exprimer sa volonté.
Dans l’hypothèse où le tuteur rencontrerait une difficulté, par exemple en cas de conflit d’intérêt avec son protégé, il pourrait solliciter l’avis ou l’autorisation du juge des tutelles.
Il s’agit là de sauvegarder les droits fondamentaux du majeur protégé, lequel a, comme tout justiciable, droit à un procès équitable.
Le rôle du tuteur/curateur devant la juridiction d’application des peines :
Le tuteur ou le curateur a la possibilité, en vertu de l’article 712-16-3 du Code de procédure pénale, de « faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l'application des peines, sur décision de son président. », aux moments suivants :
- Lors du débat contradictoire tenu en chambre du Conseil concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique et de libération conditionnelle (article 712-6 du code de procédure pénale)
- Lors du débat contradictoire tenu en chambre du Conseil concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine (article 712-13 du CPP)
- Lors de l’audience d’appel des jugements sus mentionnés (article 712-12 du CPP).
6.7 - L’expertise médicale
L’article 706-112-1 alinéa 2 du CPP prévoit que le curateur ou le tuteur peut demander que la personne soit examinée par un médecin.
L’article 706-115 du même code prévoit que « toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise, avant tout jugement au fond, a une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ».
Toutefois, en matière correctionnelle, le juge peut décider par ordonnance motivée de ne pas soumettre l’intéressé à une expertise médicale dès lors que des certificats médicaux et expertises, figurant dans le dossier de protection juridique, apparaissent suffisants « pour apprécier si l’intéressé était ou non atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ayant aboli ou altéré son discernement », sauf opposition de la personne mise en examen ou du prévenu et de son avocat. (Article D 47-23)
Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 14/11/2019 a précisé que l’expertise médicale avait souligné que, « même si l’intéressé n’était pas en mesure de comprendre toute la subtilité des débats, il était apte à comparaitre devant une juridiction pénale et était accessible à une sanction pénale ». Dès lors, il appartenait aux enquêteurs de police et aux magistrats (Procureur de la République et juges d’instruction) de faire examiner le mis en cause par un médecin, « faute de quoi la procédure est viciée, s’agissant d’une atteinte aux droits de la défense ». https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2019-11-14_1886077&ctxt=0_YSR0MD0xNCBuwrAxOC04Ni4wNzfCp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNlYXJjaA%3D%3D#
Dans un arrêt du 16/12/2020, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé un arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY, qui a condamné une personne sous curatelle sans avoir ordonné d’expertise médicale au motif que « Le défaut d’expertise porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie bénéficiant d’une mesure de protection juridique à l’époque des faits, en ce qu’il ne lui permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale. https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2601_16_46142.html
Enfin, il y a lieu de rappeler que, trop souvent en l’absence d’expertise médicale, seul le certificat d’un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République, ou des certificats antérieurs à la mise sous protection soient versés au dossier.
Cette pratique est regrettable.
6.8 - L’assistance obligatoire par l’avocat
L’arrêt de la CEDH du 31/01/2001 (arrêt VAUDELLE) affirme : « constitue une violation du droit à un procès équitable, le fait pour une personne placée sous curatelle, de ne pas être assistée ni par son curateur ni par un avocat ».
Au cours de la garde à vue, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peut designer ou faire designer un avocat par le bâtonnier (article 706-112-1 du CPP). L’article 706-116 du même code prévoit que la personne poursuivie doit être assistée par un avocat.
A défaut de choix d’un avocat par la personne poursuivie, son curateur ou son tuteur, le Procureur de la République ou le juge d’instruction fait designer par le bâtonnier un avocat qui intervient en commission d’office. Les frais d’avocat sont à la charge de l’intéressé, sauf si celui-ci peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Le majeur protégé ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle de droit. L’aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée en attente de l’obtention de l’aide juridictionnelle (les délais d’instruction des dossiers sont souvent longs).
NB : Si la personne doit être obligatoirement assistée par un avocat, la présence de l’avocat est non obligatoire en ce qui concerne la formulation d'une requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement (Cour de cassation, première chambre civile, 31 janvier 2024, pourvoi 23-15.969.
6.9 - Le majeur protégé, victime d’une infraction pénale
Toute personne victime d’une infraction pénale peut déposer plainte devant les services de police, devant le Procureur de la République, ou se constituer partie civile entre les mains du juge d’instruction.
Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection rencontre des difficultés pour ce faire, elle peut être accompagnée par un proche, un membre d’une association d’aide aux victimes, ou par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (tuteur ou curateur).
Si son état ne lui permet pas d’accomplir une telle démarche, le tuteur ou le curateur peut la représenter ; s’il s’agit de faire valoir un droit extra-patrimonial, le mandataire devra solliciter au préalable l’autorisation du juge des tutelles (par exemple pour introduire une action en diffamation).
Les services de police, dans le cadre de l’enquête, peuvent procéder à l’audition du mandataire judiciaire à titre de simple renseignement.
Par ailleurs, l’article 434-3 du code pénal prévoit que « le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitement, d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison d’une maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, est puni d’une peine de prison et d’amende ».
Dès lors, si le mandataire judiciaire a eu connaissance de l’existence de ces faits, il doit les dénoncer et en rendre compte au juge des tutelles.
Cour d'appel de Bordeaux, 1ère Chambre civile, 24 janvier 2024, n°22/03190 : Pour fixer l'indemnisation d'un majeur protégé victime de violences aggravées et de séquestration, il convient d'examiner les circonstances de l'affaire, notamment dans la fixation de l'indemnisation de l'assistance tierce-personne temporaire. En l'espèce, le majeur protégé vivait déjà dans un foyer avant l'infraction dont il a été victime et rien ne justifie des besoins supplémentaires, la Cour rejette donc la demande fondée sur l'assistance tierce-personne temporaire. En revanche, la Cour revoit le quantum accordé pour l'assistance tierce-personne permanente au vu des conséquences de l'infraction sur les conditions de vie du majeur protégé.
7 - Droit des soins sans consentement
Ce chapitre a principalement été rédigé par l’UNAFAM, association qui représente les familles dans les Commissions Départementales des Soins Psychiatriques aux côtés de médecins, associations de patients et, jusque récemment, de magistrats. Ont aussi fait des apports substantiels l’association Avocats, Droits et Psychiatrie ainsi que la Commission Santé et Bioéthique du Barreau de Paris.
7.1 - Une succession d’ajustements législatifs
Le Code de la santé publique définit les modalités de soins en psychiatrie. Il a fait l’objet de réformes successives à rythme rapide visant à encadrer une étrangeté juridique : des privations de liberté prises par des médecins.
La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 « relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge » a formulé le schéma général visant à « sécuriser les mesures de soins psychiatriques ». Cette loi a été modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013. Principes posés :
- les soins psychiatriques libres sont la règle et les soins psychiatriques sans consentement l’exception ;
- l’hospitalisation complète n’est plus que l’une des modalités de soins psychiatriques sans consentement ;
- l’hospitalisation complète est le passage obligé pour entrer en soins psychiatriques sans consentement ;
- au terme de la « période d’observation et de soins initiale » de soixante-douze heures, l’hospitalisation complète a vocation à s’ouvrirsur d’autres formes (« modalités ») de soins sans consentement.
- les soins psychiatriques sans consentement sont dispensés exclusivement dans des établissements « désignés » par le directeur général de l’agence régionale de santé (article L. 3221-1 du Code de la santé publique).
- les mesures de soins sans consentement n'ont pas vocation à être maintenues indéfiniment ;
- elles doivent être levées dès que les conditions qui les ont justifiées ne sont plus réunies.
La loi n°2016-41 de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 a ajouté des garanties en ce qui concerne la vérification de la nécessité et de la durée des mesures d’isolement et de contention. L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique organise trois garanties :
- les pratiques d’isolement et de contention doivent être un dernier recours ;
- dans chaque hôpital un registre des mises en isolement et en contention est créé;
- chaque établissement doit rédiger un rapport annuel précisant notamment la politique définie pour limiter le recours aux pratiques d’isolement et de contention.
Une décision du Conseil Constitutionnel du 19 juin 2020 (n° 2020-844 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020844QPC.htm) a amené le gouvernement à organiser, dans l’urgence, à travers l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020, le contrôle par le JLD de la durée de l’isolement et de la contention.
Par une ordonnance du 6 janvier 2021 (n°21/008), le JLD a accepté la transmission d’une QPC devant la Cour de cassation au sujet de l’article 84 de la Loi n°2020-1576 au motif que les dispositions ne prévoient pas l’intervention systématique du juge pour des situations constitutives de privation de liberté (atteinte à l’article 66 de la Constitution).
7.2 - Les procédures d’admission en soins sans consentement
7.2.1 - Soins sans consentement à la demande d’un tiers (SDT)
I. L’admission (normale) à la demande d’un tiers
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique fixe les conditions d’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers (SDT) :
« I. – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du Code de la santé publique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°. Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 … »
Lorsque ces deux conditions de fond ne sont pas médicalement établies, le JLD décide de la mainlevée de la mesure.
Plusieurs éléments sont nécessaires, pour satisfaire à ces conditions.
A. Certificats médicaux
¨Pour satisfaire à ces conditions, deux certificats médicaux attestant de la présence de troubles mentaux et de l'impossibilité de consentir aux soins doivent être produits.
L’article L. 3212-1, II du Code de la santé publique précise : « … La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article sont réunies … ».
Les « certificats médicaux », à la différence des « avis médicaux », doivent nécessairement :
- Faire suite à un examen clinique de la personne
- Être établis en conformité avec les règles de la déontologie médicale afférentes à ce type de document.
Les certificats médicaux qui ont accompagné la demande sont les éléments les plus importants pour le JLD chargé d’apprécier l’existence des conditions de fond posées par l’article L. 3212-1, I. Si des éléments médicaux plus récents sont apportés, ils ne sont utiles que pour vérifier le maintien de l’existence de ces conditions à la date à laquelle le JLD effectue son contrôle.
L’article L 3212-1, II du Code de la santé publique dispose :
« … Le premier certificat ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade … ».
Les rédacteurs du premier et du second certificats doivent donc être des praticiens différents, et à la compétence légale différente. Le non-respect de la compétence légale formulée par l’article L. 3212-1 constitue une irrégularité qui peut être soulevée devant le JLD[1].
Les certificats médicaux doivent apporter les preuves de la nécessité de la mesure. Voir l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 7 juillet 2008.
- La notion de surveillance médicale constante
Les certificats médicaux doivent faire ressortir que l’état mental impose une « surveillance médicale » qui doit être « constante » (en hospitalisation complète) ou « régulière » (en soins ambulatoires) (article L. 3212-1, I-2°). Ceci ne signifie pas que le malade hospitalisé doit être surveillé vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ni qu’un médecin ou une équipe médicale doit être à son chevet en permanence, mais « qu’une équipe soignante engagée dans un projet thérapeutique est à tout moment susceptible d’intervenir en cas de besoin » (ministère des affaires sociales et de l’intégration, fiche ministérielle n°1 du 13 mai 1991).
Dans la jurisprudence, la notion de « surveillance médicale constante » déborde du champ des soins sans consentement à la demande d’un tiers et est mentionnée dans des décisions afférentes au champ des soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
B. La qualité de tiers (article L. 3212-1, II-1°)
Conformément à l'article L.3212_1, II-1° du Code de la santé publique, le « tiers » ayant « qualité pour agir dans l’intérêt » du malade, doit rentrer dans l'une des trois catégories :
- celle de « membre de la famille du malade » ;
- celle de « personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci… »
- celle de tuteur ou de curateur d’un majeur protégé.
- Incompatibilités
Quelle que soit la catégorie à laquelle appartient le demandeur, il importe que ce dernier ne soit pas en conflit notoire avec le malade, comme l’a précisé la Cour de cassation le 18 décembre 2014 : : « La Cour attend une approche qualitative de l’intérêt du patient, ce qui exclut en l’occurrence, la sollicitation de tout proche en conflit connu avec le patient. Ainsi, la mainlevée peut être ordonnée par le JLD (TGI de Versailles, ordonnance de mainlevée du JLD du 5 mai 2015, n°15/00452) si le tiers demandeur est l’époux, et que la demande intervient dans un contexte de conflit conjugal, notamment une instance de divorce »[4].
L’article L. 3212-1 énonce aussi une incompatibilité à être tiers demandeur pour « des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade ». En revanche, les assistants sociaux de l’établissement, même s’ils font partie de l’équipe pluridisciplinaire de psychiatrie, ne rentrent pas dans la catégorie du « personnel soignant ». Le tribunal administratif de Limoges a ainsi rendu en 2009 un jugement dans lequel il reconnaît l'intérêt à agir des assistantes sociales mais annule la décision d'admission car cette dernière "n’avait pas justifié de relations antérieures avec la personne” internée (TA de Limoges, 9 avril 2009.
C. Conditions de forme
La demande du tiers doit être manuscrite, datée et signée
La demande du tiers doit répondre à certaines conditions de forme, sans que le JLD soit tenu de relever d’office une irrégularité.
L’article L. 3212-2 du Code de la santé publique dispose :
« Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-I, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l’établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soin. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
D. Respect des délais
Le directeur de l’établissement décide dans le respect de délais.
La procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers est engagée dès lors qu’un tiers a signé une demande d’admission et qu’un premier médecin a rédigé un certificat médical conforme aux dispositions de l’article L. 3212-1. L’engagement de la procédure est créateur de droits pour la personne à l’égard de laquelle elle est engagée et d’obligations pour l’établissement d’accueil (et en premier lieu pour son directeur) (Ministère de la santé, fiche ministérielle n°1 du 13 mai 1991).
Quelle que soit la forme du soin sans consentement, le directeur de l’établissement d’accueil dispose « d'une compétence liée pour toutes les décisions d’admission, de réadmission, de modification de la prise en charge ou de la levée de la mesure de soins qu’il prend » (rapport n°4402 du 22 février 2012 de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale, p.23).
La décision d’admission en SDT est prise par le directeur de l’établissement d’accueil au vu des documents légaux qui lui ont été transmis (demande du tiers et certificats médicaux circonstanciés).
Le directeur de l’établissement qui admet une personne sans demande d’un tiers et des deux certificats médicaux encourt des peines correctionnelles d’emprisonnement et d’amende. Le Conseil d’Etat, le 18 octobre 1989 considérait que le maintien en l’absence d’un tel « titre » de la personne « contre son gré… dans le service constitue une voie de fait ».
a. La décision administrative d'admission doit être prise avant l'entrée dans l'unité de soins
L’absence matérielle de décision administrative d’admission est sanctionnée par la mainlevée de l'hospitalisation. (CA Versailles, ordonnance de mainlevée du 23 mai 2014).
La décision d’admission fait courir le délai légal du contrôle du JLD.
b. La production de l'acte administratif peut être retardée après l'entrée du patient dans l'unité de soins
Le Conseil d’Etat , dans un arrêt du 17 novembre 1997 a précisé que ce possible délai ne saurait dépasser le « temps strictement nécessaire » à l’élaboration de l’acte administratif et ne semble pouvoir être justifié qu’en raison de situations d’urgence et/ou de contraintes structurelles pesant sur l’administration hospitalière (lesquelles semblent davantage relever de la tolérance).
La jurisprudence judiciaire va dans le même sens [5] :
- Une ordonnance de la CA de Paris du 2 mai 2017 (n°17/00154) a confirmé une mainlevée au motif que la décision du directeur d’admettre en hospitalisation sans consentement était rétroactive de deux jours par rapport à l’admission dans le service.
- Délégation de signature
Selon les dispositions de droit commun fixées par le Code des relations entre le public et l’administration en ses articles L. 112-2 et L. 212-1, toute décision prise par une autorité administrative (et donc la décision d’admission en SDT) doit comporter la signature de son auteur, la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
S’il est possible, en vertu de l’article D. 6143-33 du Code de la santé publique, pour le directeur d’établissement, de déléguer sa signature, l’article D. 6143-34 précise que cette délégation doit mentionner :
- le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ;
- la nature des actes délégués ; - - éventuellement les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir cette délégation.
Par ailleurs, Il est prévu par l’article D. 6143-35 du Code de la santé publique que les délégations doivent être "publiées par tout moyen les rendant consultables".
Faute de délégation expresse et publique de signature, le JLD a ordonné une mainlevée en retenant l’incompétence de l’administrateur de l’hôpital(TGI de Dijon, 19 janvier 2012). Ce fut également le cas en appel (CAA Bordeaux, 27 novembre 2012, n°11BX03222). "Les juges rappellent que l’incompétence de l’auteur de l’acte constitue un moyen d’ordre public. Il apparait donc impératif que les pièces justifiant de la publication des délégations soient transmises au JLD. La signature doit être apparente sur les documents qui doivent comprendre de manière lisible le nom, le prénom et la qualité de son auteur, ceci afin de permettre toute vérification relative à la compétence."
Cette exigence de précision a été confirmée en appel (CAA de Paris, 20 janvier 2014, n°12PA01934[6].
Cass Civ 1ère 16 octobre 2024 n°23-11.591 : Si le directeur de l'établissement hospitalier peut donner délégation de signature, celle-ci doit mentionner la nature des actes délégués. La délégation produite est une délégation générale, sans restriction, qui vaut pour tous les actes pouvant être pris par le directeur de l'établissement, donc aussi pour les décisions d'admission ou de maintien en hospitalisation sans consentement et de saisine du juge des libertés et de la détention.
c. cas particulier d'un passage de SPDT à SPDRE
Décision : Cour de cassation, 19 juillet 2022, n°22-70.007 : La Cour de Cassation a rendu la décision suivante: « lorsqu'une personne est hospitalisée d'abord sur décision du directeur d'établissement, puis sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-6 du code de la santé publique, le point de départ du délai de saisine du juge et, par là-même, du délai dont dispose le juge pour statuer, est :
- la date du prononcé de l'admission par le représentant de l'Etat dans le département si le juge des libertés et de la détention s'est déjà prononcé sur la décision prise par le directeur d'établissement ;
- la date du prononcé de l'admission par le directeur d'établissement si la décision du représentant de l'Etat dans le département intervient avant que le juge des libertés et de la détention ait statué sur la décision initiale. »
E. Notification de la décision à la personne et à son tuteur
La décision d’admission obéit à des règles d’information de la personne admise en soins sans consentement, conformément au troisième alinéa de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Chaque individu faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informé le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent. La notification tardive de la décision de maintien dans l’établissement n’entraine pas la mainlevée de la mesure si les décisions ont été prises après recueil des observations du patient, informé du projet de soin et parfaitement en état de comprendre les tenants et les aboutissants d’une telle décision de son maintien dans l’établissement. ( Cass., 1ere civ., 4 décembre 2024, n°24-14.482)
Enfin, l’article L. 3212-5 du Code de la Santé publique établit des règles d’information du représentant de l’Etat, ainsi que de la commission départementale des soins psychiatriques. Jean-Marc PANFILI souligne que : « L’article L. 3215-2 du Code de la santé publique dispose que le fait d’omettre d’adresser au représentant de l’Etat dans le département et dans les délais prescrits, la décision d’admission, les certificats médicaux, et le bulletin d’entrée, est passible d’emprisonnement et d’amende »[2].
L’article L3211-10 du CSP dispose « Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d'admission en soins psychiatriques d'un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par le tuteur. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue. »
Dans un avis du 18 mai 2022, la Cour de cassation explique que cet article s’analyse comme excluant le recours à l’admission en soins psychiatriques contraint sur décision du directeur d’établissement pour les mineurs.
Le recours à l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat reste possible.
II. L’admission à la demande d’un tiers en urgence (SDTU)
L’article L. 3212-3 du Code la santé publique prévoit :
« En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième (certificat de vingt-quatre heures) et troisième alinéa (certificat de soixante-douze heures) de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
« Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ». La demande de tiers doit être « établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 », et donc répondre à toutes les conditions de forme requises par le dispositif précédemment évoqué. L’allégement de la procédure tient dans le fait que le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission « au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ».
[1] Jean-Marc PANFILI - Le juge, l’avocat, les soins, document mis à jour le 23/12/2018, p. 11
[2] Ibid., p. 53
7.2.2 - L’admission en cas de péril imminent et d’impossibilité d’obtenir la demande de tiers (SPPI)
Le « péril imminent pour la santé de la personne » correspond à l’existence d’un danger immédiat pour la santé de la personne à la date d’admission. La procédure se caractérise par une double simplification.
Ainsi, « le péril imminent » justifie l’admission :
- En l'absence de demande de tiers
- Sur la présentation d'un seul certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise :
« II - Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
2°… lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande (de tiers) dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
La première chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé (11 juillet 2019 ; voir aussi 5 décembre 2019), que le certificat médical doit impérativement émaner d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Elle a ensuite souligné l’importance de cette condition en affirmant que « l’irrégularité d’un certificat médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens du dernier texte, mais une défense au fond » (19 décembre 2019, n°19-22946).
La jurisprudence exige la motivation spécifique d’un péril imminent, et s’il n’est pas caractérisé, la mainlevée sera ordonnée.
Par ailleurs, l’information faite à la famille de la personne, le mandataire ou toute personne ayant « qualité pour agir » dans son intérêt donne qualité à cette personne pour saisir le JLD en application du « I » de l’article L. 3211-12, si elle estime que l’admission en SPPI est injustifiée.
Par une ordonnance du 6 janvier 2021 (n°21/008), le JLD du Tribunal judiciaire de Versailles rappelle que tout proche, famille, personne chargée d’une protection juridique, personne justifiant l’existence d’une relation, doit être informé lors de l’admission en soins sans consentement pour péril imminent au regard de l’article L3212-1 al. 2 du Code de la santé publique.
L’atteinte aux droits du patient est avérée lorsque l’établissement n’apporte pas la preuve de la recherche des proches alors même que l’établissement a reçu un avis motivé démontrant l’existence d’une mesure de protection de la personne concernée, en l’espèce, confiée à l’UDAF 33. La main levée est donc justifiée.
Dans un arrêt du 10 février 2021, la Cour de cassation rappelle qu'en cas de péril imminent et lorsque les conditions de l’article L. 3212-1, II, 2°, sont remplies, un directeur d’établissement peut décider de l’admission sans son consentement, d’une personne en hospitalisation complète, même à la suite d’une décision judiciaire de mainlevée.
La décision ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu'à la condition que ce dernier soit annexé à la décision.
Cour de cassation, Première chambre civile, 26 octobre 2022, Pourvoi n°20-23.333 : Dans cette affaire, il s’agit d’une situation d’hospitalisation sans consentement pour péril imminent, pour laquelle il est reproché au directeur d’établissement de n’avoir pas fait toute diligence pour informer la famille de la personne qui a fait l’objet de soins dans un délai de vingt-quatre heures et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Dans le cas d’espèce, le patient se trouvait en « errance » lors de son admission après avoir été mis à la porte par ses parents. Il a exprimé son refus de faire prévenir ceux-ci. L’obligation d’information a une exception en cas de « de difficultés particulières » conformément à l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique. La cour de cassation a jugé que le patient refuse que sa famille soit informée de la mesure relève de cette exception. Cette appréciation est en corrélation avec l’article L. 1110-4 du code de la santé publique qui rappelle le droit au respect des informations concernant le patient
Cour de cassation - Première chambre civile 14 septembre 2022 / n° 20-23.334: A compter de l’admission en soins sans consentements, l’établissement à l’obligation, dans un délai de 24 heures, d’informer la famille de la personne faisant l’objet de soins ou à défaut toute personne justifiant de relations antérieures à l’admission en soins. Les difficultés rencontrées pour joindre et informer ces personnes doivent être dressées dans le certificat médical de docteur. A défaut, la mainlevée de la mesure peut-être sollicitée.
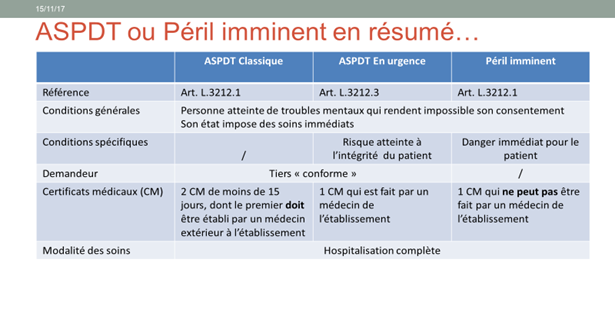
7.2.3 - L’admission sans consentement sur décision du représentant de l’Etat (SDRE)
La procédure de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département (SDRE) est développée dans le chapitre « Admissions en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat » du Code de la Santé Publique. Dans ce chapitre se trouve également l'article L. 3213-2 afférent aux mesures provisoires prises par les maires ou, à Paris, par les commissaires de police.
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose :
« I - Le représentant de l'Etat dans le département (le préfet) prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins sans consentement dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Les arrêtés sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ».
A. Le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public :
La notion de « sûreté des personnes » est également présente dans l’article L. 3213-2. Ainsi, le risque d’atteinte à la « sureté des personnes » peut justifier tout aussi bien une mesure de SDRE prise par un préfet qu’une mesure provisoire prise par un maire, ou un commissaire à Paris.
En l’absence de dangerosité de la personne, la mainlevée sera ordonnée par le juge :
« S’il ne résulte pas des articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du Code de la santé publique l’exigence de la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification doit néanmoins ressortir de la décision préfectorale.
Il est nécessaire de démontrer formellement les facteurs de dangerosité de l’intéressé.La simple référence au concept de « dangerosité » ne suffit pas à caractériser le risque d’atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes. (CA Paris, 25 août 2017, n°17/00371)
C’est pourquoi, dans un arrêt du 31 mars 2021, la Cour de cassation a cassé l’ordonnance autorisant le maintien en hospitalisation complète d’une personne au motif que le juge de la Cour d’appel s’était uniquement basé sur « le potentiel de dangerosité [du requérant] sans indiquer en quoi cette dangerosité psychiatrique était de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter gravement atteinte à l’ordre public ».
Lorsqu’il existe un risque d’atteinte grave à l’ordre public, l’admission en soins sans consentement n’est toutefois possible que dans le cadre de la procédure préfectorale. La notion d’ordre public est bien cernée en droit administratif :
- définie par ses composantes de sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique ;
- ne comportant pas la moralité publique.
Si la Cour européenne des droits de l'homme n’ignore pas l’ambiguïté du concept et les risques possibles d’orientation malheureuse vers les services de psychiatrie, elle reconnait le bien-fondé d'une mesure d'internement prise sur le fondement d'un motif d'ordre public dès lors qu'elle ne perçoit pas de dérive sécuritaire dans la mise en œuvre de la mesure (CEDH, HUTCHINSON REID c/ Royaume-Uni, 20 février 2003, n°50272/99, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65510https://hudoc.echr.coe.int/eng - {%22appno%22:[%2250272/99%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-65510%22]}).
Ainsi, en application de la deuxième phrase de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique « une telle qualification (relève), sous le contrôle du juge, du seul pouvoir du préfet » (Cass, Civ 1, 28 mai 2015, n°14-15686, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030653178&fastReqId=1311055908&fastPos=1)[1].
B. L’arrêté préfectoral et le certificat médical
a. L’arrêté préfectoral :
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique énonce que : « … Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires », à partir des informations contenues dans les certificats médicaux conformes aux indications de l’article R. 3213-3. Le lien entre la motivation de l'arrêté et le « certificat médical circonstancié » est essentiel.
- Antériorité de la décision du préfet
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, mais aussi un avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2016 la décision du préfet doit précéder l’admission effective du patient.
Toutefois, la Cour de cassation précise qu’un bref délai est susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet et elle accepte que la décision du préfet soit « retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures […] au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière ».
Dans son commentaire de l’avis de la Cour de cassation, Jean-Marc Panfili explique que : ces « quelques heures » n’ont pas de limites claires, mais « sembleraient cependant inclure le temps de transmission des pièces requises, et d’élaboration matérielle de l’acte ». Cet avis se situe donc dans la ligne de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 18 octobre 1989, n°75096, Mme BROUSSE, ; 17 novembre 1997, n°155196, et indique « qu’au-delà du bref délai d’élaboration, la décision sera irrégulière. Il appartiendra au juge de vérifier s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne »[2].
Il en est également ainsi lorsqu’il s’agit de la réintégration d’un patient qui se trouve en programme de soins. Ainsi, le JLD de Perpignan (18 septembre 2012, n°12/477), a ordonné la mainlevée d’une mesure de réintégration d’un patient qui était en programme de soins, dès lors que l’arrêté de réadmission n’avait été pris par le préfet que le lendemain. Voir, dans le même sens, dans le cas d’un délai de 3 jours, l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 22 septembre 2022 (22/00145).
- Décision du préfet et certificat médical
Ainsi, lorsqu'un préfet établit un arrêté d’admission ou de réintégration (Conseil d’Etat, 9 novembre 2001, n°235247, Deslandes), au vu d’un certificat circonstancié et en référence au diagnostic de dangerosité qui ressort du document médical, il doit agir en conformité avec l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, et par suite :
- s’approprier le contenu du certificat médical circonstancié ;
- viser le certificat dans l’arrêté ;
- joindre le certificat à l'arrêté, lorsque ce dernier est notifié à la personne interpellée.
S’agissant de la référence au diagnostic de dangerosité, la Cour de cassation, statuant sur la réintégration complète d’un patient en programme de soins (Cass, Civ 1, 15 octobre 2014, n°13-12220, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029607218&fastReqId=90486376&fastPos=1), a néanmoins estimé que les modalités de prise en charge pouvaient être modifiées (en l’espèce, la réintégration du patient sans que ce dernier se soit montré dangereux).
- Notification de la mesure
La notification de la mesure à la personne interpellée est également obligatoire, conformément à l’article L. 3211-3. En cas de non-application, la personne admise en soins psychiatriques sans consentement est réputée non informée de la décision et de la possibilité d’éventuels recours.
Information de la famille
L'article L. 3213-9 du Code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure la famille de la personne qui a fait l'objet de soins.
A compter de l’admission en soins sans consentements, l’établissement à l’obligation, dans un délai de 24 heures, d’informer la famille de la personne faisant l’objet de soins ou à défaut toute personne justifiant de relations antérieures à l’admission en soins. Les difficultés rencontrées pour joindre et informer ces personnes doivent être dressées dans le certificat médical de docteur. A défaut, la mainlevée de la mesure peut-être sollicitée. Cour de cassation - Première chambre civile 14 septembre 2022 / n° 20-23.334
b. Le certificat médical :
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique précise que le médecin certificateur ne peut être un psychiatre appartenant à l’établissement d’accueil. Comme en matière d’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers, le non-respect de la compétence légale du médecin certificateur constitue une irrégularité.
La Cour d’appel de Rennes a pu rappeler cette exigence dans une ordonnance du 3 janvier 2022 en prononçant la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation pour « irrégularité substantielle et d’ordre public pour lequel un grief n’a pas à être démontré» car l’admission en soins sans consentement avait été signée par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
L’exigence d’extériorité formulée par l’article L.3213-1 du Code de la santé publique ne se limite pas aux admissions, mais est également valable dans le cas des réintégrations.
Ainsi, dans un arrêt du 22 septembre 2022, la Cour d’appel de Chambéry (22/00145) a prononcé la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement, au motif que le patient « a fait l'objet d'une réadmission au sein du centre hospitalier […] sur la base d'un certificat médical du 26 Août 2022, émanant du Docteur [I], psychiatre de l'établissement d'accueil, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique. »
La loi du 27 juin 1990 a intégré dans le Code de la santé publique le concept jurisprudentiel du « certificat médical circonstancié ». L’interprétation du dispositif ne peut cependant se passer des lumières de la jurisprudence sur les caractéristiques et la durée de validité du certificat.
Ainsi, le « certificat médical circonstancié » n'échappe pas aux exigences du Code de déontologie médicale, et principalement à l’obligation qui impose à un médecin de ne certifier que ce qu'il a lui-même constaté. La jurisprudence considère que le médecin qui ne rencontre pas la personne concernée par le certificat engage sa responsabilité professionnelle (CA d'Aix-en-Provence, 14 mars 1995, n°043461). Le « certificat médical circonstancié » a également la qualité de document administratif. C’est en cette qualité que la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) (séances des 29 mai 1997 et 20 janvier 2000) considère qu’il doit être communiqué à la personne admise et donc joint à l’arrêté lors de la notification de la mesure.
Cour de cassation, 1ère civ, 29 mars 2023, pourvoi n° 22-11.302 : La cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2023 (n°22-11.302) consacre qu’il incombe au juge de déterminer en quoi les troubles mentaux de l’intéressé compromettent la sûreté des personnes.
c. Les mesures provisoires prises par le maire ou un commissaire de police à Paris
L'article L. 3213-2 énonce :
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures. (CA Chambéry ordonnance du 13 juillet 2022)
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa ».
L'article L. 3213-2 cantonne les maires et, à Paris, les commissaires de police, dans un rôle limité en prérogatives et dans le temps. En effet, ils ne peuvent exercer leur pouvoir que dans un cas : celui du « danger imminent pour la sûreté des personnes » (le cas de l’atteinte de façon grave à l'ordre public est donc exclu). Par ailleurs, ils perdent la main sur les mesures provisoires dès que le préfet a statué, c’est-à-dire dans un délai qui ne dépasse pas quarante-huit heures.
Ainsi que le précise l’article L. 3212-2 du Code de la santé publique, les arrêtés ordonnent « toutes les mesures provisoires nécessaires », ce qui signifie que le champ des mesures pouvant être prises sur ce fondement est très ouvert. Si les décisions prises par arrêté débouchent en pratique sur un internement psychiatrique, celui-ci est néanmoins l’aboutissement d’une chaîne d’actes de police successifs. La prise de décision, comme l’exécution des mesures de police, sont placées sous la responsabilité du maire tant que le préfet n’a pas pris le relai d’une manière conforme aux dispositions de l'article L. 3213-1.
Bien que le maire puisse prendre un arrêté municipal provisoire, seul le préfet est habilité à prendre « un arrêté d’hospitalisation d’office sans consentement ». Ce n’est qu’à partir de la date de cet arrêté que le délai commence pour le juge dans lequel il doit statuer sur l’admission ou non de l’intéressé. (5 février 2014 n°11-2856) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028574845&fastReqId=162614536&fastPos=1),
De ce fait, le maire ne peut être considéré comme un tiers ayant demandé la mesure de soins et est donc irrecevable à interjeter appel d’une main levée de la mesure. (CA paris 5 décembre 2018)
A noté que l’arrêté du municipal doit démontrer le caractère dangereux de la personne en s’appropriant le certificat médical et en le joignant à la décision sans quoi celui-ci serait déclaré irrégulier. (arrêt du 29 septembre 2021)
3. L’admission en soins psychiatriques sans consentement des malades « médico-légaux » (irresponsables pénaux)
Les malades « médico-légaux » sont les patients qui bénéficient de soins psychiatriques sans consentement à la suite d'une décision de justice (classement sans suite, jugement ou arrêt d'irresponsabilité pénale) prise en application de l'article 122, alinéa 1, du Code pénal, qui formule le principe de l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Pour entrer dans cette catégorie de patients, il faut que la personne ait été admise en soins sans consentement sur le fondement :
- soit d’une admission en SDRE en application de l'article L. 3213-7 du Code de la santé publique ;
- soit d'une admission en soins psychiatriques sans consentement selon une procédure judiciaire dérogatoire à la procédure d’admission en SDRE. Il s’agit de la procédure de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
L'article L. 3213-7 du Code de la santé publique dispose :
« Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne, qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 121-1 du Code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou d'un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale, nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du Code de la santé publique (la commission départementale des soins psychiatriques) ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure des soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues.
Si l'état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l'avis dont elle fait l'objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l'Etat dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.
L’avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8 ».
Dans l’article 706-135 du Code de procédure pénale, le législateur a entendu signifier que l'absence de culpabilité, et donc l'impossibilité de retenir une peine, n'affirme plus nécessairement l'incompétence du juge pénal pour l'hospitalisation d'office des malades « médico-légaux ». Par suite, l’autorité judiciaire peut décider que la mise en œuvre de la mesure de soins sans consentement échappe à la compétence du préfet.
L’article 706-135 précise que la procédure est mise en œuvre par « la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement », ce qui signifie que cette procédure n’est pas ouverte aux magistrats du parquet lorsqu’ils décident d’un classement sans suite sur le fondement de l'article 122, alinéa 1, du Code pénal.
Si le choix fait par l’autorité judiciaire n’est pas celui de la mise en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, il n’est pas directif à l’égard du préfet. En effet, le principe implicite de l'article L. 3213-7 du Code de la santé publique est le renvoi à la seule responsabilité du préfet. Si le préfet doit alors ordonner « sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade » en vue de la mise en œuvre d’une éventuelle mesure de soins psychiatrique sans consentement, cette mise en œuvre ne sera possible que si « l'état actuel du malade » rend cette mesure nécessaire.
Si l’autorité judiciaire fait le choix de l’application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale, elle fait celui de son implication directe dans la prise de décision quant à la mise en œuvre de la mesure. Ce choix permet en premier lieu que l’éventuelle mesure soit décidée par la juridiction après avoir été discutée contradictoirement avec les parties. En second lieu, il permet de faire rentrer l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dans le champ juridique des « mesures de sûreté ».
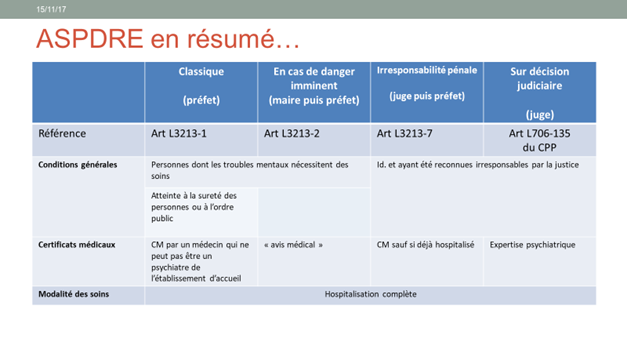
[1] Jean-Marc PANFILI - Le juge, l’avocat, les soins, document mis à jour le 23/12/2018, p. 12
[2] Jean-Marc PANFILI - Le juge, l’avocat, les soins, document mis à jour le 23/12/2018, p. 15
[3] Ibid., p. 45
[4] Ibid., pp. 21-23
[5] Jean-Marc PANFILI - Le juge, l’avocat, les soins, document mis à jour le 23/12/2018, p. 11
7.2.4 - L’admission en soins psychiatriques sans consentement des malades « médico-légaux » (irresponsables pénaux)
Les malades « médico-légaux » sont les patients qui bénéficient de soins psychiatriques sans consentement à la suite d'une décision de justice (classement sans suite, jugement ou arrêt d'irresponsabilité pénale) prise en application de l'article 122, alinéa 1, du Code pénal, qui formule le principe de l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Pour entrer dans cette catégorie de patients, il faut que la personne ait été admise en soins sans consentement sur le fondement :
- soit d’une admission en SDRE en application de l'article L. 3213-7 du Code de la santé publique ;
- soit d'une admission en soins psychiatriques sans consentement selon une procédure judiciaire dérogatoire à la procédure d’admission en SDRE. Il s’agit de la procédure de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Dans l’article 706-135 du Code de procédure pénale, le législateur a entendu signifier que l'absence de culpabilité, et donc l'impossibilité de retenir une peine, n'affirme plus nécessairement l'incompétence du juge pénal pour l'hospitalisation d'office des malades « médico-légaux ». Par suite, l’autorité judiciaire peut décider que la mise en œuvre de la mesure de soins sans consentement échappe à la compétence du préfet.
L’article 706-135 précise que la procédure est mise en œuvre par « la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement », ce qui signifie que cette procédure n’est pas ouverte aux magistrats du parquet lorsqu’ils décident d’un classement sans suite sur le fondement de l'article 122, alinéa 1, du Code pénal.
Si le choix fait par l’autorité judiciaire n’est pas celui de la mise en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, il n’est pas directif à l’égard du préfet. En effet, le principe implicite de l'article L. 3213-7 du Code de la santé publique est le renvoi à la seule responsabilité du préfet. Si le préfet doit alors ordonner « sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade » en vue de la mise en œuvre d’une éventuelle mesure de soins psychiatrique sans consentement, cette mise en œuvre ne sera possible que si « l'état actuel du malade » rend cette mesure nécessaire.
Si l’autorité judiciaire fait le choix de l’application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale, elle fait celui de son implication directe dans la prise de décision quant à la mise en œuvre de la mesure. Ce choix permet en premier lieu que l’éventuelle mesure soit décidée par la juridiction après avoir été discutée contradictoirement avec les parties. En second lieu, il permet de faire rentrer l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dans le champ juridique des « mesures de sûreté ».
L'existence de deux procédures concurrentes constitue une cause d'embrouille dans la gestion de la mesure par l’administration préfectorale : « il est en effet apparu que ces décisions (prises en application de l'article 736-135 du Code de procédure pénale) étaient habituellement ‘’doublées ‘’ d'un arrêté du préfet. Or, cet arrêté, a priori inutile juridiquement, a pu être considéré comme le point de départ pour calculer la date de saisine (du JLD pour le premier contrôle juridictionnel de l'hospitalisation sans consentement) » (Serge BLISKO, Guy LEFRAND, rapport d'information n°4402, enregistré à la Présidence de l'Assemblée Nationale le 22 février 2012, pp. 45-46). Ainsi, partant de l'arrêté préfectoral, l'autorité administrative pratique parfois de manière erronée la saisine du JLD à J+12 (comme en droit commun), alors qu'en cas d'application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale, le premier contrôle obligatoire effectué par le JLD est à l'échéance de six mois.
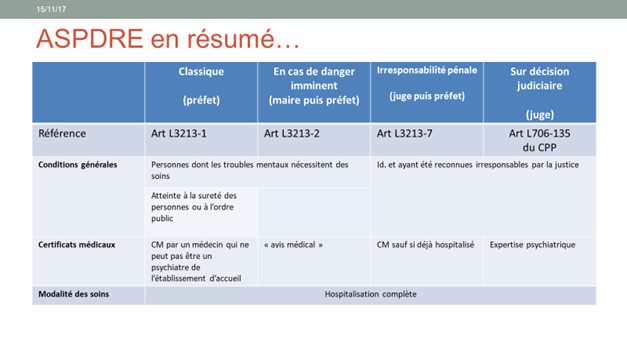
7.2.5 - Les régimes « spéciaux » d’hospitalisation complète : UMD et UHSA
Les « unités pour malades difficiles » (UMD) sont des unités de soins spécialement organiséesà l'effet de mettre en œuvreles « protocoles de soins intensifs » etles « mesures de sûreté particulières » adaptés à l'état de santé de patients « présentant pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté ne peuvent être mises en œuvre que dans une unité spécifique ». Ce peut être des patients « médico-légaux », des détenus transférés de prisons ou des patients qu ne peuvent plus contrôler les moyens de surveillance et de soins des unités de secteur en hôpital de psychiatrie générale.
Les « unités spécialement aménagées » (UHSA) n’accueillent que des « malades détenus ».
En principe, un malade détenu est hospitalisé en UMD parce qu’il présente une dangerosité psychiatrique ne permettant pas sa prise charge dans une UHSA. Il est cependant fréquent que des personnes qui ne présentent pas un état de dangerosité psychiatrique particulier et qui sont dans l’attente d’une place en UHSA soient hospitalisées en UMD.
En cas d’impossibilité d’une hospitalisation en UHSA ou en UMD, les détenus sont souvent hospitalisés dans des unités fermées classiques de psychiatrie générale ou dans des « unités de soins intensifs psychiatriques » (USIP), unités implantées dans des hôpitaux psychiatriques qui mettent en œuvre des mesures thérapeutiques proches de celles des UMD.
Les UMD et les UHSA se situant néanmoins au sein des services d’établissements sanitaires relevant du ministère de la santé, :
- les commissions des usagers (CDU) des établissements dont relèvent ces services ont vocation à surveiller la qualité des soins, ainsi que le respect des droits des patients qui y sont accueillis ;
- les commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP) assurent la totalité de leur compétence à leur égard.
A. Les Unités pour Malades Difficiles (UMD)
a. Le régime d’admission en UMD
Le dispositif réglementaire afférent aux admissions et sorties d’UMD est développé dans les articles R. 3222-1 à R. 3222-7 du Code de la Santé Publique.
L’article R. 3222-1 définit la population concernée :
« Les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III des IV du titre Ier du livre II du Code de la troisième partie du présent Code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières ».
L’article R. 3222-1 ne fait donc pas mention d’une quelconque dangerosité du « malade difficile ».
Tous les « malades difficiles » sont hospitalisés en UMD selon les modalités des SDRE. Lorsqu’il s’agit de l’hospitalisation d’un détenu (prévenu ou condamné) présentant des troubles psychiques rendant incompatible le maintien en détention, l’hospitalisation en UMD se fait non seulement en application des dispositions du Code de la santé publique afférentes aux admissions SDRE, comme indiqué à l’article R. 3222-2,mais encore selon les termes de l’article D.398 du Code de procédure pénale.
L’article R. 3222-2confère la maîtrise des admissions en UMD aux équipes soignantes de ces unités :
« I. Préalablement à l’admission d’un patient en unité pour malades difficiles, les psychiatres exerçant dans cette unité peuvent se rendre dans l’établissement de santé dans lequel le patient est hospitalisé pour l’examiner.
II. L’admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles. Dans l’objectif de maintenir ou de restaurer les relations du patient avec son entourage, cet arrêté détermine le lieu de l’hospitalisation en considération de ses intérêts personnels et familiaux. Une copie de l’arrêté est transmise au préfet du département dans lequel se situe l’établissement de rattachement de l’unité pour malades difficiles qui reçoit le patient.
L’information du patient concernant la décision mentionnée à l’alinéa précédent est mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 3211-3.
III. Le préfet prend sa décision au vu d’un dossier médical et administratif comprenant notamment :
1° Un certificat médical détaillé, établi par un psychiatre de l’établissement demandant l’admission, précisant les motifs de la demande d’hospitalisation dans l’unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l’objet ;
2° L’accord d’un psychiatre de l’unité pour malades difficiles ;
3° Le cas échéant, l’indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.
IV. En cas de désaccord du psychiatre responsable de l’unité pour malades difficiles, le préfet du département où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient ou, à Paris, le préfet de police, peut saisir la commission du suivi médical prévue à l’article R. 3222-4, qui statue sur l’admission dans les plus brefs délais.
V. L’établissement de santé dans lequel était hospitalisé le patient ayant fait l’objet de la demande d’admission dans l’unité pour malades difficile organise, à la sortie du patient de l’unité, les conditions de la poursuite des soins sans consentement lorsqu’elle est décidée conformément à l’article R. 3222-6, que les soins soient dispensés en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité ».
L’article R. 3222-3 précise les conditions d’accompagnement du patient durant le transport vers et depuis l’UMD.
b. Le suivi des hospitalisations en UMD et la sortie du patient
Si les modalités de suivi et de traitement dans les UMD répondent à des principes et des objectifs thérapeutiques communs, elles ne sont pas pour autant homogènes et sont liées à des pratiques spécifiques à chaque UMD. Le préfet dispose, pour assurer le suivi des patients en UMD, de l’éclairage de la « commission du suivi médical » (CSM).
L'article R. 3222-4 du Code de la santé fixe la composition de la CSM. L’article R. 3222-5 précise ses missions :
« La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles de son département d'implantation. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l'unité. Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.
Elle peut, en outre être saisie :
- Par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches
- Par le procureur de la République compétent du lieu d'origine ou d'accueil
- Par le préfet du département d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police
- Par le psychiatre de l'unité ;
- Par le médecin généraliste ou le psychiatre exerçant dans le secteur privé traitant le patient
- Par le psychiatre de l'établissement de santé dans lequel le patient est pris en charge
- Par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité;
- Par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge ».
En ce qui concerne la sortie du patient, l’article R. 3222-6 dispose qu’elle est soumise à un avis de la CSM et décidée par le préfet du département d’implantation de l’unité sur saisine de la CSM. Le préfet du département d’implantation de l’unitéest donc la seule autorité habilitée à ordonner la sortie de l’unité.
Il existe deux formes de sorties :
- la levée de la mesure des soins sans consentement ;
- la sortie par transfèrement en soins psychiatrique sans consentement, généralement dans le service de secteur d’origine.
Le troisième alinéa de l'article R. 3222-6 précise :
« L'établissement de santé qui a demandé l'admission du patient organise la poursuite des soins en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité. L'établissement désigné par l'arrêté préfectoral accueille le patient dans un délai maximal de vingt jours ».
L'incompétence du JLD en la matière :
Dans une ordonnance du 12 mai 2021, la Cour d’Appel de Bordeaux rappelle la limitation stricte des compétences du Juge des libertés de la détention en la matière.
Le JLD ne peut statuer que sur les décisions relatives aux prolongations/mainlevées d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte, ainsi que sur les décisions concernant l’isolement et la contention.
Ainsi, la décision de sortie d’une UMD, qui constitue une « modalité d’exécution de la mesure de soins sans consentement » n’entre pas dans son champ de compétence.
La Cour rappelle que, la sortie d’un patient de l’UMD ne peut être prononcée que par le préfet, après une décision favorable de la commission de suivi médicale.
Le préfet est, en la matière, en situation de compétence liée, comme le dispose l’article R3222-6 du Code de la santé publique.
La même juridiction, dans une ordonnance du 17 juin 2022, confirme sa position. Elle explique que si les UMD accueillent des patients hospitalisés en application de certaines des dispositions sus mentionnées (chapitre III et IV), les règles relatives à l’UMD « s’agissant notamment de son organisation et des conditions d’admission d’un patient sont insérées au sein du deuxième titre du deuxième livre de la troisième partie du code de la santé publique ».
Elle ajoute que « le placement en UMD ne constitue pas l’une des formes [d’hospitalisation complète] visées à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique mais une simple modalité de prise en charge à visée thérapeutique au cours d’une [telle] mesure».
À la suite de ce raisonnement, la Cour juge une nouvelle fois que la question du « contrôle de la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du premier titre, qui ne peut être effectivement contestée que devant le juge judiciaire (…) n’a pas vocation à être exercé pour ce qui concerne les décisions administratives de mainlevée d’une UMD », le JLD devant se limiter « à ordonner le maintien ou la mainlevée de la mesure ».
Le refus du juge administratif de se saisir de la question :
Les possibilités d’enjoindre le préfet à agir semblent très limitées.
La CSM, qui n’est pas une juridiction, n’est toutefois pas compétente pour imposer au service de secteur d’origine le retour d’un patient dont l’état ne justifie plus le maintien en UMD.
Décision du Tribunal des conflits, 3 juillet 2023, C4279, Publié au recueil Lebon
Cette décision semble offrir une possibilité de judiciarisation des admissions et des sorties d’UMD.
Elle intervient dans le dossier de Romain Dupuy, un patient jugé pénalement irresponsable après avoir commis un double homicide de soignantes en 2004 et placé depuis près de 18 ans à l’UMD de Cadillac. En 2021, ses avocats avaient demandé la poursuite de sa prise en charge hors de l’UMD, ce qui a depuis été refusé plusieurs fois par la Préfecture.
Le Tribunal des Conflits a été saisi par décision du Tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2023 pour qu’il soit décidé sur la juridiction compétente à connaître des demandes de transfert d’une unité pour malades difficiles (UMD) vers une unité classique d’un établissement psychiatrique.
Le Tribunal des conflits a jugé que l’ordre judiciaire est compétent.
Le juge des libertés et de la détention pourra dès lors se prononcer
B. Les Unités Hospitalières Spécialement aménagées (UHSA) :
Des patients sont donc parfois maintenus en UMD malgré des arrêtés préfectoraux exécutoires. Parmi les préjudices engendrés par cette situation, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) cite notamment l'atteinte « au droit au respect de leur vie familiale ». En effet, les UMD sont souvent situées loin des lieux de domicile ou de résidence des familles de patients, et par suite l'éloignement conduit ces dernières à engager des frais importants lors des visites. Le CGLPL insiste également sur le fait que la prolongation du séjour en UMD « compromet les chances de bonne réinsertion dans des conditions de vie et de soins aussi normales que possible ».
Les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) ont été instituées par la loi d'orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) du 9 septembre 2002. Ce dispositif enserre une unité sanitaire dans une enceinte pénitentiaire. L’article L. 3214-1 du Code de la santé publique est ainsi formulé :
« I. - Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée.
II. - Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du II de l'article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1, au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical au sein d'une unité adaptée.
III. - Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées au sein d'un service adapté dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 en dehors des unités prévues aux I et II du présent article ».
Deux modalités d’admission sont donc prévues : « en admission dite volontaire, avec le consentement de la personne détenue ; en admission contrainte, par une décision préfectorale de soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat (SDRE). Cette seconde modalité entraine, si l’hospitalisation se prolonge au-delà de treize jours, un examen de la décision préfectorale par le juge des libertés et de la détention, comme dans le droit commun. » (rapport des inspections générales de la justice et des affaires sociales d’évaluation des UHSA -décembre 2018, p.21)
L’article L. 3214-3 précise la procédure préfectorale afférente dans le cas d’admission contrainte :
« Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations d’office ordonnées en application de l’article L 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11 ».
En application du deuxième alinéa, la période de soins et d'observation de 72 heures s'applique aux détenus exactement comme à tous les autres patients hospitalisés d'office. S'agissant de « l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 », il s’agit en principe d’un établissement auquel est rattachée une UHSA. En effet, l’hospitalisation « au sein d’une unité adaptée » n’est pas le cas de figure auquel le législateur a accordé la primauté.
Les dispositions réglementaires afférentes aux UHSA regroupent les articles R. 3214-1 à R. 3214-23 du Code de la santé publique. Il est possible de discerner deux groupes d’articles :
- les articles R. 3214-1 à R. 3214-20 sont consacrés à l’organisation territoriale des UHSA, la procédure d’admission et l’organisation interne de ces structures ;
- les articles R. 3214-21 à R. 3214-23 traitent de la problématique particulière du transport et de l'escorte des détenus.
Le cadre juridique de l’hospitalisation des détenus en UHSA est complété par l’article R. 57-7-83 du Code de procédure pénale qui précise les conditions d’usage de la force :
« Les personnels pénitentiaires ne doivent utiliser la force envers les personnes détenues qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l’ordre ».
Tant que le nombre d’UHSA (9) , et donc le nombre de lits disponibles dans de telles unités, demeurent insuffisants pour répondre aux besoins, le dispositif antérieur est maintenu sur le fondement de l’article 48-II de la loi du 9 septembre 2002 :
« Dans l’attente de la prise en charge par les unités hospitalières spécialement aménagées mentionnées à l’article L. 3214-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux continue d’être assurée par un service médico-psychologique régional ou un établissement de santé habilité dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises sur le fondement des articles L. 6112-1 et L. 6112-9 du même Code ».
Dans ces conditions, alors que les détenus ne doivent, conformément à l’article R. 4127-7 du Code de la santé publique, faire l’objet d’aucune discrimination en raison de leur détention ou de ses causes, des « précautions discriminantes » continuent à leur être appliquées dans les services de psychiatrie des établissements de santé. Ces « précautions discriminantes », incluent notamment la pratique de la mise à l’isolement quasi-généralisée des détenus hospitalisés. Les préfets considèrent en effet souvent que l’hospitalisation en établissement psychiatrique d’une personne détenue dans un service de psychiatrie autre qu’une UHSA impose la mise du détenu en chambre de sûreté ou, à défaut, sous toute autre mesure d’isolement extrêmement stricte.
7.3 - L’encadrement des durées d’hospitalisation sous contrainte
La loi du 5 juillet 2011 a maintenu le pouvoir de décision et de gestion administrative dans le champ de compétence des autorités administratives : les directeurs d’hôpitaux en matière de soins sans consentement à la demande d’un tiers et les préfets en matière de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Toutefois elle a également :
- attribué au JLD la mission d’assurer à échéances régulières le contrôle juridictionnel de la légalité des mesures d’hospitalisations sans consentement, et plus récemment d’isolement et de contention ;
- conféré un rôle prépondérant au psychiatre, lequel doit produire des certificats médico-légaux qui ont pour finalité d’éclairer l’exercice du pouvoir décisionnaire des autorités administratives et judiciaires.
7.3.1 - La période initiale d’observation et de soins de 72 heures
L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique énonce en son premier alinéa :
« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatrique en application des chapitres II et III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète ».
Le dispositif afférent au déroulé de la « période d’observation et de soins initiale » est axé autour de l’obligation faite à un psychiatre de l’établissement d’accueil de produire des certificats médico-légaux, afin d’évaluer si l’état de santé de la personne justifie le maintien de la mesure de soins sans consentement aux deux échéances de vingt-quatre et soixante-douze heures.
A. L’examen somatique complet et le certificat médical de 24 heures :
L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique précise :
« … Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. … ».
Toutefois, la Cour de cassation (Cass, Civ 1, 14 mars 2018, n°17-13223, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036741992&fastReqId=1815329287&fastPos=1) a considéré que l’examen somatique (à la différence de l’examen psychiatrique) ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical, ni ne figure au nombre des pièces obligatoirement adressées au JLD.
B. La décision à la fin de la période initiale d’observation et de soins
Conformément à l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, l’avis du patient doit être recherché et pris en compte avant que ne soit formulée la proposition de décision qui sera présentée à l’autorité administrative compétente à la fin de la période d’observation et de soins.
La procédure afférente à la fin de la période d’observation et de soins initiale est décrite par l’article L. 3211-2-2 :
« … Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat est établi dans les mêmes conditions que celles prévues dans le deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux (certificat de vingt-quatre heures et certificat de soixante-douze heures) ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose, dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 3211-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ».
Ainsi, lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir la mesure, la proposition d’orientation doit conclure en faveur de la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une forme ambulatoire.
Un certificat médical établi avant la fin de la période des 72h, en l’espèce 48h, ne peut être considéré comme ayant respecté les dispositions légales et la mainlevée sera ainsi ordonnée. (JLD Paris, 7 septembre 2020)
L’obligation d’effectuer des examens médicaux à l’issue des premières 24 et 72 heures s’applique également en cas de réadmission en hospitalisation complète.
Ainsi, dans un arrêt du 22 septembre 2022 (22/00145), la Cour d’appel de Chambéry a prononcé la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète en raison de l’absence d’examen somatique.
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention près du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 20 novembre 2023, RG 23/03798 : Décision de mainlevée de la procédure d’hospitalisation sans consentement en raison de l’établissement des deux certificats médicaux de 24 et 72 heures établis à la même date : « Il ressort de l’examen des pièces jointes à la saisine qu’ont été dressées à l’égard de l’intéressé deux certificats médicaux respectivement de 24 et 72 heures établis à la même date et portant des prescriptions identiques. Il s’en suit une irrégularité qui justifie la main levée de la mesure. ».
L’horodatage des deux certificats médicaux doit être précis, devant mentionner l’heure exacte à laquelle ils ont été effectués. Cour de Cassation, 26 octobre 2022, n° 20-22.827
La présence d’un interprète est obligatoire lors d’une procédure d’hospitalisation sans consentement : Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 30 septembre 2024, n°24/04714 : La Cour d'appel rappelle que la personne hospitalisée d'office doit avoir accès à un interprète dès le début de la mesure s'il n'est pas en capacité de comprendre le français. Cette irrégularité fait nécessairement grief à l’intéressé, en conséquence de quoi il convient d’ordonner la main levée de la mesure.
C. Conditions de validité des certificats médico-légaux :
L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique énonce aussi :
« … Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée ».
L’article L. 3211-2-2 est un texte de portée générale, applicable que les personnes concernées aient été admises en soins sans consentement à la demande d’un tiers, en péril imminent ou sur décision du représentant de l’Etat.
Ces dispositions ont été rappelées par la Cour d’appel de Paris (26 janvier 2015 n°15/00034).
Le directeur de l’établissement a l’obligation d’adresser les certificats de vingt-quatre et soixante-douze heures au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3212-5, I lorsque le patient a été admis à la demande d’un tiers ou en péril imminent, et au deuxième alinéa de l’article L. 3213-1 pour les admissions en SDRE.
Cette exigence n’est pas requise si l’état de la personne est susceptible de compromettre la sûreté des personnes ou de troubler l’ordre public. (Cass, Civ 1, 28 mai 2015, n°14-15686).
Enfin, l’absence de respect des délais de production des certificats est régulièrement sanctionnée par le JLD. En cas de défaut d’un certificat à l’échéance qui est la sienne, la mesure fait l’objet d’une mainlevée « automatique » et le patient peut :
- quitter librement l’établissement (sans que cette sortie puisse être qualifiée de fugue ou de sortie contre avis médical),
- ou demeurer dans l’établissement sous le régime de l’hospitalisation libre.
7.3.2 - La saisine du juge des libertés et de la détention dans les 12 jours puis à 6 mois
Le législateur de 2011 charge le juge judiciaire d’assurer à échéances régulières le contrôle de la légalité des hospitalisations sans consentement. Ce contrôle, qui se poursuit au fil de l’hospitalisation sans consentement, débute par la vérification systématique de la régularité de la procédure d’admission.
A. Calendrier des interventions obligatoires du JLD
L’article L. 3211-12-1, I du Code de la santé publique énumère les échéances auxquelles le JLD doit intervenir pour statuer sur la légalité de la mesure privative de liberté :
« I - L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention (JLD), préalablement saisi par le directeur de l’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent Code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. »
Les délais fixés pour l’intervention du juge sont impératifs ; il en est de même en ce qui concerne les délais dans lesquels le directeur de l’établissement ou le préfet doit saisir le JLD.
Sur le délai de 12 jours pour la première saisine du JLD :
- La première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé, dans un arrêt du 7 novembre 2019, (n°19-18262, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/soins-psychiatriques-sans-contentement-pratiques-de-contrainte-et-d-isolement-hors-controle#.XfkBLdVKiM8) que le « jour de l’évènement » qui fait courir le délai de 12 jours du contrôle obligatoire de la mesure par le JLD n’est pas celui de l’admission en soins, mais la date à laquelle la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement a été prise par le directeur du centre hospitalier.
- La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 24 mai 2018, que le Juge des libertés et de la détention doit être saisi dans les 8 jours à compter de la décision d’admission, même en cas de fugue du patient :
Sur le délai de 6 mois pour la deuxième saisine du JLD :
Le délai de 6 mois commence à courir à compter de la date de la décision judiciaire prononçant l’hospitalisation du patient et non pas la date de la mise en œuvre par le préfet de la décision judiciaire. (Cass. Civ 1. 8 juillet 2020, n°19-18.839, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/juillet_9808/428_8_45143.html)
L’article L. 3211-12-1 précise par ailleurs que la saisine « est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète … ». Cet avis est indispensable, aussi bien pour la poursuite des soins à la suite d’une admission, que pour la poursuite des soins au-delà de chacune des échéances fixées pour le contrôle de plein droit. En l’absence de cet avis, la saisine du JLD se trouve frappée d’une irrégularité constitutive d’une atteinte aux droits.
L’article précise également le cas particulier des patients médico-légaux : « … Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9 ».
B. Nature et étendue de la compétence du JLD
La compétence attribuée au juge des libertés et de la détention (JLD) repose sur l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique :
« La régularité des décisions administratives (de soins psychiatriques sans consentement) prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
… L’irrégularité affectant une décision administrative … n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet … »
Il n’est pas demandé au juge judiciaire d’agir comme un juge administratif (et par suite d’annuler les décisions administratives illégales pour des questions de forme), mais de rechercher si, de l’irrégularité de la procédure, il est résulté une « atteinte aux droits de la personne ».
Le Tribunal des Conflits a considéré, dans sa décision du 9 décembre 2019 (n°C4174, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039655557&fastReqId=1284976408&fastPos=1) sur saisine du Conseil d’Etat, que le juge judiciaire dispose du pouvoir d’annuler une décision de soins sans consentement. L’arrêt a ainsi souligné que la juridiction judiciaire est « seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter » ; dès lors, « toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient d’en prononcer l’annulation ».
Elle se fait sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique en vue du contrôle de plein droit du JLD :
L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique pose le principe selon lequel le JLD a l'obligation d'intervenir à des échéances précises lorsque l’hospitalisation complète sans consentement d’un patient a été prononcée (c’est le « contrôle de plein droit »). Il ne prévoit en revanche aucune compétence de plein droit du JLD dans le cas des personnes soumises à un programme de soins ambulatoire.
Quel que soit le mode d'admission sans consentement, le terme « hospitalisation » englobe :
- la « réintégration d’un patient en hospitalisation complète après une interruption » ;
- la « transformation d’un programme de soins en hospitalisation complète » ;
- la « réadmission du patient en hospitalisation complète ».
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation précise que le juge ne peut pas lever la mesure en apportant une appréciation d’ordre médical, qui au demeurant diffère de celle des médecins. La frontière est fine mais nette. Le rôle du juge se limite à s’assurer de la régularité de la mesure et de sa cohérence au regard des éléments médicaux fournis (Cass. 1re civ., 8 février 2023, no 22-1D0852).
7.3.3 - Le contrôle des soins sans consentement au-delà de la période d’observations et de soins initiale
A. Contrôle des soins à la demande d’un tiers
Lorsqu’il s’agit de soins sans consentement à la demande d’un tiers, à l’issue de la période d’observation et de soins en hospitalisation complète, ainsi que l’indique le premier alinéa de l’article L. 3212-7 du Code de la santé publique, « les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables ».
L’article L.3212-7 précise ensuite les conditions du renouvellement des périodes d’un mois :
« … Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège médical mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnées au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur d'établissement d'accueil à la commission médicale des hospitalisations psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. »
Les articles L. 3212-8 et L. 3212-9 décrivent la procédure et les conditions de levée de la mesure de soins sans consentement par le directeur de l’établissement. L’article R. 2223-9 apporte des précisions lorsque la levée est demandée par la commission départementale des soins psychiatriques.
La Cour de cassation a rappelé, par un arrêt en date du 11 octobre 2022, l'absence de recours juridique pour les refus d’accorder une permission de sortie lors d’une hospitalisation sans consentement. Ainsi, les dispositions de l'article L. 3211-11-1 12 du Code de la santé publique, définissant le régime des autorisations de sortie de courte durée dont peuvent bénéficier les personnes admises en soins sans consentement dans les établissements de soins psychiatriques, ne prévoient pas de contrôle juridictionnel, pas d'obligation d'information préalable de la personne et aucune voie de recours en faveur de la personne qui les sollicite. Le refus du directeur d'établissement d'accorder des autorisations de sortie de courte durée aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'emporte pas aggravation de l'atteinte à leur liberté individuelle ou au respect de leur vie privée (Cour de cassation, 11 octobre 2022, n°22.12.107).
B. Contrôle des soins en matière de SDRE
La mission du « représentant de l’Etat dans le département », relative aux SDRE englobe trois champs de compétences :
- les décisions d'hospitalisation initiales ;
- les décisions de maintien des mesures à un mois, puis trois mois, puis tous les six mois ;
- les décisions de levée des mesures.
Si la garantie, pour le patient, de n'être contraint qu'à une mesure de soins adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental fait partie de la mission du préfet, cette dernière répond en premier lieu à des objectifs sécuritaires de protection des personnes et de l’ordre public.
Ainsi, alors que l’exigence de respect par les directeurs d’établissement des conditions de l’hospitalisation à la demande d’un tiers est assortie de sanctions pénales formulées dans le Code de la santé publique, aucune sanction pénale n’est spécifiée dans ce même code à l’encontre du représentant de l’Etat. Jean-Marc PANFILI relève cependant que : « Si le représentant de l’Etat ordonne l’admission de façon injustifiée, il est passible du crime d’atteinte à la liberté individuelle, tel que défini à l’article 434-2 du Code pénal. Ainsi, une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, qui ordonne arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle, risque une peine d’emprisonnement ou d’amende. Il peut s’agir de réclusion criminelle lorsque la détention ou la rétention arbitraire excède sept jours »[1].
Dans toutes les situations où le préfet doit prendre une décision qui relève de ses champs de compétence, les certificats et avis médico-légaux afférents sont transmis par le directeur de l'établissement au préfet, via la délégation départementale de l’ARS. Ils doivent être explicites sur l'amélioration, la stabilisation ou la détérioration de l'état de santé de la personne en SDRE.
L'encadrement des délais
Conformément à l’article L. 3213-9, à l'échéance de vingt-quatre heures, le préfet a l'obligation d'informer un certain nombre d'autorités ou de personnes de l’admission.
Au-delà des soixante-douze heures, les articles L. 3213-3 et L. 3213-4 du Code de la santé publique fixent :
- l’échéancier des certificats médico-légaux ;
- la procédure préalable aux décisions du représentant de l’Etat dans le département ;
- la procédure de prise de décision préfectorale.
Le troisième alinéa de l’article L. 3213-4 précise que l’existence d’un échéancier fixé pour la production de décisions préfectorales de maintien des mesures ne fait nullement obstacle à la levée de ces dernières entre les échéances fixées.
L’article L3213-4 du code de la santé publique dispose « Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.»
Lorsque le préfet ne se conforme pas à ces délais et durées, la mainlevée de la mesure est acquise, conformément au troisième alinéa du même article. Dans le cas où un préfet renouvellerait, (dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation) la mesure d’hospitalisation sous contrainte pour une durée de six mois (au lieu de trois mois, comme l’exige l’article, dans le cadre du premier renouvellement) le juge prononcera la mainlevée de la mesure. Voir en ce sens la décision de la Cour d’Appel de Lyon du 18 mai 2021.
C. La levée des mesures de SDRE concernant les patients médico-légaux (irresponsables pénaux)
Le quatrième alinéa de l’article L. 3213-4 du Code de santé publique énonce que les trois alinéas précédents ne sont pas applicables « aux personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 », c’est-à-dire aux patients « médico-légaux ».
Le dispositif dérogatoire afférent à la procédure préfectorale est fixé par toute une suite de dispositifs :
- l’article L. 3213-3, III et IV du Code de la santé publique
- l'article L. 3213-8
- l'article R. 3213-2 qui détaille les obligations du directeur de l’établissement ainsi que du préfet.
Lorsqu’il s’agit de la levée des mesures de SDRE appliquées à ces patients, comme lorsqu’il s’agit de modifier la forme de leur prise en charge, le préfet doit donc procéder selon des dispositions dérogatoires au droit commun qui prévoient :
- l’avis du « collège mentionné à l’article L. 3211-9 » du Code de la santé publique ;
- deux expertises psychiatriques.
Le « collège mentionné à l’article L. 3211-9 » est un organe psychiatrique dont la composition est précisée à l’article R. 3211-2 du Code de la santé publique. La nomination des membres est spécifique à chaque convocation. L’article R. 3211-6 précise :
« Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre ses avis … est fixé à cinq jours à compter de la date de convocation … ».
Cass Civ 1ère 20 mars 2024, n°22-18-323 : La cour de cassation rappelle que « Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9, cette évaluation étant renouvelée tous les ans. »
Le certificat médical mensuel permettant de prendre la décision relative au maintien du patient dans l’établissement doit avoir été établit dans le délai de 3 jours calendaires avant la décision. (Cass Civ 1ère 24 avril 2024 n°22-21.919)
[1] Jean-Marc PANFILI - Le juge, l’avocat, les soins, document mis à jour le 23/12/2018, p 30
7.3.4 - La saisine facultative du JLD à tout moment pour une levée d’hospitalisation
L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique affirme la compétence exclusive du juge judiciaire pour connaître de la régularité des décisions administratives des mesures de soins sans consentement, que ce soit dans le cadre de l’article L. 3211-12 comme dans celui de l’article L. 3212-12-1. Par ailleurs :
« … Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ».
L’article L. 3211-12 du Code de la santé publique précise :
« I - Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet de soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale si la personne est mineure ;
3° La personne chargée de la protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulée la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet de soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure. »
La possibilité est également donnée au tuteur ou au curateur de former la saisine. Par ailleurs, conformément à l’article 468 du Code civil qui pose le principe selon lequel l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, si le greffe est informé d’une mesure de protection, il doit convoquer la personne en charge de la mesure à l’audience.
Enfin, le JLD peut s’autosaisir « à tout moment », et c’est dans cette perspective que « toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure », tant au regard de la légalité formelle de la décision, que du respect des conditions de fond.
Lorsqu’un patient dépose une requête au secrétariat de l’établissement, celui-ci doit en dater sa réception de sorte qu’un contrôle soit opéré concernant la transmission de cette requête au tribunal. Cour de cassation Première chambre civile, 14 juin 2023, pourvoi n° 22-13.050 :
Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation D'office, 23 août 2024, n° 24/00096 : La Cour d’appel rappelle qu’il convient de ne pas limiter l’examen de la situation de la personne hospitalisée selon les certificats de 24 et 72 heures mais également les certificats médicaux plus récents.
7.3.5 - Le contrôle judiciaire des mesures d’isolement ou de contention
I. Les exigences de l'article L322-5-1 du code de la santé publique
A. Le contrôle des mesures d’isolement
A l’obligation d’information qui s’imposait au directeur d’établissement, s’ajoute désormais une obligation de saisine du juge des libertés et de la détention, avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement ou de la 48ème heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
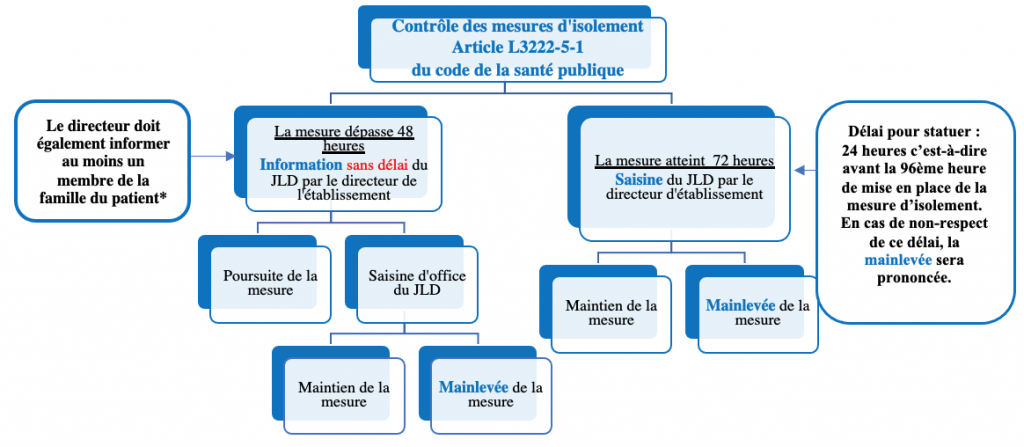
*En priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le délai de soixante-douze heures fait l’objet d’une appréciation stricte du juge. Dans un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 28 avril 2022, le juge déclare irrégulière une mesure d’isolement, au motif que le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention avec douze heure de retard. Même si la fin de la mesure intervient tard dans la nuit, le juge doit en être obligatoirement informé sans quoi l’isolement est déclaré irrégulier.
En cas de maintien de la mesure par le JLD, le cycle d’information/saisine/décision (contrôle toutes les 72h) se prolonge jusqu’à la fin de la mesure.
B. Le contrôle des mesures de contention
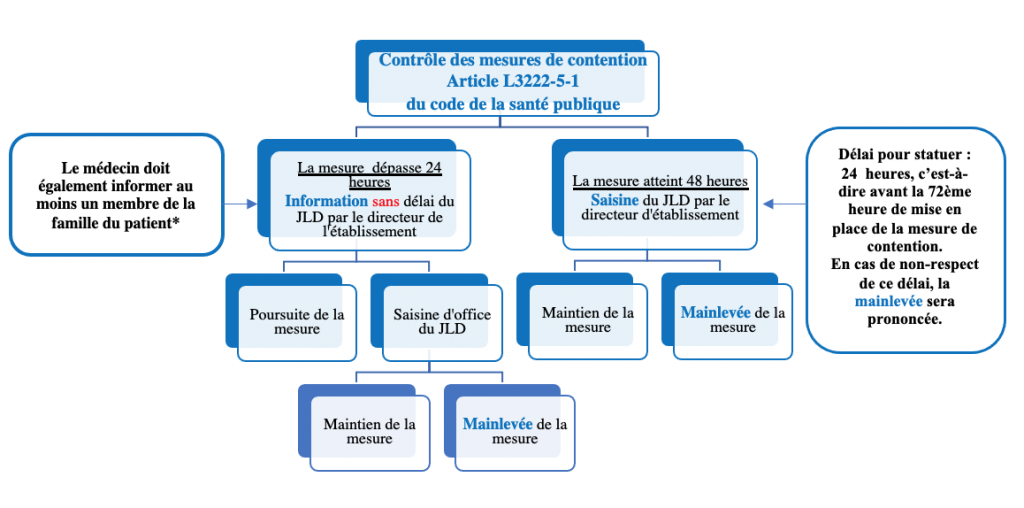
*En priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
En cas de maintien de la mesure par le JLD, le cycle d’information/saisine/décision (contrôle toutes les 96h) se prolonge jusqu’à la fin de la mesure.
Si le JLD autorise le maintien de la mesure une deuxième fois : le contrôle toutes les 96 heures laisse place à un contrôle hebdomadaire.
Le directeur saisit le juge au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours d’isolement. Le médecin informe en même temps au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient dès lors qu’une telle personne est identifiée. Le juge statue avant la fin du 7ème jour d’isolement.
Selon la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 mars 2024 (N°23-70.017), consacre que « le délai de sept jours prévu à l'article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l'heure exacte en heures et en minutes. »
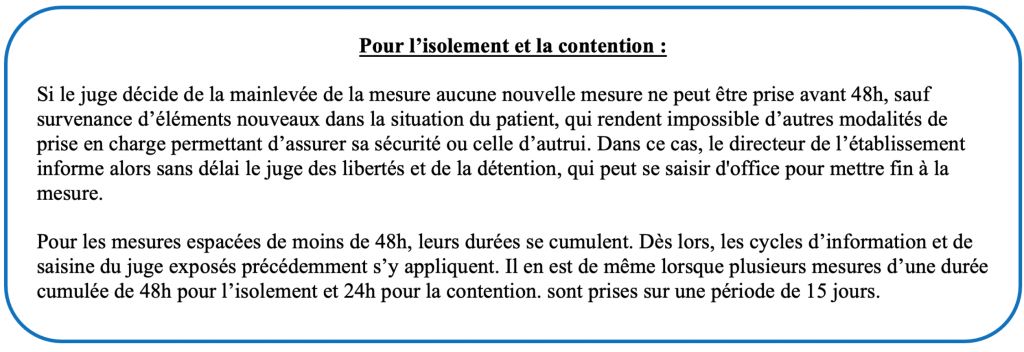
Les placements abusifs en isolement ou contention peuvent par ailleurs faire l’objet de demandes d’indemnisation ; voir la section Indemnisation des hospitalisations sous contrainte.
Remarque : La levée d’une mesure d’isolement ou de consentement n’entraine pas automatiquement celle de la mesure de soins sans consentement qui l’a précédée.
En effet, le juge ne peut que lever la mesure d’isolement et non la mesure de soins sans consentement. Si l’inverse était possible cela adviendrait à lever une mesure pouvant être utile au patient bien que la mesure additionnelle soit irrégulière. (arrêt du 8 juillet 2021)
II. Historique du contrôle
A. Des gardes fous jurisprudentiels
Certains juges ont tenté de contrôler l’isolement et la contention, pratiques fortement restrictives d’une liberté fondamentale, sans y être autorisés par la loi. C’est ainsi que des JLD versaillais ont levé des mesures de soins sans consentement dès lors qu’ils constataient que la modalité de traitement (les conditions de séjour en chambre d’isolement) portait une atteinte aux libertés individuelles, ou ne répondait pas aux finalités prévues par la loi.
Toutefois, la Cour de Cassation avait cassé ces intiatives par deux arrêts successifs (Cass, Civ 1, 7 novembre 2019, n°19-18262 ; 21 novembre 2019, n°19-20513), qui énoncent que le JLD n’est pas compétent pour connaître de la mise en œuvre des soins et donc des mesures de contention et d’isolement.
B. La loi n°2016-41 de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016
La loi n°2016-41 de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 transposée dans l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique a affirmé un principe : les pratiques d’isolement et de contention doivent être un dernier recours, et créé deux outils devant permettre son contrôle.
- Le registre des mises en isolement et en contention
Chaque établissement admis à recevoir des personnes en soins sans consentement doit tenir : « Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la CDSP, au CGLPL et aux parlementaires » (article L. 3222-5-1 III).
Conformément à l’article L311-1 du Code des relations entre le public et l’administration, le registre peut également être communiqué « aux personnes qui en font la demande ». L’article L311-7 du même code rappelle toutefois l’obligation, dans ce cadre, d’occulter ou disjoindre les mentions non communicables, s’il est possible de le faire. A défaut, le document ne pourra pas être transmis à toutes les personnes en faisant la demande.
Dans un arrêt du 18 novembre 2021, le Conseil d’Etat a précisé le caractère des mentions figurant dans le registre. Le juge administratif explique que les informations présentes dans le registre ne sont pas toutes soumises à occultation. Par exemple, les informations relatives aux dates, heures et durées d’isolement et de contention ne doivent pas être dissimulées. Ainsi, le registre s’inscrit bien dans la liste des documents communicables aux personnes qui en font la demande, au sens de l’article L311-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
Dans un avis du 15 avril 2021, la commission d’accès aux documents administratifs rappelle les exigences enserrant la communication de ce registre. La commission explique que les noms des professionnels de santé ne sont pas couverts par le secret de la vie privée et ne doivent, en principe, pas être occultés. En revanche, si la divulgation est susceptible de porter préjudice ou d’engendrer des représailles à l’encontre du professionnel, alors « l'administration est fondée à occulter cette mention ». La commission explique également que le registre peut être transmis à toute personne en faisant la demande, par voie dématérialisée si ce dernier est disponible sous version électronique. S’il apparaît que le registre n’est pas exploitable en version dématérialisée, l’hôpital reste tenu de transmettre le document en version papier au demandeur.
- Le rapport annuel de l’isolement et de la contention
Les établissement doivent rédiger chaque année ce rapport, avant le 30 juin de l’année suivante, en précisant notamment la politique définie pour limiter le recours aux pratiques d’isolement et de contention. « L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers et au conseil de surveillance » (article L. 3222-5-3).
C. Les décisions d'inconstitutionnalité
- Les décisions d'inconstitutionnalité
- Par une décision du 19 juin 2020 (n° 2020-844 QPC), le Conseil Constitutionnel, saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, a relevé cette double aberration juridique :
Et injonction a été faite au gouvernement de corriger cette illégalité avant le 31 décembre 2020.
D. La loi de financement de la sécurité sociale du 14 décembre 2020
Puis la loi de financement de la sécurité sociale du 14 décembre 2020 a été utilisée par le gouvernement pour, à travers un cavalier législatif placé sous l’article 84, modifiant le code de la santé publique avec effet au 1er janvier 2021, répondre à cette exigence.
L’article. L. 3222-5-1.-I. Réaffirme en le complétant le principe selon lequel « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. » Le psychiatre doit motiver sa décision du recours à ces mesures, notamment sur leurs caractères adapté, nécessaire et proportionné au risque, après évaluation du patient.
Il est à l’occasion précisé que l’isolement et la contention ne s’adressent qu’aux seuls patients en hospitalisation complète sans consentement, contrairement à une pratique tolérée (circulaire Veil 1993) .
Reprenant les recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant les durées maximales d’utilisation de ces mesures « de dernier recours » et les rendant obligatoires, la nouvelle loi précise dans l’article L.3222-5-1.-2 « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. »
« La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures. »
| Isolement | Contention |
| Durée de 12 heures, avec renouvellement possible par périodes maximales de 12 heures, dans la limite d'une durée totale de 48 heures | Durée de 6 heures, avec renouvellement possible par périodes maximales de 6 heures, dans la limite d'une durée totale de 24 heures |
Tenant compte de la pratique fréquente des isolements et contentions « séquentielles », le législateur a prévu qu’«une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables. »
« L'information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. »
Puis la loi autorise des exceptions tout en organisant leur contrôle : « A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. »
Le juge doit donc être informé mais ne réagit que de façon facultative. Le patient, la famille, les proches du patient, le tuteur, s’ils sont connus, et la personne ayant demandé l’admission, de la prolongation de la mesure d’isolement ou contention sont aussi informés du dépassement, de leur droit de saisir le JLD et des modalités de cette saisine. (un décret doit préciser celles-ci).
Le patient et les personnes citées ci-dessus peuvent saisir le JLD pour demander la levée de la mesure d’isolement ou de contention lorsqu’elle dépasse la durée maximale.
Les modalités d’examen de la saisine donnent la priorité à l’écrit.
Outil clé du contrôle du respect des durées d’isolement et de contention, le registre institué par la loi de 2016 fait l’objet de précisions visant à combler quelques lacunes : « III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. » La nouvelle rédaction de l’article L.3222.5.1 ajoute à l’ancienne, que ce registre doit également mentionner l’identifiant du patient, son âge, son mode d’hospitalisation. Il n’est toutefois pas demandé que soient renseignés les raisons ayant motivé le recours à la mesure, l’avis du psychiatre ainsi que le suivi médical du patient, sujets pour lesquels le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté avait appelé à une réforme.
Le texte ajoute que « le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. » Le JLD est, curieusement ignoré dans la liste des autorités pouvant consulter le registre.
L’obligation de rédiger un « rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre » est aussi confirmée sans que le JLD soit ajouté au nombre des personnes auxquelles il est obligatoirement transmis.
- Par une décision n° 2021-912/913/914 du 4 juin 2021, le Conseil constitutionnel a de nouveau déclaré inconstitutionnel l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (analyse de Soliman Le Bigot et Elodie Garoux , LBM avocats à la Cour Commission bioéthique et santé du Barreau de Paris, 18 juin 2021)
L’isolement et la contention doivent s’inscrire dans une démarche thérapeutique afin de protéger le patient de violences imminentes liées à un trouble mental. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 avril 2021 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêts nos 379, 380 et 381 du 1er avril 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de trois questions prioritaires de constitutionnalité. Le 4 juin 2021, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du code de la santé publique relatives aux personnes hospitalisées sans consentement et qui permettent de les maintenir à l’isolement ou en contention sans prévoir l’intervention systématique du juge des libertés et de la détention, étaient inconstitutionnelles (Décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021- loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021). Le conseil avait déjà eu l’occasion de censurer le 19 juin 2020 le régime juridique de l’isolement et de la contention en psychiatrie au motif que le recours à ces mesures privatives de liberté n'était ni limité dans le temps ni soumis, au-delà d'une certaine durée, au contrôle systématique du juge (Décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020 - loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé).
En principe, toute mesure d’isolement et de contention d’une personne hospitalisée sans consentement doit être décidée par un psychiatre et ceci pour une durée maximale de 48h pour l’isolement et 24h pour la contention selon le code de la santé publique (CSP, art. L. 3222-5-1, § 2, al. 3 et 6 issus de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 : L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020, art. 84).
Néanmoins, le psychiatre peut, de manière exceptionnelle, renouveler la mesure. A ce titre, il est tenu d’informer le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d’office ou être saisi par le médecin. Cela permet que la mesure soit prolongée sous le contrôle du juge.
Le Conseil constitutionnel a, par conséquent, censuré les dispositions du fait de leur contrariété à l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
E. Exemples jurisprudentiels récents
Les éléments en faveur d’un maintien de la mesure d’isolement doivent être précis et circonstanciés et doivent être décris dans la même tonalité que les décisions médicales. 3 juillet 2023, n° 23/00.081
Le fait qu’un patient dissimule son visage derrière une couverture, en refusant tout contact oral ou visuel ne justifie pas son placement en isolement afin de prévenir un dommage immédiat pour le patient. Cour d'appel de Montpellier - 1re chambre civile, 1er janvier 2024, n° 24/00001 :
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mai 2024, n°22-22893 : Une personne est placée à l’isolement après une admission en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète suite à une décision du représentant de l’Etat. Le Juge des libertés et de la détention a tranché par deux fois en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement. L’intéressé fait appel de la dernière ordonnance rendue. Néanmoins, le non-respect de l’obligation de motivation n’est pas sanctionné, ni par une fin de non-recevoir, ni par une nullité pour vice de forme.
7.4 - L’audience devant le JLD
L’audience devant le JLD se déroule sous l’éclairage de l'article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique.
A) La nécessaire audition de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques
L'alinéa 2 de l'article L3211-12-2 du Code de la santé publique prévoit : "A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa."
A ce titre, le juge doit constater l’avis médical comportant les motifs médicaux faisant obstacle à l’audition du patient. (Cour de cassation, 25 mai 2023, n° 22-12.229)
B) La place du tuteur et du curateur devant le JLD
Conformément au principe du contradictoire, l’article R. 3211-11 du Code de la santé publique impose que le greffier avise les parties à la procédure.
1) Les textes
Il ressort de la lecture de l’article 468 du Code civil que : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur… introduire une action en justice ou y défendre ».
L’article R. 3211-15 du Code de la santé publique dispose par ailleurs :
« Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties à l’audience. Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties ».
L’article R. 3211-13 du même Code, relatif à la procédure devant le JLD, dispose notamment « Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;
2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques. […] »
2) La jurisprudence
La famille du patient doit en outre être avertie de la tenue de l’audience. La Cour d’appel de Douai a ainsi considéré, dans une ordonnance du 26 septembre 2013, que l’absence de toute information donnée à la famille justifiait la mainlevée immédiate de l‘hospitalisation en soins sans consentement.
La Cour d’appel de Paris, dans une ordonnance du 20 juillet 2022 a rappelé l’exigence d’information et de convocation du tuteur ou du curateur lors d’une audience devant le JLD. Le juge considère que dans le cas contraire, la décision du JLD est entachée « d’une irrégularité de fond pouvant être invoquée en tout état de cause et qui ne peut être couverte en appel, portant nécessairement atteinte aux droits de la personne protégée ».
Cette irrégularité de fond, qui peut être soulevée pour la première fois en appel (Cour de cassation, 12 mai 2021, n°20-13.307)
7.4.1 - Le lieu de l’audience
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 septembre 2013, ce n’est qu’exceptionnellement que le JLD peut statuer au siège de la juridiction. Ainsi, selon l’article L. 3211-12-2, le principe est désormais que l’audience se déroule dans une « salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil » et qui doit garantir « la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès du public ». Dès lors, ce n’est que lorsque ces trois conditions ne sont pas satisfaites, que le JLD peut statuer au siège du tribunal judiciaire, soit d’office, soit sur demande de l’une des parties. La salle d'audience doit être accessible au public (sauf audience en chambre du conseil).
L’article L. 3211-12-2 précise enfin :
« … En cas de transfert de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l’établissement d’accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine ».
La loi du 27 septembre 2013 a supprimé l'entier dispositif du Code de la santé publique afférent au recours à la visioconférence lors des audiences du JLD, même pour les cas de force majeure.
L’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété permet toutefois le recours dérogatoire à la visioconférence.L’article 1 fixe la durée de la période dérogatoire « entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de la loi du 23 mars 2020 susvisée ». L’article 7 précise les modalités du recours à la visioconférence.
7.4.2 - L’assistance obligatoire par l’avocat
L’arrêt de la CEDH du 31/01/2001 (arrêt VAUDELLE) affirme : « constitue une violation du droit à un procès équitable, le fait pour une personne placée sous curatelle, de ne pas être assistée ni par son curateur ni par un avocat ».
Au cours de la garde à vue, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peut designer ou faire designer un avocat par le bâtonnier (article 706-112-1 du CPP). L’article 706-116 du même code prévoit que la personne poursuivie doit être assistée par un avocat.
A défaut de choix d’un avocat par la personne poursuivie, son curateur ou son tuteur, le Procureur de la République ou le juge d’instruction fait designer par le bâtonnier un avocat qui intervient en commission d’office. Les frais d’avocat sont à la charge de l’intéressé, sauf si celui-ci peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Le majeur protégé ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle de droit. L’aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée en attente de l’obtention de l’aide juridictionnelle (les délais d’instruction des dossiers sont souvent longs).
NB : Si la personne doit être obligatoirement assistée par un avocat, la présence de l’avocat est non obligatoire en ce qui concerne la formulation d'une requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement (Cour de cassation, première chambre civile, 31 janvier 2024, pourvoi 23-15.969.
7.4.3 - La vérification par le juge du bien-fondé de la mesure
Les éléments essentiels et incontournables de cette vérification judiciaire sont les certificats médicaux. A cette fin, l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique précise :
« Sont communiqués au juge de la liberté et de la détention afin qu’il statue :
… 4° Une copie des certificats médicaux … au vu desquels la mesure de soins a été décidée … et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la plus récente décision de maintien en soins ».
La 1e chambre civile de la Cour de cassation a précisé, le 30 janvier 2019 (n°17-26131, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/janvier_9123/85_30_41253.html), les pièces devant être communiquées au JLD. Pour vérifier que la mesure d’hospitalisation sans consentement est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis (CSP, art. L. 3211-3), le JLD examine des pièces médicales et des pièces administratives. La production de l’ensemble des certificats médicaux est indispensable pour la régularité d’une procédure d’admission, faute de quoi la décision est irrégulière.
Le juge ne peut à aucun moment intervenir dans les domaines qui sont de la compétence des médecins. Il ne peut donc lever la mesure sur le motif que les soins ont été consentis devant lui, et qu’en conséquence la contrainte ne se justifie plus. (Cass, Civ 1, 27 septembre 2017, n°1622544)
Décision : Cour de cassation, 1ère civ., 15 novembre 2023, 23-14.928, Inédit: La Cour de cassation rappelle que « Lorsqu'il est saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, le juge doit examiner le bien-fondé de cette mesure au regard des certificats et avis médicaux produits, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical sur le traitement mis en œuvre ni déterminer s'il est le plus approprié à l'état de santé du patient.
C'est donc à bon droit, et sans avoir à procéder aux vérifications invoquées, que le premier président, se fondant sur les avis médicaux produits, s'est assuré de la nécessité de maintenir la mesure de soins sans psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. »
Certains juges s’autorisent néanmoins, après audition du patient, à prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation alors que les certificats produits avaient, suite à l’évaluation médicale, conclu au maintien de la mesure. Delphine LEGOHEREL cite une ordonnance de la CA de Poitiers du 17 août 2015 (n°15/00033, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031116914&fastReqId=1176335312&fastPos=1), qui illustre la liberté d'appréciation dont dispose le juge.
Cour de cassation, 24 janvier 2023, n°22-18.429 : S'il n'appartient pas au juge de porter une appréciation médicale en substituant son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de la nécessité des soins, il lui incombe de contrôler la régularité de la décision administrative d'admission ou de maintien en soins psychiatriques contraints et le bien-fondé de la mesure. Lorsque le certificat médical prescrit le maintien de l'hospitalisation complète, le juge peut, s'il l'estime utile, en considération d'autres éléments du dossier ou de ses propres constatations, demander une expertise médicale et ordonner ensuite, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure.
Cour de cassation - première chambre civile - 24 avril 2024 - n°23-18.590 : Le moyen faisant valoir qu’une ordonnance du premier président de Cour d’appel, en matière de soins sans consentement, doit être cassée lorsque celle-ci ne précise pas qu’il a été donné connaissance aux parties de l’avis du ministère public lors de l’audience (le ministère public n’étant pas à l’audience), ne peut pas être accueilli étant donné qu’il n’est pas argué que cet avis n’a pas été mis à disposition des parties, cette mise à disposition pouvant résultant de la décision mais également des pièces et de la procédure. Ainsi, la transmission, par le directeur de l’établissement, de la décision d’admission d’une personne à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent peut être prouvée par la mention portée sur la décision d’admission, conformément à l’article 3212-5, I, du Code de la santé publique.
Décision : CA PARIS 1-12, 4 juillet 2023, n°23-00337 : La Cour d’appel de Paris rappelle que « Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. »
7.4.4 - L’ordonnance de mainlevée et l’appel
A. L'ordonnance de mainlevée de la mesure
L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique dispose :
« … III – Le juge des libertés et de la détention ordonne s’il y a lieu la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issu du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa la mesure d’hospitalisation complète prend fin ».
Lorsque le juge prononce la levée de la mesure d’hospitalisation complète avec effet différé afin qu’un programme de soins puisse être établi, sa décision ne contraint ni l’établissement de soins, ni le préfet à mettre en œuvre un programme de soins sans consentement. Le juge laisse ainsi au psychiatre la responsabilité de décider de la suite de la prise en charge et de proposer éventuellement un tel programme de soins.
Motifs possibles d'une décision de mainlevée
Le JLD estime, au regard du nouvel article L 3222-5 du CSP que s'il n’existe aucune indication quant à la motivation d’une mesure d'isolement/contention et de ses renouvellements « permettant au juge des libertés et de la détention d’exercer le contrôle de la mesure prévu par les dispositions rappelées ci-dessus, en particulier celui de son adaptation, nécessité et proportionnalité », alors la mesure d’isolement doit être vue comme irrégulière. Le JLD rappelle alors que cette mesure est une « modalité essentielle, particulièrement attentatoire à la liberté de l’intéressé, dont l’irrégularité ne peut en conséquence que porter atteinte à ses droits ». (Tribunal judiciaire de Versailles, Ordonnance JLD, 18 janvier 2021, n° RG 21/00047 mainlevée d’une hospitalisation complète)
Dans une ordonnance du 26 mars 2021, n°RG 21/00343, le JLD du Tribunal judiciaire de Versailles a estimé que « seule la levée de la mesure d’hospitalisation complète constitue, le cas échéant, une sanction effective, au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, du constat d’une irrégularité affectant une mesure d’isolement et/ou de contention prise dans ce cadre, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits du patient concerné.»
L’article R. 3211-16 du Code de la santé publique précise que le JLD doit :
- notifier l’ordonnance aux parties, ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
- informer les parties sur les délais et modalités d’appel, ainsi que sur la spécificité de l’appel du Procureur de la République.
La Cour de cassation (Cass, Civ 1, 19 octobre 2016, n°16-18849), considère que la notion d’autorité de la chose jugée est applicable aux ordonnances des JLD.
Enfin, si les autorités administratives ont la possibilité de procéder à une nouvelle admission en hospitalisation sans consentement dans la suite immédiate de la levée de la mesure par le juge, la nouvelle mesure nécessite obligatoirement un nouveau contrôle du JLD, lequel n’est pas sans risque de désaveu pour l’autorité administrative.
Dans une ordonnance de la Cour d’appel de PARIS, Pole 1, Chambre 12, en date du 20 novembre 2023 (RG 23/00581), les Conseillers ont pris une décision de mainlevée de la procédure d’hospitalisation sans consentement à la demande du préfet de Police. En effet, le certificat médical de situation produit en appel ne caractérise pas de façon circonstanciée et précise l’existence actuelle de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes et portant atteinte de façon grave à l’ordre public. Il a été jugé que la mesure peut dès lors se poursuivre dans le cadre d’une hospitalisation libre ou d’un programme de soins.
Cour de cassation, 8 mars 2023, n°21-25.205 : 7. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des décisions de première instance et d'appel ni des pièces de la procédure que la requête du directeur d'établissement était accompagnée de la décision d'admission du 13 mai 2013 et de la dernière évaluation médicale approfondie de l'état mental du patient maintenu en soins depuis cette date, le premier président a violé les textes susvisés.
La Cour d'appel de GRENOBLE rappelle que la mainlevée peut être différée pour mettre en place un programme de soins : « L'article L3211-12-1 III énonce que lorsque le juge ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.Au regard des troubles présentés par Monsieur [G] [K] ayant justifié son hospitalisation et de leur persistance mis en évidence par l'avis médical circonstancié du 28 mai 2024 évoquant une symptomatologie psychotique avec des raisonnements paralogiques et des digressions du discours, imposant la poursuite de soins psychiatriques alors que son adhésion aux soins est encore impossible, il y a lieu d'ordonner que la mainlevée sera différée pour une durée de 24 heures pour qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. » (Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation D'office, 31 mai 2024, n° 24/00069).
Motifs ne permettant pas la mainlevée de la décision:
La première chambre civile de la Cour de cassation revient sur la circonstance de la fugue du patient dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement prise par le préfet en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Une telle fugue ne permet pas, à elle seule, de justifier la mainlevée de la mesure. Il est nécessaire que les avis médicaux des psychiatres puissent établir l’état de santé du patient. La fugue faisant obstacle à l’appréciation de l’état de santé du patient de telle sorte que la mainlevée ne peut être prononcée. (Cour de cassation - Première chambre civile 19 mars 2025 / n° 23-23.255)
B. L’expertise obligatoire pour la levée des mesures des malades médico-légaux
Ainsi, préalablement à l’audience :
- le JLD recueille l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du Code de la santé publique ;
- dans le cas où l’avis du collège est favorable à la levée de la mesure, le JLD ne peut décider de la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises allant dans le même sens.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022 rappelle cette exigence en expliquant qu’il « résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. »
L’article L. 3213-5-1 du Code de la santé publique précise que les experts ne peuvent « appartenir à l’établissement d’accueil ». Il précise également :
- les conditions dans lesquels les experts sont inscrits sur une « liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur régional de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est située l’établissement » ;
- la manière dont le juge doit procéder lorsqu’il n’est pas possible de faire appel à des experts inscrits sur les listes : « à défaut », il désigne le ou les experts « sur la liste des experts inscrits près la Cour d’appel du ressort de l’établissement ».
Les experts conduisent les opérations d’expertise selon les modalités définies à l’article R. 3211-14. J. L. SENON et C. JONAS précisent que : « Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d’expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du Code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie » (EMC Psychiatrie, p.9).
C. La procédure d’appel
L’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique énonce :
« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I … ».
L'article R. 3211-18 précise que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Cour de cassation, première chambre civile, 28 février 2024, Pourvoi n° 22-15.888 : Il résulte des textes L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique qu'il incombe au premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet des soins sans consentement aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins.
Cour de cassation, première chambre civile, 5 juillet 2023, Pourvoi n°23-10.096 : Le majeur placé sous une mesure de curatelle peut, sans l’assistance de son curateur, faire appel la décision de maintien de soins psychiatriques sans consentement.
Cour de cassation, 15 mai 2024, Pourvoi n° 22-24.110 et Cour de cassation, 31 janvier 2024 Pourvoi n° 22-23.242: La Cour de cassation confirme que la personne hospitalisée peut interjeter appel seule, ou avec son avocat, sans sans mandataire, s'agissant d'un acte personnel.
Cour de cassation, première chambre civile, 31 janvier 2024, Arrêt n°46 F-B, pourvoi n°T 22-23.242 : Le majeur sous curatelle renforcée peut seul interjeter appel d’une décision du JLD en matière d’hospitalisation sans consentement. Sur le visa des articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique, la Cour a retenu que : « Constitue un acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant.
Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [K], l'ordonnance retient que M. [K], en sa qualité de majeur sous curatelle en vertu d'un jugement du 30 novembre 2018, ne pouvait agir ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. »
Cour de cassation, première chambre civile, 6 décembre 2023, Pourvoi n° 22-18.703 : L'article L.3211-12 6° du code de la santé publique attribue qualité à agir à « un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet de soins ». En retenant que le seul lien fraternel ne confère pas ipso facto la qualité de parent ou personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins et en exigeant de l’appelante qu'elle justifie de surcroit de « liens particuliers (qui) l'autoriseraient à interférer dans la vie de sa soeur », le magistrat a violé ce texte en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté le lien de parenté unissant Mme et Mme.
Toutefois, lorsque le patient fait appel, les juges tiennent compte de l’article R. 3211-28 du Code de la santé publique, lequel énonce que l’établissement où la personne est hospitalisée doit transmettre sans délai la requête de l’intéressé au greffe de la juridiction, par tout moyen permettant de dater sa réception. C’est ainsi que le juge d’appel de Versailles a accueilli l’appel hors délais d’un patient, dès lors que l’établissement n’avait pas donné les moyens au patient d’exercer son droit de recours dans les délais (ordonnance de mainlevée du 24 octobre 2014, n°14/07580, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029801104&fastReqId=826227010&fastPos=2).
Conformément aux articles 546 et 547 du Code de procédure civile, le tiers ne peut pas faire appel de la décision s'il n'est pas demandeur à l'instance (Cour d'appel de PARIS, Pole 1, Chambre 12, 3 novembre 2021, n°21-00.394, Cour d’appel de PARIS, Pole 1, Chambre 12, 16 novembre 2021, n°21-00.416 et Cour d'appel de PARIS, Pole 1, Chambre 12, 3 décembre 2021, n°21-00.432).
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2024, 22-21.898, Publié au bulletin : La Cour de cassation effectue un rappel concernant le décompte de délais : Vu les articles R. 3211-22, alinéa 1er, et R. 3211-19, alinéa 1er, du code de la santé publique:
Il résulte de ces textes que le premier président ou son délégué, saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, statue dans les douze jours de sa saisine.
L'ordonnance maintient la mesure de soins sans consentement, après avoir retenu que l'appel, relevé le vendredi 27 mai 2022 à 18h02 après l'heure de fermeture du greffe, avait été enregistré le lundi 30 mai suivant et que le jeudi 9 juin, le délai de douze jours, courant à compter de l'enregistrement de l'appel, n'était pas écoulé.
En statuant ainsi, alors que le délai pour statuer avait commencé à courir à compter de la réception de la déclaration d'appel et que, conformément aux règles de computation des délais en jours, il avait expiré le 8 juin suivant, le premier président a violé les textes susvisés.
Le deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose quant à lui :
« … L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la Cour d’appel ou son délégué statue à bref délai dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par le psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard dans les quarante-huit heures avant l’audience ».
Conformément à l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, la procédure devant la Cour d’appel prévoit que celle-ci doit disposer de l’avis motivé du psychiatre sur la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement au plus tard 48 heures avant l’audience. Ainsi, un avis trop éloigné de la date d’audience ne permet pas à la Cour d’analyser si les conditions de maintien demeurent réunies, cela porte atteinte aux droits du patient et la mainlevée doit être ordonnée (Cour d'appel de Paris, 13 avril 2023, n°23/00169)
Le troisième alinéa de l’article L. 3211-12-4 pose une exception au caractère suspensif des ordonnances du JLD lorsque le procureur de la République estime qu’il existe un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ». L'article R. 3211-20 précise ces dispositions.
Le droit d’appel des parties ne déroge pas aux dispositions de l’article 546 du Code de procédure civile : « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».
La Cour de cassation a jugé que la mesure dont le directeur d’un établissement fait appel doit avoir reçu au moins un commencement d’exécution : « Alors que, à l’audience, Mme X… a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu à statuer dès lors qu’il n’y a pas eu de réintégration effective, si Mme X… est, dans l’ordonnance du premier président, mentionnée comme « actuellement hospitalisée au CHU de Nantes Saint Jacques », elle est néanmoins domiciliée, dans cette même ordonnance, au 87 bd des Anglais et non au CHU localisé au…, et la déclaration d’appel, l’avis d’audience et la notification de l’ordonnance ont tous été envoyés à son adresse personnelle ; que la mesure de réadmission en hospitalisation complète n’ayant toujours pas été exécutée, la requête du directeur d’établissement tendant à la prolongation d’une mesure qui n’a reçu aucun commencement d’exécution est sans objet » (Cass, Civ 1, 24 mai 2018, n°17-21057).
Le juge d’appel a considéré que l’avocat du patient, dont la présence est obligatoire auprès de ce dernier ou pour le représenter, « tient son mandat autant de son client que de la loi ». Il en résulte que « la volonté du patient de se désister de l’appel ne fait donc pas obstacle au maintien du recours par son avocat ». [1]
La régularité de l’appel par un majeur protégé sans l’assistance de son curateur est questionnée. Par deux arrêts d’avril 2023, la Cour d’appel a considéré que l’appel interjeté par le majeur protégé sous mesure de curatelle sans l’assistance du curateur est irrecevable, le majeur protégé ne pouvant ester ou se défendre en justice sans l'assistance du curateur (Cour d’appel, 7 avril 2023, n°23/00155 et Cour d'appel de Paris, 11 avril 2023, n°23/00165).
L’article R3211-30 du Code de la santé publique dispose : « L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. »
La Cour de cassation veille au respect de ce délai. Ainsi, dans une décision du 12 janvier 2022, la première chambre civile casse et annule, sans renvoi l’ordonnance d’un premier président de Cour d’appel ayant statué dans un délai de 20jours après la déclaration d’appel. L’ordonnance censurée confirmait une ordonnance de refus de mainlevée, prononcée par le JLD.
Exemples d’infirmations de décision du Juge des libertés et de la détention :
La Cour d’Appel d'Aix-en-Provence, dans une ordonnance du 11 janvier 2022 a infirmé la décision du JLD ordonnant le maintien en hospitalisation complète d’un patient et prononcé la mainlevée de la mesure alors qu’il était fait état, par les psychiatres, d’une « alliance thérapeutique satisfaisante, sans opposition aux soins et au traitement ».
L’article L3211-12-4 III du Code de la santé publique exige qu’en cas d’appel, « un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. »
Si aucun avis n’a été transmis au greffe de la Cour d’appel, cette dernière prononcera la mainlevée de la mesure. Voir en ce sens l’ordonnance de la Cour d’appel de Rennes du 3 janvier 2022.
Dans une ordonnance de la Cour d’appel d’Amiens du 23 février 2022, le juge rappelle l’obligation de recueillir les observations du patient avant chaque décision « qu’elle soit d’admission ou de maintien ». La Cour estime que l’impossibilité pour le patient de pouvoir présenter ses observations « lui cause manifestement un préjudice s’agissant de la discussion des soins et du traitement » et entraine la mainlevée de la mesure.
Cour d'appel de limoges, Chambre des étrangers, 4 août 2023, n° 23/00080 :
En l'état, du fait des insuffisances des certificats médicaux, il n'est établi pas que M. [U] présenterait toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffrirait de troubles mentaux rendant impossible son consentement.
Il convient donc d'infirmer la décision du premier juge et de donner mainlevée de la mesure de soins sous la forme de l'hospitalisation complète. »
Concernant le droit de la personne à être entendue : Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mars 2024, 23-21.615 : En premier lieu, il résulte de articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que, si le premier président, saisi d'un appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques sans consentement que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition, il en va autrement lorsque la personne n'est plus en hospitalisation complète, qu'avisée de la date d'audience, il lui incombe alors de se présenter d'elle-même à l'audience ou d'en solliciter le report en raison d'une impossibilité de s'y présenter.
Or le premier président a constaté que Mme [Y] était sortie de l'établissement de santé trois jours après l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qu'elle était suivie en ambulatoire et qu'elle avait été régulièrement convoquée et avait signé sa convocation.
[1] PANFILI, op. cit., p. 38
7.5 - Les programmes de soins : l’ambulatoire sous surveillance
Le programme de soins est une alternative à l’hospitalisation complète qui permet aux patients en soins psychiatriques sans consentement d’accéder à une gamme de soins ambulatoires. Pour autant, il n’est pas possible aux patients d’accéder à ces soins ambulatoires durant la « période d’observation et de soins sous la forme d’une hospitalisation complète » de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique. Celle-ci est le premier temps de toute prise en charge en soins psychiatriques sans consentement.
1. Définition :
L’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique, complété par l’article R. 3211-1, formule le concept de « programme de soins », lequel est spécifique aux soins dispensés « sous toute autre forme » que l’hospitalisation complète :
La doctrine laisse entendre que le concept du « programme de soins » est un « ensemble composé » :
- d’une « décision unilatérale » prise par une autorité administrative (préfet ou directeur de l’établissement d’accueil) sur proposition du psychiatre ;
- et du « document » support de la proposition du psychiatre.
L'article R. 3211-1 précise les modalités possibles du programme, ainsi que les conditions et mentions qui doivent et ne doivent pas figurer sur le document support.
La prise en compte de « l’avis du patient » est impérative avant chaque décision afférente à la forme des soins, qu'il s'agisse d'une décision d'admission ou de maintien en soins. Le recueil de cet avis est effectué dans les conditions indiquées par l'article R. 3211-1, III.
L’article R. 3211-1, III souligne également que : « … La modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l’adapter à l’état de santé de ce dernier », ce qui peut aller jusqu’à l’hospitalisation complète.
2. Aucune mesure de contrainte en principe :
Suite à la décision QPC du 20 avril 2012 du Conseil constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012235QPC.htm), le nouvel article L. 3211-2-1 issu de la loi du 27 septembre 2013 précise :
« … III - Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme du 2° du I (le programme de soins) ».
Ainsi, les personnes soumises aux soins ambulatoires ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive, ni être conduites ou maintenues de force dans les établissements pour accomplir les séjours prévus par le programme de soins. Ce pratique est de nature à « engager la responsabilité des soignants, du directeur, voire de l’établissement » (Annales médico-psychologiques, avril 2018, n°4, p. 417). S’agissant de la responsabilité des établissements, le tribunal judiciaire est alors compétent.
Cependant, rien n’empêche qu’un programme de soins formule des restrictions à la liberté personnelle. En effet, les restrictions de la liberté individuelle se distinguent des restrictions à la liberté personnelle. Les premières correspondent à des restrictions au droit pour chacun d’agir librement sans encourir de mesure(s) arbitraire(s). Les secondes sont des restrictions au droit de ne pas subir de contrainte(s) sociale(s) excessive(s) au regard de la personnalité.
3. Le contrôle du JLD sur le programme de soins :
Le JLD contrôle la légalité des programmes de soins dans le cadre de la saisine facultative de l’article L. 3211-12. Comme le relève Jean-Marc PANFILI à la lumière d’une ordonnance de mainlevée de la CA de Versailles du 5 mai 2017 (n°17/02362) : « La mainlevée sur saisine facultative du juge peut être obtenue s’il y a une adhésion active aux soins déjà prodigués, ainsi que des justificatifs de démarches en vue de la mise en œuvre du suivi volontaire envisagé »[1].
Dans une ordonnance de la Cour d’appel de Versailles (ordonnance de mainlevée du 21 mars 2014, n°14/01854, https://psychiatrie.crpa.asso.fr/IMG/pdf/2014-02-14-ca-versailles-mainlevee-spi-admission-retroactive.pdf), le juge a requalifié en hospitalisation complète un programme de soins comprenant deux jours de sortie par semaine.
La Cour de cassation a confirmé la compétence du JLD pour ordonner la levée d’un programme de soins (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2024, n°22-50.031).
La Cour de cassation a rappelé récemment les droits du patient à se voir informé des décisions prises à son encontre : Cass. 1re civ., 25 mai 2023, no 22-12108.
Cour d'appel de CAEN, Recours Soins psychiatriques, 11 juillet 2024, n°24/01610 : « Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.En l'espèce, force est de constater qu'aucune difficulté n'est relevée dans la prise en charge de la patiente depuis la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte à la faveur de la mise en place d'un programme de soins conformément à la décision du premier juge, et qu'aucun certificat médical actualisé n'est produit pour soutenir et justifier du contraire, de sorte que la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte n'est plus démontrée. »
Outre la pratique des « faux programmes de soins », il n’est pas rare que soient découverts, à l’occasion des contrôles dans les établissements, :
- des programmes de soins non signés par les patients, ce qui interroge sur la réalité de la notification au patient ;
- des programmes de soins très anciens, ce qui interroge sur la conformité du document par rapport à l’actualité de l’état de santé du patient.
[1] Jean-Marc PANFILI - Le juge, l’avocat et les soins psychiatriques sans consentement : Quels changements depuis 2011, document mis à jour le 23/12/2018, p. 48, https://psychiatrie.crpa.asso.fr/IMG/pdf/panfili_jean-marc_2018-12-23_analyse_de_la_jpdce_mise_a_jour.pdf
7.6 - L’indemnisation de l’hospitalisation sous contrainte
L’article 3216-1 du Code de la santé publique précise ainsi que le tribunal judiciaire « statue sur les réparations des conséquences dommageables résultant des décisions administratives … ». Ainsi, le juge judiciaire, et plus précisément le Tribunal judiciaire (ancien Tribunal de grande instance) est compétent pour statuer sur l’indemnisation des patients qui ont subi une atteinte à leurs droits.
7.6.1 - Les actions en indemnisation
L’hospitalisation irrégulière donne droit à indemnisation. Se basant sur l’article 5 de la CEDH, la jurisprudence a développé l’étendue du droit à indemnisation.
A. La compétence principale du juge judiciaire
L’article L3216-1 CSP affirme que le juge judiciaire est compétent, même pour les unités pour malades difficiles et quel que soit le montant de la demande.
Le Tribunal Judiciaire compétent à saisir est celui de Paris pour l’assignation de l’agent judiciaire de l’Etat, ou celui du lieu d’hospitalisation.
B. Délais de prescription
La prescription est de 10 ans contre les établissements de santé à compter de la consolidation du dommage, c’est à dire quand l’hospitalisation prend fin : article L1142-28 CSP.
Pour la commune ou le préfet et l’agent judiciaire de l’Etat, la prescription est de 4 ans : à compter du 1er janvier suivant la date de fin d’hospitalisation. Le délai s’interrompt facilement par toute demande formulée auprès de l’administration.
Il en est de même des demandes de dossier médical qui interrompent le délai.
7.6.2 - Les préjudices donnant droit à indemnisation
Une irrégularité formelle ou de fond entraine le droit à indemnisation, même en l’absence de décision de mainlevée.
A. Personnes pouvant être mises en cause
- Directeur de l’établissement quand demande d’un tiers ou péril imminent : il faut bien cibler l’établissement, AP HP par exemple sur hôpital à Issy les Moulineaux à assigner car Corentin Cariou n’a pas la personnalité juridique
- En cas de décision préfectorale : Etat donc agent judiciaire de l’Etat
- Commune quand la décision est du maire
Si s’y ajoute une irrégularité concernant une mesure d’isolement, l’établissement hospitalier peut aussi être mis en cause. On peut aussi engager la responsabilité de l’Etat, même quand l’hospitalisation est faite à la demande d’un tiers, quand le JLD n’a pas statué dans les délais impartis.
Il s’agit de se demander qui a contribué à la réalisation du dommage.
Le tiers demandeur ne peut pas être assigné, sauf circonstance très particulière. (ex : complicité de faux certificat médical) car le tiers ne fait qu’une demande et ne prend pas de décision.
On peut reprendre tous les moyens soulevés devant le JLD même s’il n’a pas statué dessus.
Devant le juge de l’indemnité, tout préjudice peut être soulevé.
B. Principaux types de préjudices reconnus par la jurisprudence
- La privation de liberté d’aller et venir
Sont prises en compte les modalités de la privation de liberté : si la personne voit du monde, a des sorties ou au contraire n’a aucun contact téléphonique…
Pour 20 jours : 3.600 euros à Paris, 7.000 euros à Pontoise.
Pour 28 jours : 8.000 euros à Versailles (CA).
Pour 83 jours : 20.000 euros à Paris.
Pour 107 jours d'hospitalisation : 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté (Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 7 juillet 2022, n° 21/04488)
Pour une hospitalisation de 7 jours et 6 mois de programme de soins : 3.650 euros CA Paris.
Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 21 mai 2024, n°23/01175 : Une mesure irrégulière, privant la liberté d’aller et venir ainsi qu’une atteinte à son intimité justifie le traumatisme causé par ladite mesure entraine nécessairement son indemnisation.
- L’administration des traitements médicamenteux sous la contrainte
Ce qui est indemnisé, c’est l’absence de possibilité de discuter du médicament choisi, administré de force, sous la contrainte : la jurisprudence indemnise la privation de choix.
Pour 80 jours, 5.000 euros alloués à ce titre.
Le quantum est plus important quand cela est fait par injection car plus traumatisant : 1.000 euros pour 7 jours
- Le préjudice financier :
Perte de salaire, perte de chance d’occuper un emploi, honoraires de l’avocat
- Les atteintes à la vie familiale :
Dans le cas d’un enfant mineur placé à l’ASE au moment de son hospitalisation : 6.000 euros pour 28 jours
- Les atteintes à l’image liées à la mesure d’hospitalisation :
Par exemple en cas de plainte du voisinage : nécessité d’apporter la preuve :
- Le défaut de notification des décisions :
Entre 500 et 1.500 euros
- L'absence de base légale de la décision :
La Cour de cassation a jugé que l’annulation d’un arrêté de placement d'office prive cette décision de tout fondement légal. Une atteinte a donc été portée à la liberté individuelle de la personne, obligeant l’auteur de l’acte à l’indemniser. Cette indemnisation doit être versée “quel que soit le bien-fondé d’une telle hospitalisation” au moment des faits. Même si la décision d’internement était justifiée, son manque de base légale suffit à donner droit à une indemnisation.
En l’espèce, l’arrêté du maire d'internement d'office pour un habitant au nom de son pouvoir de police administrative a été pris en raison de la “notoriété de la situation” de la personne concernée. Ce motif a été déclaré inconstitutionnel par une décision QPC n° 2011-174 QPC du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2011. Le Tribunal administratif a donc tiré les conséquences de cette inconstitutionnalité et a annulé l’arrêté. (Cass. Civ 1. 26 juin 2019, A n°18-12.630, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/juin_9326/612_26_43053.html)
- Le défaut de surveillance ayant entraîné un suicide
Le juge administratif peut, dans certaines circonstances, sanctionner le défaut de surveillance ayant entraîné un suicide du patient.
Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2009, le juge estime que : « Compte tenu des circonstances de son hospitalisation et de la parfaite connaissance qu'avaient les médecins des risques que comportait son état mental, le fait que M.X ait pu échapper à la vigilance du service où elle était hospitalisée et ait pu mettre fin à ses jours révèle une défaillance dans la surveillance et une faute dans l'organisation du service ; que cette faute est directement à l'origine de l'accident qui a entraîné la mort de M.X ; qu'elle est de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ».
Voir aussi Conseil d’Etat, 12 mars 2012.
- Agressions subies par les patients
Dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 juillet 2008, le juge administratif reconnaît la faute d’un établissement, de nature à engager sa responsabilité, dans le cas d’une patiente agressée sexuellement par un autre patient. En cause notamment, l’absence de séparation entre les hommes et les femmes dans les locaux, et l’absence dans les chambres de dispositif d’appel du personnel chargé. Voir également en ce sens : dans le cas d’une agression, CE, 30 juin 1978, CE, 10 avril 1970 ou encore CE, 23 juin 1986.
- Les préjudices subis lors d’une fugue
Le juge administratif peut sanctionner les défauts d’organisation et de surveillance des services psychiatriques, lorsqu’un patient fugue de l’établissement. C’est par exemple le cas dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 11 juillet 1997, qui explique que « alors même que le patient aurait reçu les soins médicaux rendus nécessaires par son état, et que le service hospitalier n’aurait pas eu connaissance des tentatives de suicide du patient, l’absence totale de surveillance particulière de nature à prévenir une fuite inopinée constitue, par elle-même, une faute dans l’organisation du service ». En l’espèce, le patient avait fugué de l’établissement et avait subi des blessures graves, après s’être défénestré. Voir également, CE, 12 mai 1972 ; CE, 27 février 1985 ; CE 12 décembre 1979.
C. L’indemnisation spécifique liée à l’isolement :
Le 17 janvier 2019, le Tribunal de Versailles a indemnisé la victime d’un isolement pendant 21 jours sans contention par 10.000 euros : « il appartenait à l’hôpital de justifier que cela avait été pris en dernier recours dans un but thérapeutique et non dans la prévention de la fugue ou un but sécuritaire ».
Fautes de nature à engager la responsabilité de l'établissement psychiatrique
Défaut de surveillance de la part du personnel médical :
- Défaut de surveillance ayant entrainé des blessures graves, quand bien même les mesures d’isolement et de contention étaient justifiées. CAA Douai, 10 avril 2018, n° 16DA01134 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036834283/) :
Un patient en état d’agitation aigu et d’agressivité extrême lors de son admission en établissement psychiatrique placé à l’isolement dès son arrivée pour une durée de 6 jours et sous contention durant 4 jours. Si une surveillance régulière a été programmée au début de la mesure, celle-ci aurait dû être adaptée par la suite au regard :
- Du caractère prolongé de la mesure de contention
- Du comportement très agité du patient
- De l’apparition de signes visibles de blessures au niveau des points d’attache.
De plus, aucun document ne fait état d’un examen médical lors du dernier renouvellement de la mesure de contention ou lorsque celle-ci a pris fin, deux jours avant la fin de l’isolement.
L’équipe médicale « en n'assurant pas, pendant la mesure de contention prescrite à M.C..., une surveillance et un suivi de l'état de santé de l'intéressé adaptés à la durée de la mesure de contention et à l'état tant physique que psychique du patient de nature à prévenir l'apparition de la paralysie de son bras gauche et l'insuffisance rénale aiguë secondaire consécutive à une rhabdomyolise résultant d'une immobilisation prolongée et en ne diagnostiquant que tardivement cette paralysie de son bras gauche, a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’EPSM » (§6)
- Défaut de surveillance ayant entrainé la mort d’une patiente en isolement CAA de Nantes, 7 février 2020, n° 18NT00789 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041548628)
Une femme atteinte de troubles bipolaires placée en isolement et sous neuroleptiques à son entrée en établissement psychiatrique est décédée par asphyxie. Le personnel infirmier s’est contenté d’une surveillance à distance des mouvements respiratoires de la patiente derrière le hublot de la chambre d’isolement. Il n’a pas respecté la prescription médicale indiquant la nécessité de prendre la pression artérielle et du pouls de la patiente toutes les deux heures. « Cette carence dans la surveillance [est] constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier » (§1)
Conditions de placement à l’isolement inhumaines et dégradantes caractérisées par :
- L’absence d’information concernant la durée précise des mesures répétées de placement en isolement
- Des conditions d'hygiène insuffisantes
- Du manque de soins
L’administration hospitalière est tenue de prendre toute mesure utile afin d’éviter un traitement inhumain et dégradant des patients en raison de « la vulnérabilité des patients placés en chambre d'isolement et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration hospitalière. » (§3) - CAA Marseille, 21 mai 2015, n°13MA03115 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030625025)
7.7 - Commission Départementale des Soins Psychiatriques et la Commission des Usagers
Ce sont deux instances de la démocratie sanitaire assurant des présences régulières dans les établissements habilités à dispenser des soins psychiatriques sans consentement qui constituent des voies d’alerte ET de recours contre les décisions et pratiques abusives.
7.7.1 - La Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP)
Le Code de la santé publique y consacre les articles L. 3223-1 à L. 3223-3 et R. 3223-1 à R. 3223-11.
L’article L. 3222-5 du Code de la santé publique fixe le champ de compétence global de la CDSP :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II et IV du titre Ier du présent livre ou de l'article L. 706-135 du Code de procédure pénale au regard des libertés individuelles et de la dignité des personnes ».
Ce dispositif ne donne à la CDSP qu'une compétence limitée à l’examen de la situation des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement.
La CDSP peut être saisie par toute personne en soins psychiatriques sans consentement, en application de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, qui précise le détail des droits dont la personne en soins psychiatriques sans consentement « dispose en tout état de cause ». Ce dispositif est à relier avec l’article L. 3223-1, 2° qui précise que la CDSP : « reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ».
L'exercice de ces droits suppose celui du « droit d'écrire » et d'user de tous les moyens de communication qui permettent de joindre la CDSP, dont la communication téléphonique ou électronique.
L'article L. 3223-1 du Code de la santé publique établit un bloc de huit champs de compétences de la CDSP, dont les principaux sont qu’elle :
« 1° Est informée dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre premier du présent livre de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins.
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation … » Elle statue sur les modalités d’accès au dossier médical.
Ces compétences sont précisées par l'article R. 3223-8.
« … 3° Examine en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatrique en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale, et obligatoirement dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
a) Celle des toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 (admission en cas de péril imminent) ;
b) Celle de toute personne dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an ; … »
La Commission peut alors demander au directeur (article L. 3212-9), proposer au préfet (article L. 3213-4) et proposer au JLD la levée d’une mesure de soins sans consentement (article L. 3223-1,7°).
Cour de cassation, 1ère civ, 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.370 : La Cour de cassation précise qu’en cas de défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques, si celle-ci a été sollicitée par l’intéressé, cela peut mener à la mainlevée de la mesure dont ce dernier fait l’objet. Il doit être noté qu’il s’agit ici d’un cas particulier car, au moment des faits, une commission départementale des soins psychiatriques n’était pas mise en place à la REUNION et qu’en conséquence, la situation est celle qui, de fait, mène à ce que l'ARS « s'auto-avise ».
La CDSP visite au moins deux fois par an les établissements habilités à recevoir des patients hospitalisés sans consentement, et reçoit les patients qui le souhaitent, vérifie les informations figurant sur le livre de la loi (article L. 3223-1, 5°) et contrôle le registre de l’isolement et de la contention qui « doit être présenté, sur leur demande, à la CDSP, au Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté et aux parlementaires » (article L. 3222-5-1, issu de l’art. 72 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé).
Décision : Cour de cassation, 1ère civ., 24 avril 2024, n°23-18.590 : La Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent. La preuve de cette transmission peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission.
En l’espèce, la décision d’admission datait du 17 février 2023 et une copie de celle-ci a été adressée à la commission départementale des soins psychiatriques le 20 février 2023, l'obligation de transmission a ainsi été respectée.
7.7.2 - La Commission des Usagers (CDU)
Une « Commission des usagers » (CDU) « est instituée dans chaque établissement de santé public ou privé ainsi que dans les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé » (article R. 1112-79). Les compétences et procédures relatives à la Commission des Usagers (CDU) sont établis par les articles R. 1112-79 à R. 1112-94 du Code de la santé publique. Ainsi, la CDU :
- participe à l’élaboration de la politique de l’établissement en matière d’accueil, de prise en charge, de l’information et des droits des usagers ;
- est associée à l’organisation du parcours de soins (pour laquelle elle peut formuler des propositions) ;
- est associée à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale de l’établissement ;
- peut s’autosaisir de tout sujet concernant la politique de qualité et de sécurité des soins, et doit être informée de la suite donnée à ses observations.
7.8 - Mise en cause de la responsabilité des établissements
Les décisions d’autorisation de sortie et de levée des mesures de soins sans consentement sont encadrées strictement.
Dans un arrêt de la CAA de Paris, du 25 septembre 2022, la Cour reconnaît pour la première fois, la faute d’un établissement de santé, ayant laissé sortir une personne souffrant de troubles psychiques, qui a, un an et deux mois plus tard, assassiné son ami lors d’une crise hallucinatoire. L’accusé, M.F, a été reconnu irresponsable pénalement. La famille de la victime a demandé au juge administratif, de reconnaître une faute de nature à engager la responsabilité de différents acteurs, dont l’établissement de Maison Blanche. Le tribunal administratif n'a pas fait droit à cette demande. La Cour administrative d’appel s’est prononcée, le 25 septembre 2022, après avoir recueilli des expertises.
- La décision de levée de l’hospitalisation d’office et de l’absence de mesures d’hospitalisation
La Cour relève que le préfet a ordonné la levée de l’hospitalisation d’office en se basant sur l’avis du psychiatre traitant, qui avait lui-même sollicité l’abrogation de cette mesure en expliquant alors que le patient « ne présentait plus d’idées délirantes ni de trouble thymique, et que son comportement dans le service était adapté ».
Pourtant, le rapport d’expertise souligne que le patient, pendant les jours et semaines précédant les faits : n’avait « toujours pas de reconnaissance de ses troubles », qu’il ne faisait « pas de réelle critique de ses troubles » et qu’il était « très revendicatif, très ambivalent aux soins ».
Dans ces circonstances, la Cour administrative d’appel de Paris estime que l’établissement de Maison Blanche « ne pouvait conclure que l’état de santé [du patient] justifiait que l’hospitalisation soit levée dès lors que ce dernier se trouvait encore dans un état d’échappement thérapeutique avec un déni persistant de sa maladie ». La Cour retient donc une faute de la part de l’établissement de Maison Blanche et infirme le jugement du tribunal administratif.
- L’inaction de l’établissement de Maison Blanche lors de l’interruption du traitement
La Cour relève qu’ « au moment de la situation délictueuse, le sujet était en échappement thérapeutique sans suivi régulier. Une rechute délirante, psychotique était active ». Pourtant, le psychiatre assurant le suivi de M.F était conscient des dangers d’un tel échappement thérapeutique pour son patient, et avait même expliqué, dans le cadre d’une procédure pénale, que « la plupart des troubles du comportement, qui ont entraîné ses actes de délinquance, sont survenus à des périodes hors hospitalisation où il n'était pas traité et après des hallucinations et des idées délirantes », les expertises relèvent également que le patient « avait cessé tous soin dès lors qu’il avait obtenu tous les papiers qu’il estimait utile ».
La Cour administrative d’appel de Paris conclut donc que « l’établissement de santé, […] ne pouvait ignorer les graves risques de rechutes psychotiques délirantes auxquels M. F... était exposé du fait de l'arrêt de son traitement en mai 2003 ; que l'établissement devait, par conséquent, adopter des mesures de nature à prévenir tout passage à l'acte hétéro et/ou auto-agressifs ; qu'en s'abstenant d'intervenir tout en connaissant les très graves risques encourus, l'établissement public de santé de Maison Blanche a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ».
La Cour estime que ces deux circonstances sont « à l’origine directe et certaine de la rechute délirante de M.F… lequel, privé de tout traitement, n’a pu éviter la crise hallucinatoire l’ayant conduit à assassiner M.E…A… ». Et condamne l’établissement de santé à verser 30 000 euros à la mère de la victime, et 15 000 euros au frère de la victime, en réparation du préjudice moral que ces derniers ont subi.
8 - Suggestions pour préparer une plaidoirie
Ce chapitre a été rédigé par des avocats ayant l’expérience d’avoir à défendre des personnes vivant avec des troubles psychiques et des bénévoles de l’UNAFAM ayant eu à conseiller des familles. Il va de soi que chaque personne appelle une plaidoirie adaptée à son cas judiciaire et à sa personnalité. Les cas et pratiques ici présentés, qui ont facilité une prise en compte par les juges de l’impact du handicap psychique sur la capacité des personnes à maîtriser leurs actes et leurs besoins prioritaires de bénéficier de soins, ont été sélectionnés comme témoignages de la possibilité d’y parvenir dans l’intérêt des clients.
On se contentera de donner ici quelques repères :
8.1 - Réunir des informations sur le parcours de vie et de soins
- Solliciter le témoignage des proches, du curateur ou tuteur, ou d’éventuels témoins sur l’état de la personne au moment des faits : état de crise, rupture du traitement, errance etc…
- Documenter la situation médicale : ordonnance de soins psychiatriques, certificats d’hospitalisation en psychiatrie, carte de handicap, attestation MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) délivrant l’allocation adulte handicapé (AAH) ou la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH), ou encore décision de mise sous tutelle ou curatelle. Dans ce dernier cas, le tuteur ou curateur doit être entendu
- Demander une expertise psychiatrique
Il est possible lors de la garde à vue, si la personne est en état de crise, d’obtenir de la préfecture une hospitalisation en SDRE (soins sans consentement à la demande d’un représentant de l’Etat ).
1. Exemple d’un témoignage de famille appelé par l’avocat, qui s’est montré efficace
Quelques repères sur la vie de R…
Contexte : R passe en Cour d’Assise, il est accusé d’avoir violé une personne vulnérable. Cette personne est handicapée psychique et les faits se sont déroulés dans une résidence accueil. R a déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines de prison. Il est, au moment du procès, incarcéré de façon préventive.
R souffre de troubles psychiques très invalidants. Il souffre depuis plus de 20 ans d’une schizophrénie dite indifférenciée où se succèdent des phases d’autisme et de retrait social (2 ou 3 ans sans sortir de sa chambre), de délires et d’hallucinations (R a pensé pendant plusieurs années que moi-même et lui vivions dans des mondes parallèles et que c’était la raison pour laquelle j’étais masqué), des phases d’agressivité (envers autrui mais aussi envers lui-même comme en témoigne son doigt mutilé), des phases d’angoisse. (Cette partie sur les délires de Romain a été ensuite développée pour répondre à une question du Président de la Cour)
Il a des difficultés à percevoir la réalité et de très forts troubles cognitifs altèrent sa pensée et parasitent très fortement sa relation à l’autre. Tout ceci est compliqué par une mauvaise adhésion aux traitements ainsi que des tendances addictives.
En 20 ans, il a passé plus de 10 ans en hôpital psychiatrique dont environ 2 années sur 2 séjours en UMD
R est reconnu handicapé (psychique) depuis 1997 jusqu’en 2023 par la COTOREP puis par la CDAPH. Son taux d’incapacité est estimé à plus de 80%. Sa capacité à travailler est inférieure à 5%.
Il a bénéficié depuis sa majorité d’une mesure de curatelle renforcée.
R suit systématiquement le même cycle :
CHS → Sortie à l’essai →arrêt du traitement →mauvaises rencontres →prises de toxiques →crise
La crise se terminant généralement par une hospitalisation sans consentement… ou, depuis plus récemment, par un séjour en prison…
R est incapable de retenir des leçons de ses expériences ; il ne sait pas se méfier de ses mauvaises rencontres. Il s’est fait par 2 fois véritablement « casser la figure » comme en témoigne l’état de ses dents. Ses fréquentations ont mis le feu à son appartement (en 2008). D’autres, à qui il donnait l’hospitalité, ont vidé son appartement (en 2014).
R a des troubles du jugement affectant ses décisions et ses pensées. Par exemple, il est persuadé que ce sont ses médicaments qui le font tousser, pas le tabac…
R a d’énormes difficultés à reconnaître les intentions de l’autre. Par exemple, il donne sans arrière-pensée des médicaments à une personne suicidaire qui lui en demandait. Cela s’est terminé de manière tragique…
Un psychiatre avait expliqué que R présentait un « manque d’altérité », c’est-à-dire qu’il ne perçoit pas toujours la frontière entre lui et l’autre…
2. Modèle de mémoire récapitulatif du parcours de vie et de soins d’une personne sujette à des troubles psychiques (suggéré par l’UNAFAM)
Nom et coordonnées de l’auteur
« Maître
J’ai l’honneur de vous présenter un mémoire d’information relatif à la personnalité et à l’état de santé mentale de X, mon ….
X est opposé à Y pour des faits de ………………………………………….……………………………………………….. survenus le …………. à …
Je souhaite, par cet exposé chronologique des faits, vous apporter tous les éléments probants et vérifiables susceptibles d’éclairer la réflexion et le verdict du Tribunal.
I – Historique
(NDLR : Rappel du contexte familial en introduction. : construction de la famille)
II – Les faits par ordre chronologique
III – Le déclenchement de l’action de police motivé par une protection vitale (appel familial, voisinage, amis, témoins….)
IV – Le parcours de soins psychologiques et psychiatriques suivi par la personne depuis son enfance (joindre certificats médicaux, rapports d’expertise, feuilles d’hospitalisation, ordonnances…)
V - Le contexte familial (violences, crises, situations difficiles antérieures puis climat post agression, récidives de violences, de crise, situation de profond abattement, addictions, démarches sociales pour le malade, pour la famille, traitements, hospitalisations…)
V- Conclusion : la recherche de solutions, les démarches engagées, les services sociaux saisis, (que veut-on , sous quelle forme, avec quelles protections , qu’attend-t-on de la décision de justice ?) ( de quelles ressources dispose le malade, quel accompagnement judiciaire et médical, quel logement ?).
8.2 - Exemples d’argumentaires demandant une contre expertise
1. Demande de contre-expertise soulignant les contradictions de l’expertise
I / Rappel des faits et de la procédure :
► D est mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d’une instruction criminelle depuis le … du chef de : − Tentative d’assassinat
► Un rapport d’expertise psychiatrique a été rédigé par les Experts Y et Z le …, adressé à la défense le …. et reçu le ….
► le…, par déclaration au greffe, le Conseil sollicitait qu’il plaise au magistrat instructeur d’ordonner une contre-expertise. Par ordonnance en date du …., notifiée le même jour par télécopie, le magistrat instructeur devait rejeter cette demande. C’est cette ordonnance dont il est fait appel. Monsieur D, par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite qu’il plaise à la Cour d’infirmer l’ordonnance dont il est fait appel et d’ordonner une contre-expertise psychiatrique, sous le bénéfice des explications de fait et de droit livrées ci-dessous. En effet, le rapport d’expertise dont discussion, contient plusieurs contradictions relatives à la discussion tirée de l’examen psychiatrique rapporté. En outre, l’existence ou non d’un risque de réitérations des faits n’est pas évoqué.
Discussion :
En droit :
►Aux termes de l'article 167 du Code de procédure pénale
En fait :
► Sur le premier paragraphe de la réponse à la question n°8
Les Experts confirment le diagnostic d’une pathologie mentale chronique du registre des troubles du spectre autistique. Ils relèvent « un sentiment diffus de d’hostilité du monde extérieur » notant toutefois que l’intéressé « garde un contact avec le réel ». Les Experts semblent étayer l’argument en faveur d’un contact avec le réel par le raisonnement suivant :
- a. « Il n’a pas développé de délire de persécution systématisé, qu’il soit en secteur ou plus diffus en réseau »,
- b. « Ce sentiment d’hostilité fait suite à des éléments de réalité, même s’il a pu exagérer certaines de ces craintes »,
- c. « Bien qu’il ressente depuis longtemps une certaine hostilité de la part d’autrui, il ne s’agit pas de persécuteurs désignés »,
- d. « Il a pu jusqu’alors garder la maitrise de ses comportements ».
La présente discussion porte sur les éléments de ce raisonnement :
1. En premier lieu (point « a »), le vécu de persécution de l’intéressé, voire une psychose paranoïde sont rapportés dans de multiples pièces médicales :
- Le …. : « Hospitalisation pour épisode de persécution ». « Celle-ci aurait décrit de l’angoisse, un vécu de persécution (…) »,
- (Rapports d’expertise du Pr Y) : « Les troubles à type de vécu de persécution se seraient aggravés ces dernières semaines ». « D peut (…) décrire un sentiment de persécution (…). Le port du couteau semble s’inscrire dans un contexte de persécution », «(…) en proie à des angoisses de persécution». « On perçoit alors l’aspect très paranoïde de s structure puisqu’il affirme qu’il ne voir pas les gens que comme mauvais, comme des ennemis », « Vision paranoïde du monde (…)», « Son examen révèle des anomalies mentales du domaine de la psychose paranoïde avec une vision persécutoire dangereux dont il faut se protéger».
- Rapport d’expertise querellé : « Etant donné le jeune âge du sujet, une évolution vers une schizophrénie reste possible si l’on prend en compte les modifications survenues au niveau du comportement depuis début 2014 avec agressivité et froideur affective ainsi que l’existence, alors qu’il n’était pas encore traité par Risperdal, d’un syndrome de persécution entrainant chez Monsieur une réelle peur du monde extérieur ». Il est à noter que tant dans les deux rapports d’expertises, de nombreuses pièces médicales rapportent que D était obsédé par l’idée de tuer notamment son ancien camarade du collège. […]
Il semblerait que dans le rapport querellé, les Experts « penchent » en faveur d’un vécu persécutoire sans lien avec une quelconque pathologie, en adoptant le raisonnement noté plus haut en « a, b,c ». D conteste ce raisonnement, les points a, et c sont des éléments factuels critiqués ci-dessous. En outre, les Experts, bien qu’ayant pris connaissance du rapport d’expertise du Pr Y, n’évoquent nullement (soit pour infirmer, soit pour confirmer), une des réponses des conclusions du rapport déposé par ces dernières : « Son examen révèle des anomalies mentales du domaine de la psychose paranoïde avec une vision persécutoire dangereux dont il faut se protéger ». (Rapport d’expertise du Pr Y p. ) Dès lors il convient qu’une contre-expertise psychiatrique soit organisée afin qu’il soit clairement statué sur les points suivants.
2. En deuxième lieu, Il est pour le moins curieux que les Experts relèvent que « Ce sentiment d’hostilité fait suite à des éléments de réalité, même s’il a pu exagérer certaines de ces craintes ». Les éléments délirants de type interprétatif, en lien avec une mauvaise compréhension des signaux émis par l’autre, sont d’ailleurs évoqués par les Experts.
3. En troisième lieu, contrairement à ce qui est relevé par les Experts, il existe bel et bien un persécuteur désigné, en parallèle de la vision paranoïde du monde.
Dès lors, les Experts ne peuvent – sans contradiction - relever à la fois la désignation réitérée et sans équivoque d’un persécuteur et tenir un raisonnement au terme duquel il n’existerait pas de délire de persécution systématisé au motif notamment qu’il n’y aurait pas de persécuteur désigné.
4. En quatrième lieu, les Experts ne peuvent raisonnablement tirer argument de ce que « Il a pu jusqu’alors garder la maitrise de ses comportements ». L’objectif d’une expertise psychiatrique, sur la question de l’abolition ou l’altération du discernement, consiste à jauger de la capacité de maitrise de l’intéressé au moment des faits. Dès lors, peu importe qu’avant ou après les faits, le discernement de l’intéressé soit aboli ou altéré. Par ailleurs, les Experts ne discutent nullement des déclarations de l’intéressé. Il convient que, lors d’une contre-expertise, les Experts présentent les arguments en faveur ou en défaveur de la perte de maitrise de D au moment des faits et indiquent leurs réflexions sur les déclarations de D reproduites ci-dessus.
Il est pour le moins surprenant que les Experts écartent, sans explication aucune, les raisons de passage à l’acte évoqué par D et confirmé dans la procédure, afin d’y substituer d’autres raisons de passage à l’acte.
► Sur l’absence de la précision du risque de réitération des faits Il n’est sérieusement pas envisageable de considérer le rapport d’expertise complet sans la réponse à cette question.
► Sur la motivation de l’ordonnance dont appel, c’est à tort que le magistrat instructeur a retenu les éléments suivants :
1. Dans l’ordonnance dont appel, la motivation souffre d’une confusion évidente entre différentes notions psychiatriques. Si ladite ordonnance reprend l’argumentation de la défense pour convenir de ce que « un vécu persécutoire » est une notion différente du « délire de persécution », elle ne répond nullement à la question soulevée relativement à la « psychose paranoïde ». En effet, le Pr Y relève chez D une psychose paranoïde. Le second rapport d’expertise ne mentionne en aucun cas de psychose paranoïde. La difficulté vient de ce que les seconds Experts, qui ont pris connaissance du rapport d’expertise du Pr Y, ne présentent aucun argument pour confirmer ou infirmer la pathologie diagnostiquée par le professeur. Ils ont tout simplement fait fi de cette pathologie.
2. La motivation de l’ordonnance dont appel souffre de contradictions
Il y est à la fois relevé l’existence de plusieurs persécuteurs désignés et à la fois tiré argument de ce que « c’est à raison que les seconds experts ont retenu l’absence de persécuteurs désignés ».
3. Il n’appartient pas au magistrat instructeur de se substituer aux Experts en indiquant que « les moments féconds sont sans lien direct avec cette notion de psychiatrie renvoyant à un moment d’exacerbation des délires chroniques ».
En effet, la demande de contre-expertise rejetée, visait notamment à interroger les experts sur cette question, la réponse devant être donnée par des professionnels de la psychiatrie.
4. Sur l’absence de question relative à la réitération des faits
Il est exact que l’ordonnance de commission d’expert a été communiquée à l’ancien Conseil de . Il est constant que ni l’ancien Conseil de D, ni le Ministère Public, ni le magistrat instructeur n’ont jugé utile que cette question soit posée. Pour autant, il est tout aussi constant, que lorsque l’affaire sera examinée par une formation de jugement, cette question sera au cœur des débats. Il serait pour le moins délicat de laisser la formation de jugement examiner l’affaire sans les précisions essentielles à ce type de dossier.
Par ces motifs
Vu les articles 81, 108 et suivants du Code de procédure pénale, D, par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite qu’il plaise à la Cour de :
- Infirmer l’ordonnance dont appel,
- Ordonner une contre-expertise psychiatrique à tel collège d’expert qu’il plaira à la Cour de désigner, - Lui confier la mission habituelle.
2. Demande de contre-expertise sur la base d’une contestation des bases techniques de l’expertise
Sur le droit applicable
• En vertu des alinéas 3 et 4 de l’article 706-47-1 du code de procédure pénale : « Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins. Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.»
• En vertu de l’article 706-47 13° du code de procédure pénale : « Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : (…) 13° Délits d'atteintes sexuelles prévus aux articles 227-25 à 227-27 du même code.»
Sur l’application de la Loi
Sur le fond
À l’évidence en rendant obligatoire la mesure d’une expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes, le législateur a souhaité mettre la Juridiction de jugement en mesure d’apprécier de manière éclairée la personnalité de l’intéressé et en conséquence – en cas de condamnation – prononcer une peine qui – notamment - assure la protection de la société et prévient la commission de nouvelles infractions. Si la déclaration de la culpabilité ne résulte assurément pas de cet élément de la procédure, en revanche il est patent que l’expertise psychiatrique commande directement la peine infligée (en cas de culpabilité avérée) tant dans son quantum et que dans sa nature et ceci conformément aux buts et fonctions de la peine édictés par l’article 130-1 du Code pénal
En l’espèce, le rapport de l’expertise psychiatrique ne saurait utilement éclairer le Tribunal. En effet, d’une part la méthode d’examen souffre incontestablement de fiabilité en ce qu’elle ne répond pas à des critères scientifiques. D’autre part, la « discussion » expertale est entachée de contradiction.
⇒ Sur la critique de la méthode d’expertise
L’Expert a procédé à 5 séries de questionnaires afin de répondre aux questions qui lui étaient posées par voie de réquisitions. Il s’agit de la méthode dite « actuarielle » ou à tout le moins « semi-structurée ».
- En premier lieu, bien qu’en matière pénale la méthode utilisée par l’Expert ne soit pas encadrée par la Loi, la méthode « clinique » est celle qui est pratiquée dans l’écrasante majorité des cas en France.
- En second lieu, à supposer que la méthode « actuarielle » ou « semi-structurée » puisse être intrinsèquement fiable, encore faudrait-il que les questionnaires qui la composent puissent être de qualité ou à tout le moins un minimum reconnus par la littérature scientifique. En l’espèce, les questionnaires sont les suivants :
- Test de personnalité d‘Eysenck,
- Questionnaire d’impulsivité,
- Questionnaire de personnalité PDQ4,
- Echelle HAD d’anxiété dépression de Sigmond et Snaith,
- Inventaire de symptomatologie dépressive IDS-SR.
L’ensemble de ces questionnaires s’appuie sur une analyse factorielle des réponses, analyse qui découle d’algorithmes dont les formules mathématiques – faute d’être explicitées dans le rapport - échappent au contrôle du Tribunal, du Ministère Public et des Conseils de parties. Enfin et surtout, sans analyse autre, la méthode est prédictive.
Le test de personnalité d’Eysenck :
- Relève du domaine psychologique et non de la psychiatrie.
- Il a pour prétention de mesurer deux facteurs : l’extraversion et le névrosisme. Ce test a vocation à suggérer une certaine prédictibilité des conduites à risque par l’intermédiaire de ces deux facteurs.
- Les hypothèses de construction de la personnalité de ce test reposent sur l’analyse factorielle.
Le Questionnaire d’impulsivité :
Il existe une multitude de tests afin de « mesurer » l’impulsivité. Faute pour l’Expert de préciser le questionnaire utilisé (UPPS, BIS-10dit test de Barrat, etc..), ni le Tribunal, pas davantage que le ministère public ou les avocats des parties ne sont en mesure de discuter de la fiabilité des scores relevés à l’aide de ce test.
⇒ Sur la critique de la « discussion » expertale
Faute de porter à la connaissance du Tribunal, du Ministère public et des Conseils des parties le contenu de l’examen clinique et de la discussion, le rapport d’expertise souffre de la possibilité d’une discussion contradictoire sur le fond.
1. En premier lieu, l’Expert relève (p.).
2. En second lieu, l’Expert soutient que B ...
L’expert n’a entrepris aucune discussion relative au fait que le casier judiciaire de B ne porte trace d’aucune mention. Il aurait été utile de se pencher sur le point de savoir si cette circonstance ne discrimine pas de facto une perversion structurelle,
L’expert n’a pas pris en compte la dimension contextuelle. À l’évidence si déviance il y a, elle n’est pas chronique. Afin de mesurer la dangerosité de l’intéressé et les risques de renouvellement de l’infraction, il aurait été efficient que l’Expert se penche sur la dimension contextuelle du passage à l’acte.
PAR CES MOTIFS Vu les articles 156, 388-5, 463, 706-47 et 706-47-1 du code de procédure pénal ; Vu l’article 229-22-1 du Code pénal ; B sollicite qu’il plaise au Tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée sa demande ;
En conséquence, AVANT DIRE DROIT, ordonner une mesure de contre-expertise psychiatrique confiée à tel Expert près la Cour d’appel, ayant pour mission :
1° - Procéder à l'examen psychiatrique de B et dire s'il est en mesure de comprendre les propos et de répondre aux questions ;
2° - Dire si l'examen de l'intéressé révèle chez lui des anomalies mentales ou psychiques, le cas échéant les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent;
3° - Dire si l'infraction reprochée au sujet est en relation avec des éléments factuels ou biographiques de l'intéressé;
4° - Dire si l'intéressé était atteint au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du code pénal et définir si ce trouble peut être en relation déterminante ou partielle avec les faits reprochés à l'intéressé ;
5° - Dire si l'intéressé a agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister au sens de l'article 122-1 du code pénal ;
6° - Dire si l'état mental de l'intéressé risque de compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes et nécessiterait, dès lors, une hospitalisation en milieu spécialisé en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
7° - Dire si l'intéressé présente un état dangereux au sens psychiatrique ou criminologique en énumérant les éléments de pronostic défavorables ou favorables ;
8° - Dire quelles sont les propositions thérapeutiques possibles et se prononcer sur l'opportunité, sur un plan psychiatrique, en cas de condamnation ultérieure, d'une injonction de soin dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ;
De façon générale, faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner vos observations dans un rapport.
3. Demande de contre-expertise après une expertise réfutant l’abolition du discernement
En droit :
►Aux termes de l'article 167 du Code de procédure pénale...
En fait :
1. Sur « l’état des lieux » posé par l’Expert
À la lecture des deux rapports d’expertises, il apparaît que l’Expert relève :
- Un premier antécédent psychiatrique : hospitalisation du … au … Pôle santé publique CH… Ce dossier mettrait en évidence un épisode psychotique aigu par suite d’une consommation aigue de produits toxiques (avec bouffée délirante aigue).
- Un second antécédent psychiatrique : hospitalisation du …. au …. Hôpital de …
Ce dossier mettrait en évidence un diagnostic de trouble psychotique aigu d’allure psychotique., sans consommation de produits toxiques.
2. Sur les motifs ayant conduit l’Expert à écarter une abolition du discernement
L’Expert relève deux motifs :
D’une part, A n’a pas agi sous du fait d’un commandement lié à une hallucination,
D’autre part, le conflit domestique qui existait entre A et B était un élément de la réalité.
3. Le premier motif de la Discussion expertale est entaché de contradiction
En premier lieu et à l’évidence, il y a une contradiction entre le fait de relever que A présentait des hallucinations auditives au moment des faits et le fait qu’il n’ait pas agi sous l’injonction d’un commandement.
En effet, comment A qui, selon le même Expert, présentait « au moment des faits une pathologie psychotique décompensée, non soignée »peut-il faire la différence entre ce qui résulte d’une hallucination auditive et d’un commandement ou de la réalité ?
On peut même s’interroger sur le point de savoir en quoi l’hallucination auditive en elle-même ne serait pas un commandement ?
Enfin, le propre d’une hallucination est de paraître être la réalité pour la personne qui la subit et dès lors il est impossible pour A de faire la différence entre une hallucination, un commandement et la réalité, étant admis par l’Expert que sa pathologie était décompensée et qu’il était en proie à des hallucinations auditives au moment des faits.
En tout état de cause, dès lors que l’Expert admet d’une part que A était en proie à des hallucinations auditives au moment des faits et en état de décompensation, et par ailleurs dans un mode de vécu de persécution, il est indéniable qu’il se trouvait d’un état de fausseté absolue de jugement.
4. Le second motif de la discussion est entaché d’erreur
À supposer que A n’était pas en proie à une hallucination auditive au moment des faits ou que cette hallucination n’équivaille pas à un commandement, il est particulièrement nécessaire de voire trancher les points suivant :
L’ensemble de ces éléments amène à s’interroger sur le point de savoir dans quelle mesure sa pathologie a infiltré son quotidien au point de se promener en permanence avec un couteau sur lui pour se protéger d’une personne qui pour autant n’avait jamais exercé de violences sur lui. Dès lors, on peut affirmer qu’il présentait un vécu global d’insécurité et persécutoire qui polluait son quotidien en permanence.
En conséquence, sa perception de la réalité était emprise à la distorsion. En effet, son environnement pathologique ne pouvait que le faire accéder à une réalité faussée.
5. Sur « l’altération absolument majeure » retenue par L’Expert
La notion d’altération ou d’abolition du discernement est une notion binaire qui ne souffre pas de graduation.
Il est essentiel à la manifestation de la vérité qu’un collège d’Experts puisse procéder à une contre-expertise afin de trancher l’ensemble des points susvisés.
Pour toutes ces raisons et en application des articles 81 et 167 du Code de procédure pénale, A, par mon intermédiaire, sollicite qu’il vous plaise d’ordonner une contre-expertise psychiatrique en désignant un collège d’Experts avec les questions habituelles en sus des points soulevés dans la présente demande.
4. Demande de la nullité d’une expertise pour cause de conflit d’intérêt chez l’expert
À titre préliminaire, sur la recevabilité de nouveaux moyens de nullité. :
En droit :
►Aux termes de l'article 173-1 du Code de procédure pénale ...
► Aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale...
En fait :
Le …, E déposait par l’intermédiaire de son Conseil le présent mémoire complémentaire en sus de la requête déposée le …. Les nouveaux moyens de nullité soulevés sont recevables.
Sur violation des dispositions relatives au caractère équitable, impartial et contradictoire de la procédure pénale, sur la violation des dispositions relatives au secret médical et sur la violation du principe de la loyauté de l’administration de la preuve :
En droit : sur violation des dispositions relatives au caractère équitable, impartial et contradictoire de la procédure pénale :
► Aux termes de son article 6.1, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) ».
► La Chambre criminelle rappelle que le défaut d’impartialité d’un expert peut constituer une nullité (Crim. 8 juin 2006, pourvoi n°06-81359).
► La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion d’énoncer que l’exigence du respect du principe de la contradiction, posée par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’étend aux expertises accompagnant la procédure juridictionnelle :(CEDH, 18 mars 1997, X... c/ France. Requête n° 21497/93).
En droit : sur la violation des dispositions relatives au secret médical
► Les articles L.1110-4 et suivants du Code de la santé publique consacrent le secret médical. Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
► Les articles 56, 60, 60-1 et suivants du Code de procédure pénale régissent la désignation d’un Expert, la collecte de toute donnée ou document utile à la manifestation de la vérité et les modalités selon lesquelles l’Expert peur prendre connaissance des pièces mises sous scellé.
En droit : sur la violation des dispositions relatives au principe de la loyauté dans l’administration de la preuve :
► Aux termes de l’article préliminaire du Code de procédure pénale : « I -La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties (…). En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ».
► Aux termes de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…). 3. Tout accusé a droit notamment à : . a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; . b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (…) ».
► Selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation : le fait de susciter des échanges verbaux qui seraient versés au dossier pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d’enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et porte atteinte au droit à un procès équitable. Crim. 6 mars 2015 (Pourvoi n°14-84339).
En fait : sur la nullité du rapport d’expertise qui figure à la côte tirée de la méconnaissance du principe du secret médical et de communication de pièces placées sous scellés :
En fait : sur la nullité du rapport d’expertise qui figure à la côte …, tirée de la méconnaissance du principe de la loyauté dans l’administration de la preuve :
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 6 de la CEDH, Vu les articles Préliminaire, 56 et suivants, 802 du Code de procédure pénale, Vu L.1110-4 du Code de la santé publique L.1110-4 du Code de la santé publique, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, E, sollicite qu’il plaise à la Chambre de l’Instruction de :
- Le déclarer recevable en ses requête et mémoire complémentaire,
- Prononcer la nullité des cotes sollicitées par mémoire déposé le … : - « la réquisition de l’Officier de police judicaire ayant désigné le Dr Y comme expert, - le rapport du Dr Y, - le procès verbal de réception de ce rapport du …,
- Prononcer la nullité des cotes suivantes et tous les actes subséquents…
5. Demande de complément d’expertise pour cause d’insuffisance de l’expertise
À l’évidence et à juste titre, la vision d’un Expert diffère de celle d’un soignant. En soins, V est amenée à se rencontrer « elle-même », à décrypter et à comprendre son fonctionnement. Il serait illusoire et erroné de considérer que ce travail est terminé. Une personne détenue et qui fait face à une procédure criminelle pour la première fois, n’est pas forcement en mesure de comprendre que l’axe d’« exposé des faits », les raisons de passage à l’acte, ne sont pas abordés de la même manière par un psychiatre-expert que par un psychiatre-soignant : V a livré sa vision des choses, telle qu’elle la travaille avec le personnel soignant, ce qui a peut-être pu produire un discours auto-centré.
Mais surtout, il est posé à l’expert, la question de l’existence d’un clivage face à la gravité des faits, aux conséquences dramatiques, ce d’autant que V soutient que si elle avait prodigué les soins à son enfant, elle aurait peut-être survécu.
Au regard des éléments exposés ci-dessus et sous le visa des articles 156 à 169-1 du Code de procédure pénale, V vous demande qu’il vous plaise d’ordonner un complément d’expertise confié au Dr W aux fins d’audition de V et de Z et dépôt d’un complément de rapport au regard des observations ci-dessus.
Lorsqu’on obtient un accord sur une contre-expertise, il est recommandé de bien choisir l’expert, veiller au contenu de la mission qui lui est donnée, qui doit prévoir la demande de transmission des dossiers médicaux, la consultation des proches et des témoins des faits, du tuteur ou curateur, d’amis etc…
Parmi les témoignages méritant d’être recueillis : famille, amis, témoins des faits tuteur, curateur, assistante sociale, voisins…
9 - Remerciements
Remerciements pour leurs conseils précieux
Association Nationale des Juges d’Application des Peines (ANJAP)
Avocats pour la Défense des Droits des Détenus (A3D)
Commission Santé et Bioéthique du Barreau de Paris
Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté
Prison Insider
Anaëlle BECKER, stagiaire UNAFAM et Prison-Insider (2020)
Remerciements pour leur soutien financier
Fondation Amnesty International France
Fondation Sisley
Ministère de la Justice – Direction de l’Administration Pénitentiaire