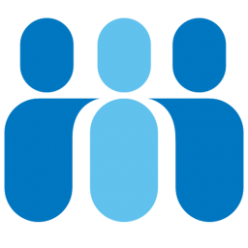Le droit à la santé des personnes détenues est un droit fondamental. Il repose sur des obligations claires et précises imposées à l’administration pénitentiaire et aux autorités sanitaires. Le non-respect de ces obligations peut constituer une atteinte grave à la dignité humaine et engager la responsabilité de l’État.
Quelques jurisprudences permettent de connaître l’application de ce droit fondamental.
- Décision du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES du 15 janvier 2019.
http://nantes.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Jurisprudence/Decisions-2019
L‘Etat a été condamné à verser 800 € à un détenu pour des conditions d’accès aux soins au cours d’extractions médicales.
Il se plaignait d’avoir été menotté et entravé pendant les rendez-vous qui se sont déroulés en présence constante du personnel de l’escorte pénitentiaire.
Il dit aussi avoir renoncé à de nouvelles extractions de peur de subir le même traitement.
- Arrêt du CONSEIL D’ETAT du 26 avril 2019.
Il incombe à l’administration pénitentiaire de prendre les mesures propres à protéger la vie des détenus et en particulier d’accomplir toutes les diligences en vue de leur faciliter l’accès aux soins . ( art.R 6111-29 du code de la Santé Publique).
En l’espèce la détenue demandait la levée immédiate de la mesure d’isolement à la maison d’arrêt de Fresnes et de lui garantir sans délai un suivi psychiatrique régulier, à raison d’un rendez- vous minimum tous les quinze jours auprès d’un médecin psychiatre.
Jurisprudence de la CEDH au regard de l’article 3 de la Convention :
- Arrêt CEDH : 23/02/2012. Le maintien d’un détenu schizophrène dans un établissement pénitentiaire inapte à l’incarcération des malades mentaux viole l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
x, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne (voir, par exemple, Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 82, série A no 244, et Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, § 66, Recueil 1998‑V)
La CEDH conditionne la régularité de la détention (article 5 de la Convention EDH) à l’exécution de la peine privative de liberté dans un établissement approprié :
Article 5 de la Convention – Droit à la liberté et à la sûreté
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(…)
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ; (…)».
- Arrêt de principe en la matière
Arrêt CEDH Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985
https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/1985/CEDH001-61983
Violation de l’article 5§1 : La Cour estime que la régularité de la détention implique qu’il y ait un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté, et le lieu et les conditions de la détention.
Ainsi, elle considère que, la détention d’une personne atteinte de troubles psychique ne sera considérée, en principe, comme régulière, que si elle se déroule « dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié».
Le juge italien a ordonné, compte tenu de son état de santé mental, le transfert en REMS d’une personne détenue souffrant de troubles psychiques. Ce transfert n’a pas eu lieu. La Cour considère que le maintien du requérant en détention ordinaire, pendant deux ans, sans bénéficier « d’aucune stratégie thérapeutique globale » constitue une violation de l’article 3 de la Convention.
La Cour a également condamné l’état Italien sur le terrain de l’article 5§1 de la ConvEDH car il n’existait plus, de lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu et les conditions de la détention. Le requérant nécessitait des soins en REMS du fait de son état de santé, et sa détention dans un établissement pénitentiaire ordinaire était inadapté.
L’Etat défendeur avançait des arguments logistiques et financier, en expliquant qu’il n’y avait pas de places disponibles en REMS. La Cour a refusé de faire droit à cet argument et regrette que les autorités nationales n’aient pas « créé de nouvelles place au sein des REMS ni trouvé une solution. Il l[les autorités ]leur revenait d’assurer au requérant qu’une place en REMS serait disponible ou de trouver une solution adaptée »(§135).
Chapitres connexes :